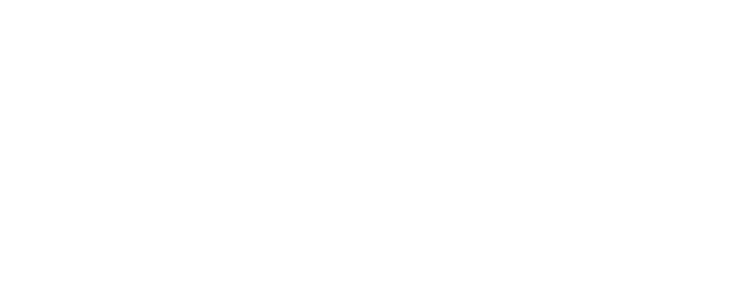Appel à textes : Méthodologies créatives, participatives et numériques en recherche multimodale dans des contextes linguistiques minoritaires
Ce volume thématique s’intéresse à des recherches novatrices menées dans des contextes linguistiques minoritaires, en particulier celles qui adoptent des méthodologies créatives, participatives et numériques. Nous reconnaissons qu’il existe une tendance à appréhender ces contextes au singulier, en les réduisant souvent aux minorités linguistiques dites officielles ; par exemple l’anglais au Québec ou le français hors Québec dans le contexte canadien. Cette approche occulte la diversité interne aux communautés et exclut fréquemment d’autres groupes, au Canada et ailleurs, qui partagent pourtant des enjeux similaires de reconnaissance, de transmission et de vitalité linguistique. Nous proposons ainsi une définition large des contextes linguistiques minoritaires, incluant notamment les communautés autochtones, les locutrices et locuteurs de langues régionales ou minoritaires autres que le français et l’anglais, ainsi que les multiples formes d’intersectionnalité qui traversent ces identités et ces contextes.
Les personnes chercheuses qui mènent des travaux en contextes linguistiques minoritaires, soit des milieux nécessairement plurilingues, multiculturels et multimodaux, évoluent dans des espaces où plusieurs langues, modes d’expression (visuels, audio, etc.) et formes de savoir (oraux, écrits papier ou numériques, mais aussi ancrés dans des philosophies et pratiques éducatives propres aux communautés) cohabitent. Malgré la richesse de ces contextes de recherche, elles se voient souvent contraintes, par les normes académiques dominantes, à choisir un format textuel linéaire, généralement l’article scientifique, et une seule langue de communication même si sa recherche et son terrain de recherche incluent plusieurs langues ou modalités. Par exemple, la recherche peut prendre la forme de vidéos dans plusieurs langues, ou encore de photos (sans texte), mais les données sont contraintes à être produites dans un discours écrit, unilingue. Pourtant, les chercheurs·ses dans ces milieux sont habitué·es à naviguer d’une langue à l’autre, à mélanger, à bricoler, et à entrelacer des perspectives théoriques en innovant dans des approches méthodologiques permettant de rendre compte de la complexité du terrain et des communautés étudiées. Dans le même esprit, la recherche multimodale (qui implique le croisement des données visuelles, sonores ou audiovisuelles) valorise la pluralité des pratiques communicatives et s’inscrit dans une évolution sociotechnique où les messages monomodaux deviennent rares. Les projets de recherche, tout comme les pratiques sociales et éducatives, recourent en effet désormais à des formats hybrides – balados, vidéos, créations numériques –, qui contribuent à la production et à la diffusion de connaissances jugées créatives, pertinentes et pleinement légitimes (Boultif et al., 2021 ; Kress, 2010 ; Peters, 2025).
Axes de réflexion proposés
Dans le cadre de ce volume, trois axes autour desquels est pensée la réflexion thématique sont proposés. Dans toutes les approches méthodologiques visées par ces axes, l’usage de la multimodalité est au cœur des recherches menées en contextes linguistiques minoritaires. Dans ce contexte, ce volume met en avant trois approches méthodologiques : créatives, participatives et numériques. Les approches créatives ouvrent de nouveaux espaces d’expression, les approches participatives renforcent les liens avec les communautés et les approches numériques transforment les manières de documenter et de diffuser les savoirs. Ensemble, elles contribuent à mieux comprendre et à faire rayonner les recherches menées dans et avec les communautés linguistiques minoritaires.
Axe 1 : Approches méthodologiques créatives
De manière critique, cet axe interpelle les chercheurs·ses en contextes linguistiques minoritaires à une exploration des liens entre l’étude des langues et les choix méthodologiques qui influencent l’ensemble des processus multimodaux de la recherche. Dans les contextes linguistiques minoritaires, il arrive que les compétences linguistiques des locutrices et locuteurs de groupes minoritaires soient systématiquement comparées et jugées à l’aune de celles du groupe majoritaire, conduisant à un sentiment de ne jamais être à la hauteur (Gordon et al., 2022 ; Johnson et al., 2020). Afin de contrer en quelque sorte ce sentiment, nous proposons de concevoir tout ce qui est minoritaire comme étant une valeur ajoutée, à l’instar de la communication multimodale, qui s’avère efficace et enrichissante. Ainsi, nous encourageons des contributions de personnes chercheuses issues de communautés minoritaires qui mettent en lumière la richesse de méthodologies plurielles, mixtes, collaboratives et transdisciplinaires, telles que l’autoethnographie, l’autoethnographie collaborative (Cormier et Morneau, 2023 ; Pithouse-Morgan et al., 2025), la recherche-action, les méthodes basées sur les arts (Peters, 2025), l’artographie (Cormier, 2020; Deslauriers, 2022), les études critiques du discours multimodal (Mansouri et Parina, 2023), et la recherche-action, entre autres. Les contributions peuvent également porter sur l’usage et l’apport de la multimodalité dans ces méthodologies plurielles.
Axe 2 : Approches méthodologiques participatives
Cet axe s’intéresse aux méthodologies qui mobilisent et renforcent les liens avec les communautés linguistiques minoritaires. Dans une optique de recherche par et pour, ces approches visent des partenariats actifs, dynamiques, et ancrés dans les besoins réels (et les nuances, expériences authentiques) des communautés. Certaines personnes chercheuses adopteront un regard d’interactionnisme, qui soutient les interactions et les points de vue des différents acteurs d’une société (Le Breton, 2012 ; Morissette et al., 2011), d’autres une perspective transformatrice-émancipatrice qui engage les communautés minoritaires ou marginalisées dans tout le processus de recherche pour mener à des changements individuels et sociaux (Anadón, 2019 ; Mertens, 2021).
Les approches participatives sont propices à la multimodalité, car elles soutiennent un rapport entre la personne chercheuse et les actrices et acteurs de la communauté. L’usage de la multimodalité permet de diversifier les moyens de participation et d’expression et de valoriser des formes de savoirs trop souvent invisibilisées (Literat et al., 2018). Elles permettent également de co-construire les connaissances et de définir collectivement l’objet de la recherche (Bergold et Thomas, 2012) tout en mettant la voix et les perspectives des participantes et participants de l’avant sous différentes formes (orale, écrite, visuelle et incarnée) (Aru et al., 2017 ; Ruiz-Pérez, 2023). Nous pouvons penser à des méthodes de recherche-action, de recherche-intervention, de la recherche basée sur la conception (design-based research), mais également des méthodologies de recherche autochtones et de recherche communautaire (community-based research).
Axe 3 : Approches méthodologiques numériques
Cet axe invite à explorer comment les environnements et outils numériques, qu’ils s’agissent de plateformes collaboratives, de dispositifs immersifs, de réseaux sociaux, d’archives numériques ou d’outils d’intelligence artificielle générative, transforment et enrichissent les recherches menées dans des contextes linguistiques minoritaires, quels que soient leurs domaines thématiques. Production audiovisuelle, analyse de données multimodales, narration interactive, visualisation de données ou encore diffusion hybride des résultats : ces nouveaux formats transforment les manières de documenter et de partager les savoirs. Toutefois, ils soulèvent aussi des questions éthiques sur la représentation, la hiérarchisation des langues, l’accessibilité, et la visibilité des voix minoritaires dans des environnements marqués par des normes dominantes (Domeij et al., 2019 ; Eberhard et Mangulamas, 2022 ; Soria, 2016).
Nous proposons de s’intéresser aux imaginaires du numérique (Rochefort, 2003) mobilisés par les personnes chercheuses et les communautés elles-mêmes, entendus comme l’ensemble des visions, pratiques et stratégies par lesquelles elles se réapproprient les espaces et les outils numériques pour mener, analyser, et diffuser leurs recherches, mais aussi pour contribuer à transformer la société.
Types de contributions acceptées
Les contributions peuvent provenir de toutes disciplines et de tous contextes de recherche. La soumission de formats d’articles multimodaux est encouragée, qu’ils s’agissent de textes enrichis d’éléments visuels (images, photographies) ou sonores (audio et vidéo par hyperlien) ou de recours à des données multilingues. Nous encourageons particulièrement la participation de personnes chercheuses à différents stades de leur carrière, incluant les personnes étudiantes aux études supérieures. La documentation de pratiques est aussi permise à la revue (voir forme 4P).
Modalités de soumission
Les propositions d’articles doivent compter environ 500 mots (sans compter les références). Chaque proposition doit inclure :
- un résumé de la contribution envisagée ;
- une brève liste de références ;
- une courte biographie de la personne autrice (quelques lignes, permettant de mieux situer vos thématiques de recherche).
Les propositions sont à envoyer directement à la revue à l’adresse suivante : revuemultimodalites@gmail.com.
Calendrier prévisionnel
- Date limite pour l’envoi des propositions : le 6 mars 2026
- Réponse aux personnes autrices : mars 2026
- Date de remise des articles complets : juin 2026
- Parution prévue du volume : hiver 2027
Format de l’article final
- Longueur : 40 000 à 60 000 caractères, espaces compris (environ 10 à 20 pages, sans compter les références et annexes).
- Formats acceptés : Word (.doc, .docx) ou Open Document (.odt).
- Les images, vidéos ou autres médias doivent être libres de droits ou soumis avec autorisation. Ils devront être envoyés séparément à la revue.
Les consignes complètes pour la soumission d’un article sont disponibles sur le site de la revue, section « Soumettre un article ».
Anadón, M. (2019). Les méthodes mixtes : Implications pour la recherche « dite » qualitative. Recherches qualitatives, 38(1), 105. https://doi.org/10.7202/1059650ar
Aru, S., Memoli, M., et Puttilli, M. (2017). The margins ‘in-between’: A case of multimodal ethnography. City, 21(2), 151‑163. https://doi.org/10.1080/13604813.2017.1353337
Bergold, J., et Thomas, S. (2012). Participatory research methods: A methodological approach in motion. Historical Social Research (Köln), 37(4 (142)), 191‑222. https://doi.org/10.12759/hsr.37.2012.4.191-222
Boultif, A., Deraîche, M., Collin, S., Bangou, F., Boutin, J.-F., et Lacelle, N. (2021). Discussion académique sur le New London Group et les multilittératies : Réflexions de chercheurs francophones et perspectives contemporaines. OLBI Journal, 11, 289310. https://doi.org/10.18192/olbij.v11i1.6184
Cormier, G. (2020). L’harmonie de la musique et l’identité linguistique : L’a/r/tographie avec des futurs enseignants. McGill Journal of Education / Revue des sciences de l’éducation de McGill, 55(3). https://mje.mcgill.ca/article/view/9794
Cormier, G., et Morneau, M.-J. (2023). Une recherche collaborative favorisant l’intégration de l’oral lors de la formation initiale en mode virtuel. Journal of the Canadian Association for Curriculum Studies, 20(2‑3), Article 2‑3. https://doi.org/10.25071/1916-4467.40776
Cotnam-Kappel, M. et Ciocca, J. L. (2024). Les inégalités d’accès, de compétences et de pouvoir d’agir numériques et linguistiques des élèves : perspectives du personnel enseignant en Ontario français. Minorités linguistiques et société, (23). https://doi.org/10.7202/1114153ar
Cotnam-Kappel, M. et Woods, H. (2020). La participation en ligne en Ontario français : pistes de réflexion et d’action pour redéfinir la francophonie avec et pour les jeunes. Éducation et francophonie, 48(1), 144-163. https://doi.org/10.7202/1070104ar
Deslauriers, A. (2022). Le corps engagé dans la création en relation avec la nature. Dans H. Duval, C. Raymond et D. Odier-Guedj (dir.), Engager le corps pour enseigner et apprendre (p. 203‑226). Presses de l’Université Laval. https://doi.org/10.2307/j.ctv30dxxgm.12
Domeij, R., Karlsson, O., Moshagen, S. et Trosterud, T. (2019). Enhancing information accessibility and digital literacy for minorities using language technology—the example of Sami and other national minority languages in Sweden. Dans C. Cocq et K.P.H. Sullivan (dir.) Perspectives on Indigenous writing and literacies (p. 113–137).
Eberhard, D. et Mangulamas, M. (2022). Who texts what to whom and when? Patterning of texting in four multilingual minoritized language communities and a preliminary proposal for the language repertoire matrix. International Journal of the Sociology of Language, 2022 (276), 169–205. https://doi-org.proxy.bib.uottawa.ca/10.1515/ijsl-2021-0065
Gordon, N., Demers, C., Chehayeb, R., et MacLeod, A. A. N. (2022). Parents’ Perceptions of Barriers and Facilitators to Their Children’s Multilingual Language Development Before and After the COVID-19 Pandemic. Canadian Ethnic Studies, 54(3), 151‑176.
Johnson, D. C., Johnson, E. J., et Hetrick, D. (2020). Normalization of language deficit ideology for a new generation of minoritized U.S. youth. Social Semiotics, 30(4), 591‑606. https://doi.org/10.1080/10350330.2020.1766210
Le Breton, D. (2012). L’interactionnisme symbolique. P.U.F.
Literat, I., Conover, A., Herbert-Wasson, E., Kirsch Page, K., Riina-Ferrie, J., Stephens, R., Thanapornsangsuth, S., et Vasudevan, L. (2018). Toward multimodal inquiry: Opportunities, challenges and implications of multimodality for research and scholarship. Higher Education Research & Development, 37(3), 565‑578. https://doi.org/10.1080/07294360.2017.1389857
Mansouri, M. E., et Parina, J. C. M. (2023). The battle cry of resistance against inequality and injustice: A multimodal critical discourse analysis. Journal of Ethnic and Cultural Studies, 10(3), 128‑143.
Mertens, D. M. (2021). Transformative research methods to increase social impact for vulnerable groups and cultural minorities. International Journal of Qualitative Methods, 20, 1‑9. https://doi.org/10.1177/16094069211051563
Morrissette, J., Guignon, S., et Demazière, D. (2011). De l’usage des perspectives interactionnistes en recherche. Recherches qualitatives, 30(1), 1‑9. https://doi.org/10.7202/1085477ar
Peters, B. (2025). Arts-based multiliteracies for teaching and learning. Dans Https://services-igi-global-com.uml.idm.oclc.org/resolvedoi/resolve.aspx?doi=10.4018/979-8-3693-3184-2. IGI Global. https://www.igi.global.com/gateway/book/335077
Pithouse-Morgan, K., van Laren, L., et Masinga, L. (2025). Professional learning through arts-inspired collaborative self-study: Growing from the inside out with rippling effect. Studying Teacher Education, 21(1), 7‑21. https://doi.org/10.1080/17425964.2024.2440358
Rochefort, J. C. (2003). Présentation. Imaginaires du numérique. Spirale, (188), 12-13.
Ruiz-Pérez, S. (2023). Multimodal student voice representation through an online digital storytelling project. CALICO Journal, 40(3), 335‑356. https://doi.org/10.1558/cj.24741
Soria, C. (2016). What is digital language diversity and why should we care? LinguaPax review 2016: Digital Media and Language Revitalization, 13–28. https://hdl.handle.net/20.500.14243/337284
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net