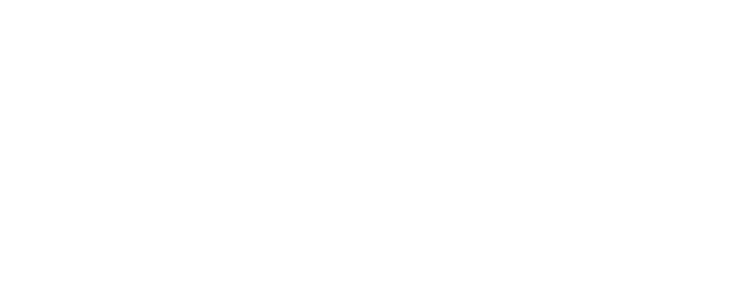Entretien avec Thomas-Louis Côté, directeur de l’organisme Québec BD

Virginie
Bonjour, Thomas-Louis, nous te remercions d’avoir accepté notre invitation. Nous souhaitions te rencontrer aujourd’hui, puisque nous désirons, dans le cadre du premier volume Variation(s) de la revue Multimodalité(s) – où nous agissons comme membres du comité de direction –, intégrer un entretien mené avec une personne engagée dans la médiation d’objets culturels multimodaux, dont la BD.
Dans le cadre du présent entretien, nous souhaitons connaître davantage Québec BD (Annexe 1) en tant qu’organisme de médiation culturelle, mais nous désirons aussi t’entendre parler de ton expérience plus personnelle au sein du monde de la bande dessinée et de sa promotion.
Jean-François
Si tu le veux bien, Thomas-Louis, je vais te tutoyer comme nous le faisons déjà depuis longtemps, étant donné nos collaborations passées, entre autres via le LIMIER, un regroupement de recherche qui s’intéresse à la littératie, plus spécifiquement à l’apport éducatif et social des œuvres de littérature illustrée, dont les bandes dessinées. En premier lieu, pourrais-tu nous donner un aperçu de ton parcours et des raisons qui expliquent que tu sois à la tête de Québec BD depuis de nombreuses années ?
Thomas-Louis
C’est un hasard, en fait ! Mon parcours est assez varié, puisque j’ai étudié au cégep Garneau en arts, un programme général, je suis allé ensuite en communication à l’Université Laval. Je voulais aller en publicité, mais finalement, le profil qui s’est dessiné sans trop que je le choisisse, c’est celui des relations publiques. En sortant de l’université, j’ai eu un premier emploi à Montréal dans ce domaine alors que je cherchais en publicité. Je suis allé travailler dans le monde du vin et de l’hôtellerie.
Virginie
Complètement un autre domaine en effet.
Thomas-Louis
Oui, mais cette première expérience professionnelle a marqué ce que je fais encore aujourd’hui, notamment parce que, là aussi, c’était une boite où il n’y avait que la patronne et moi, donc une petite organisation. Ça m’a amené à tout faire, à toucher à plusieurs aspects, et nos client·e·s étaient à l’international. Montréal étant plus bilingue, j’ai aussi travaillé dans les deux langues. J’ai bâti, dès cette première expérience, un réseautage à l’international. J’ai finalement quitté ce poste pour revenir à Québec dans le domaine culturel. Je suis allé travailler au Théâtre Périscope comme responsable des communications pendant quatre ans et demi. En marge, je faisais des contrats à la pige en relations de presse, par exemple pour le Mois Multi, Canards illimités, pour des éditeur·rice·s, dont les éditions GID, etc. Je suis curieux, soit dit en passant, ce qui explique cette variété. De même, quand j’embarque dans des sujets, j’embarque vraiment.
Jean-François
Donc, dès ton deuxième emploi, tu étais dans le domaine culturel ?
Thomas-Louis
Oui, via le Théâtre Périscope, mais aussi par des contrats pour, par exemple, le complexe Méduse, une coopérative de producteur·rice·s et diffuseur·ses artistiques, culturel·les et communautaires ouverte depuis 1995. De côtoyer ainsi plusieurs milieux m’a amené à me bâtir assez rapidement un très beau réseau de contacts, très varié, parfois même des gens avec qui je travaille encore aujourd’hui qui, elleux aussi, ont migré vers d’autres emplois, d’autres secteurs.
LE FESTIVAL DE LA BD DE QUÉBEC
Jean-François
Parle-nous du festival de la bande dessinée de Québec, où tout a débuté pour toi et même pour Québec BD.
Thomas-Louis
En fait, le festival, je le fréquente depuis 1999 comme participant. C’est un festival que j’avais découvert par hasard à Place Fleur-de-Lys (un centre commercial de la ville de Québec), avec des bédéistes comme François Boucq. J’y ai découvert que les bédéistes faisaient des dessins en dédicaces, et je me suis ajouté aux collectionneur·se·s déjà nombreux·ses qui le fréquentaient. J’ai participé à l’événement pendant quelques années comme ça, peut-être plus pour les rencontres humaines que les signatures, et une année, alors qu’il était rendu à Place Laurier (un autre centre commercial de la ville de Québec), les auteur·rice·s se sont mis·e·s à me parler, en tant que simple festivalier, de leur mécontentement. Quand c’est rendu que les auteur·rice·s se plaignent au public, il y a un problème sérieux. Comme j’étais au théâtre Périscope à ce moment, mais que j’aimais la BD, je me suis dit que je pourrais m’impliquer pour donner un coup de main. J’ai donc d’abord occupé un poste sur le Conseil d’Administration (CA) du festival : il y avait alors trois personnes sur le CA, et l’enjeu du déplacement du festival au Salon du livre [de Québec] créait des tensions, d’autant que ce changement était en quelque sorte imposé par les bailleur·se·s de fond.
Jean-François
Une exigence de « sortir » le festival des centres commerciaux, en soi ?
Thomas-Louis
Oui, pour avoir des fonds et s’arrimer davantage au calendrier des éditeur·rice·s qui devaient aussi se déplacer pour le Salon international du livre de Québec (SILQ), qui suivait la semaine d’après. Le festival était initialement une semaine ou deux avant le Salon du livre de Québec.
Jean-François
C’est vrai, ils n’étaient pas en simultané.
Thomas-Louis
Non, et iels n’étaient pas très content·e·s de ça. On a donc organisé, avec l’aide de nouvelles personnes embauchées pour cela, une nouvelle mouture du festival en quelques mois. Quand le premier festival à se tenir au Salon du livre s’est terminé, le directeur a démissionné et mon poste au théâtre Périscope a été en même temps aboli. J’ai ainsi été invité par le CA à prendre la direction du festival BD en juin 2005. J’ai alors pris la direction du festival et donc de Québec BD. J’ai longtemps dirigé à temps partiel, en marge d’autres choses, jusqu’à ce que le poste devienne un temps plein, il y a sept-huit ans.
Jean-François
Ce « temps plein » est lié à l’obtention d’un financement récurrent ?
Thomas-Louis
Ce changement est surtout lié à l’augmentation du nombre d’activités menées. J’ai longtemps été à la pige et j’avoue que je faisais les choses par passion, ne comptant pas mes heures. En parallèle, je travaillais aussi au Service de la culture de la ville de Québec, ce qui m’a aussi permis de bonifier mes réseaux de contacts et de mieux comprendre les coulisses. Car, il faut le dire : je n’ai aucune formation en gestion culturelle, aucune formation en gestion, point. Je n’ai pas un parcours qui m’orientait vers ça.
Jean-François
Et, pourquoi as-tu décidé de plonger et de rester dans le domaine ? Est-ce que c’est l’objet comme tel de la BD ou c’est plus l’écosystème ?
Thomas-Louis
Je pense que c’est plus l’écosystème. Ce sont les gens de ce milieu, les défis au regard de la promotion de la BD qui m’intéressent. Le fait aussi de pouvoir me renouveler, d’élaborer de nouveaux projets. Il y a toujours quelque chose qui est stimulant.
Jean-François
Il n’y a pas de répétition…
Thomas-Louis
En fait, oui, il y en a. À la limite, le festival se répète d’année en année, mais les activités sont renouvelées.
Jean-François
En fait, le festival de la BD, dans sa mouture actuelle, c’est un peu ton bébé. On peut dire que tu l’as franchement amené à maturité en le renouvelant justement ?
Thomas-Louis
Ce n’est pas moi qui l’ai parti, il est né en 1988, mais, tel qu’il se vit présentement, oui, c’est davantage moi qui ai pu le développer en ce sens. Je suis parti des fondations et j’ai monté la maison.
Les motivations initiales n’étaient pas les mêmes que celles qui m’animent aujourd’hui. Par exemple, la recherche de dédicaces était la motivation première de la première vague des festivalier·ère·s et de certain·e·s de ses directeur·rice·s. À cet égard, le Festival de la BD francophone de Québec a été mis en place par Réal Fillion, qui était collectionneur et propriétaire d’une librairie, Le Royaume de la BD. La directrice marketing de Place Fleur-de-Lys était aussi impliquée, puisqu’il s’agissait aussi de bâtir un événement promotionnel pour le centre commercial. C’était financé presque 100 % par Place Fleur-de-Lys. Et, c’était géré par Réal, le plus grand collectionneur de BD [de la région]. Dans les années avant de mourir, il a vendu sa collection à la Bibliothèque Gabrielle-Roy : 12 000 albums, ce qui à l’époque était énorme.
Quand j’ai pris de mon côté la tête du festival, j’ai d’abord jugé important de refaire les liens avec les éditeur·rice·s. Pour ça, une des premières choses que j’ai faites, c’est de monter à Montréal rencontrer les éditeur·rice·s et les distributeur·rice·s pour voir quels étaient les problèmes ou enjeux, mais aussi pour travailler mieux avec elleux. Il est très important pour moi de créer des liens de confiance. Créer aussi des liens avec les auteur·rice·s. Quand tu es en bons termes avec les gens, c’est vraiment précieux.
Aujourd’hui, j’ai un réseau personnel autant à Québec qu’à l’étranger, ce qui entraîne des projets très stimulants, pour le festival et pour Québec BD plus largement. De plus, à force de faire des projets, d’autres arrivent. Prépandémie, par exemple, j’avais semé beaucoup de graines pour des projets qui devaient se concrétiser en 2020, des projets de collaborations à l’international qui devaient avoir lieu et qui, finalement, ont dû être abandonnés. Certains ont été repris après. Mais, comme ce fut le cas pour beaucoup de monde, on était sur une lancée et après, on a vécu un creux. Il faut maintenant se relancer, je retrouve les projets, les choses se replacent et le développement se poursuit. Toutefois, la relève n’est pas simple à trouver. Pour créer du nouveau et aller encore plus loin, ça prend de la relève et c’est actuellement un défi auquel je dois m’attarder.
LA CRÉATION DE QUÉBEC BD
Virginie
L’organisme Québéc BD voit le jour à quel moment ? Je comprends qu’il est responsable du festival, mais quelles étaient ses missions d’ensemble ?
Thomas-Louis
L’organisme, qui à la base s’appelait Festival de la BD francophone de Québec, a été fondé en 1999 alors que le festival existait depuis 1988. Moi, je suis arrivé à la 18e édition du festival, en 2005, et on a commencé à utiliser le nom plus général de Québec BD vers 2016. Le festival a changé de nom en 2018, à la 31e édition. À la base, l’organisme a été créé pour le festival, pour prendre le relais de l’équipe marketing du centre commercial de Place Fleur-de-Lys. Québec BD s’est toutefois assez rapidement développé avec un mandat qui va au-delà du festival, soit d’organiser des événements pour faire la promotion de la BD. Des événements pour le public, mais aussi, organiser des choses pour les gens du milieu.
Jean-François
Par exemple, la BDthèque mobile ?
Thomas-Louis
Oui. La BDthèque mobile (Annexe 2) vise la promotion de la BD auprès du grand public. Elle a vu le jour grâce à un financement de la ville de Québec, pour offrir des animations dans les camps d’été (ou centres aérés). Toutefois, son existence sur le terrain à chaque été est conditionnelle au financement, que ce soit public ou privé. Par exemple, le deuxième été, il n’a pas été possible d’obtenir du financement. Mais, on a fait jusqu’à 50 sorties dans l’été suivant où, justement, on a reçu du financement.
La conception d’expositions durant l’année est aussi une des activités qui nous occupe, par exemple l’exposition actuelle Les imaginaires de la jeunesse – Tome 2, réalisée avec notre collaboration. Pour l’occasion, le Centre d’interprétation historique de Sainte-Foy, un lieu patrimonial, s’est transformé en terrain de jeu ludique qui célèbre les bandes dessinées et les albums illustrés qui ont marqué l’imaginaire des enfants depuis des décennies. Il y a aussi l’exposition récente 20 visages de la BD à Québec, qui fait explicitement la promotion des créateur·rice·s de la ville. On pourrait aussi parler de la Ligue québécoise d’impro BD ou des résidences d’auteur·rice·s que l’on met en place.
Jean-François
Et donc, le festival de la BD à Québec est une activité parmi les autres aujourd’hui.
Thomas-Louis
Oui, bien que ce soit une activité majeure. Et, la présence du Festival Québec BD au Salon international du livre de Québec est aujourd’hui le point central d’un festival qui est présent dans une trentaine d’autres lieux et activités offertes, entre autres dans les deux grands musées de Québec (le Musée de la civilisation et le Musée des beaux-arts), dans des espaces culturels, des cafés, etc. Il faut faire attention : le festival ne se réduit pas aux kiosques présents au Salon du livre de Québec. Au Salon, Québec BD est un partenaire et un exposant. Il y loue des espaces, et nous avons une entente pour les espaces d’animation avec un partage des coûts pour celui-ci. De mon côté, je loue à rabais ces espaces dans notre zone aux exposant·e·s (principalement des maisons d’édition québécoises en BD) pour être certain d’assurer l’accessibilité et leur présence.
Virginie
Alors, tout l’espace du Salon international du livre de Québec, où les éditeur·rice·s de BD du Québec sont exposant·e·s, sans compter l’espace de vente de BD de Québec BD, est sous la responsabilité de Québec BD ?
Thomas-Louis
En fait, il y a d’autres éditeur·rice·s et distributeur·rice·s de BD présent·e·s au Salon en dehors de nos espaces, mais ce sont des partenaires que l’on implique dans l’événement. De notre côté, j’avais 21 kiosques loués cette année et je travaille avec celleux qui ont déjà leur place. Parce que l’idée de base derrière cette stratégie, mise en place il y a quelques années, était d’augmenter le nombre d’exposants en BD. Par exemple, il a quelques années, il n’était pas facile pour de nouvelles maisons d’édition comme Pow Pow ou Moëlle Graphik d’être présentes, étant donné le coût de location. Le monde éditorial de la BD au Québec a toutefois évolué et plusieurs maisons d’édition qui sont avec nous depuis des années sont aujourd’hui plus solides, mais on continue de les soutenir. Certaines maisons d’édition sont cependant déjà présentes, parfois de façon autonome ou avec leurs distributeur·rice·s, sans être dans nos espaces. D’autant plus qu’il y a maintenant plusieurs éditeur·rice·s qui font de la BD, en plus de produire bien d’autres types de livres, par exemple Éco-Société et Michel Quintin. Je trouve bien d’avoir de la BD partout au Salon international du livre de Québec.
Il est certain que, si tu compares au festival de BD de Montréal, celui-ci a une latitude beaucoup plus grande dans ses espaces pour accueillir des éditeur·rice·s étranger·ère·s, notamment des éditeur·rice·s indépendant·e·s qui veulent se faire connaître au Québec. Toutefois, les grandes maisons, comme les éditions du Lombard, Futuropolis ou Glénat, comme à Québec, sont plutôt présentes avec leurs diffuseur·se·s.
Il demeure toutefois que le mandat principal de notre organisme est tourné vers la BD d’ici, bien qu’on soit très heureux de collaborer avec les maisons d’édition à l’étranger, comme on le fait depuis nos débuts.
Jean-François
En même temps, étant donné une certaine hégémonie de la BD francophone européenne, tu n’as pas le choix, non ?
Thomas-Louis
En priorisant la BD québécoise, c’est en quelque sorte le retour du balancier d’une époque où le festival mettait beaucoup de l’avant les créateur·rice·s en visite au détriment des artistes locaux·les. Aujourd’hui, on accueille [des] bédéistes étranger·ère·s, et iels ont une belle place dans notre programmation, mais on tente toujours d’offrir une vitrine au plus grand nombre de créateur·rice·s d’ici. Les choix de programmation se font en ce sens. Et, il y a aujourd’hui beaucoup de choix, tant pour les auteur·rice·s qui publient au Québec que pour les Québécois·es qui publient à l’étranger. Cela dit, je ne me verrais pas mettre à l’honneur un·e artiste ou une maison d’édition étrangère, comme ça se faisait dans le passé, en mettant, pour ce faire, de côté la présence québécoise. L’idée, c’est de trouver l’équilibre.
Mais vraiment, ce qui est intéressant quand même, c’est qu’on est passé de la pratique de faire venir les auteur·rice·s d’Europe pour créer l’événement et intégrer par la bande des auteur·rice·s québécois·e·s à la mise en lumière réelle et pleinement assumée de la BD québécoise avec, en bonus, pour compléter la programmation et participer à la promotion de la BD, l’intégration d’artistes étranger·ère·s.
Virginie
C’est en effet une grande réussite de la mission de Québec BD.
Thomas-Louis
Oui, en effet. Il reste toutefois important aussi de créer l’échange, et de mettre en lien les auteur·rice·s québécois·es avec celleux de l’étranger pour collaborer, par exemple, sur des spectacles et expositions. Les résidences d’auteur·rice·s permettent aussi de créer ces liens avec des auteur·rice·s connu·e·s ou moins connu·e·s. Cela permet de très belles rencontres.
Virginie
Et, le financement de Québec BD ?
Thomas-Louis
Des fonds multiples financent un organisme comme Québec BD. Le fédéral, le provincial comme le municipal et des revenus autonomes, par exemple des entrées de revenus par le biais de la vente de BD à l’espace Québec BD, pendant le Salon international du livre du Québec, y contribuent, tout comme des contrats au courant de l’année où notre expertise est sollicitée.
Jean-François
C’est vrai, vous procédez aussi à la vente de BD pendant le salon.
Thomas-Louis
Oui, initialement, nous avions un partenaire pour cela, mais il était difficile de contrôler ce qui était vendu ou l’espace occupé. On a eu, par exemple, des plaintes de parents parce que les jeunes pouvaient acheter autre chose que des livres, par exemple des produits dérivés, comme des cartes ou des bonbons. Les jeunes avaient donc 20 $ dans leurs poches pour le Salon mais ils revenaient avec des objets.
C’est en effet précieux et lucratif de vendre des objets dérivés des collections ou des personnages de BD. On l’a bien vu quand on a fait le Pavillon BD Québec. On avait au pavillon une librairie et un peu de produits dérivés, et franchement, c’est payant. Même chose quand on a été au Comiccon pendant deux années : ce qui se vendait beaucoup, c’étaient les produits dérivés. Mais, ce n’est pas notre mission première. Je préfère vraiment choisir ce que je mets de l’avant, en plus d’assurer une rentrée d’argent pour l’organisme, ce qui nous donne une liberté ailleurs.
On répond en même temps à un besoin, notamment de partenaires qui ne peuvent être présent·e·s avec leurs livres. J’ai actuellement un espace de huit kiosques pour la librairie Québec BD pendant le Salon international du livre de Québec ; en ayant le contrôle de celui-ci, je peux faire le choix de l’agrandir. Ce qu’on va faire d’ailleurs.
Le fait de prendre en charge nous-mêmes la librairie évite, en plus, de produire des tensions avec nos partenaires libraires de la ville de Québec. On inclut davantage tout le milieu. Cette année, par exemple, la Librairie Pantoute donnait une bourse, on avait des animations à la librairie Laliberté et Le mot de tasse, toutes des librairies indépendantes de la ville. Ainsi, on est capable de travailler avec tout le monde, on évite l’exclusivité et on remplit mieux, je crois, notre mandat.
On a aussi le projet d’avoir un espace permanent Québec BD et, dans celui-ci, on souhaiterait installer une petite librairie. Mais, encore une fois, il faut éviter d’établir une compétition avec ce qui se fait ailleurs et c’est possible que ce soit le cas. C’est donc à l’étude. On souhaite toujours être complémentaire, puisqu’on travaille avec tous les acteur·rice·s de la chaine du livre à l’année.
Virginie
C’est un réel et constant travail de collaboration avec le milieu ?
Thomas-Louis
Absolument. Le fait de tenir le festival et de promouvoir la BD pendant le Salon aide à faire venir des partenaires qui n’y seraient pas nécessairement. Par exemple, la Librairie Première issue est au festival depuis quelques années et c’est la seule qui vend du comic book au festival. Elle rejoint un autre public en collaborant avec nous et elle est ravie d’être là.
LA PLACE DU NUMÉRIQUE ET DES FORMES ÉMERGENTES EN BD
Jean-François
Dans la mission de Québec BD, les activités et événements offrent une large place à la bande dessinée imprimée. Est-ce qu’il y a de la place tranquillement, ou avez-vous déjà essayé d’aller vers du numérique, des formes émergentes en BD ?
Thomas-Louis
On y arrive progressivement. On a eu des expos sur la BD numérique, des projets en RV [réalité virtuelle] et en réalité augmentée et l’on tient des événements où le numérique ou les autres formes artistiques sont mobilisés, par exemple l’improvisation dessinée. Il y a cependant encore beaucoup d’explorations à faire par rapport à ça. Ce qui s’en vient, ce qu’on devra de plus en plus considérer à mon avis, c’est le webtoon (un nom emprunté à la plateforme de publication dominante de bandes défilées) qui modifie de plus en plus les pratiques de lecture et de consommation, notamment des jeunes.
Je suis allé cet automne en Corée du Sud dans la ville de Bucheon, ville littéraire de l’UNESCO, comme Québec. Dès 2019, nous avions un projet de collaboration avec cette ville, qui a été reporté par la pandémie. Cette année, nous avons réussi à y envoyer en résidence le bédéiste Paul Bordeleau, et j’ai actuellement une autrice coréenne en résidence à Québec. De mon côté, j’y suis allé cet automne pour participer au Bucheon International Comics Festival, le plus grand festival de bande dessinée et webtoon en Corée. J’y suis aussi allé pour voir le Musée du manhwa, mais également pour voir la place que le webtoon a prise là-bas. En fait, le livre format papier semble avoir été supplanté ou est en voie de l’être. Assurément, en tous les cas, les choses bougent.
Jean-François
Ah oui, tu sens cela ?
Thomas-Louis
Bien, un festival comme le BICOF, c’est un festival de comics et je cherchais les kiosques de libraires ou de livres. C’étaient plutôt des universités avec des programmes de webtoon, des entreprises de webtoon, du cosplay… C’est une autre réalité.
Virginie
Il y a donc vraiment une transition qui s’opère ?
Thomas-Louis
C’est très fort là-bas en tous les cas. Et, quand on participe à une journée de discussion là-dessus, au Japon, qui est un pays très « populeux » par rapport à nous, ils parlaient de 1,4 milliard de chapitres vendus en webtoon dans l’année ! On n’était pas dans de petits chiffres. Et, ce sont généralement, mais pas exclusivement, des consommateur·rice·s de mangas qui sont en train de se tourner vers le webtoon.
Jean-François
Et donc, vers le numérique ?
Thomas-Louis
Oui, on est rendu à la BD en 80 cases, 3-4 minutes de lecture.
Virginie
La sens-tu au Québec, cette transition ?
Thomas-Louis
Non, pas encore. Il y avait une créatrice de webtoon qui était au festival de Québec cette année : Kiri. Elle est à 100 000 abonné·e·s en France et c’est la plus « populaire » en France, en termes de contenu. C’est, cependant, une tout autre approche de consommation – je me dis parfois que c’est un peu une sorte de « netflixication » de la BD. C’est basé, entre autres, sur un abonnement à des services, à des plateformes de webtoon.
Webtoon Naver, qui est une très grosse entreprise coréenne, a acheté Wattpad à Toronto pour faire le pont avec le marché américain. En France, il y a aussi Webtoon Factory, qui occupe une place importante dans ce nouveau marché. Donc, je crois que oui, ça va commencer à se développer ici aussi.
C’est assurément intéressant le webtoon, mais personnellement, ça me fait peur aussi. En Corée, j’ai pu constater que les créateur·rice·s semblent peu connu·e·s, iels sont peu mis·e·s de l’avant. Tu fais une série, mais le ou les créateur·rice·s ne font pas nécessairement le festival, comme c’est un peu déjà le cas avec des séries de manga. En webtoon, c’est la série qui parait porteuse. Et, les compagnies qui produisent ce contenu ne font pas nécessairement d’argent avec le webtoon ; elles font de l’argent avec la série animée, parfois des publications papier, des objets liés, etc.
Virginie
Les produits dérivés, donc ?
Thomas-Louis
Oui, et avec les propriétés intellectuelles. Les entreprises créent des personnages avec l’objectif de les amener ailleurs. C’est une autre vision de la création artistique par rapport à ce qu’on a connu jusqu’à aujourd’hui avec la BD, en tous les cas, en Europe et au Québec. De même, la création de webtoons se fait souvent en studio, ce qui est aussi différent, tout comme la part de l’intelligence artificielle qui m’apparait difficile à établir.
Jean-François
On y mobilise l’intelligence artificielle générative ?
Thomas-Louis
Nous sommes allés rencontrer une entreprise menée par des Français qui sont financés par Samsung à hauteur de deux cents millions. L’objectif de la compagnie est de réduire le temps de production d’un webtoon de 60 heures à six heures. Ils créent des outils qui sont accessibles en ligne, que tu peux utiliser facilement, pour réduire le temps, mais aussi possiblement aider les créateur·rice·s. Tu imagines tous les webtoons qui pourraient être produits à cette vitesse : plus de 80 cases par semaine, tu vas passer à 80 par jour ? Et ça, c’est sans compter le moment – si ce n’est pas déjà le cas – où l’on pourra simplement rentrer des keywords pour générer un webtoon.
Jean-François
C’est préoccupant aussi pour la distribution et, plus largement, l’industrie du livre ?
Thomas-Louis
Oui, mais de manière générale, et avec ou sans ça, notre chaine du livre est précaire. Elle est basée sur le modèle suivant : les auteur·rice·s qui créent ont un 10 %, les libraires ont 40 %. Une fois que le modèle change, oui, nécessairement, toute l’industrie du livre va changer. Déjà, on est chanceux ici d’avoir autant de librairies. Mais, nous vivons dans un contexte où les auteur·rice·s parlent souvent de leur manque de reconnaissance de leur création et donc de leur travail, en termes financiers. Il en va de même pour tous les autres métiers associés à la création (les coloristes, par exemple). Ce sont elleux qui gagnent le moins dans la chaine du livre. Celleux qui gagnent le plus, ce sont vraiment les libraires. Car, les frais pour tenir une librairie sont grands. Dans un contexte où tu crées et que tu n’as pas besoin de libraires parce que tu vends à des plateformes de contenu, cela pourrait être possiblement plus avantageux pour les créateur·rice·s.
Il demeure toutefois que les gens de la chaine actuelle du livre ont des rôles qui aident les œuvres à trouver leur public.
TENDANCES DE CONSOMMATION EN BD
Jean-François
Tu évoquais tout à l’heure les mangas. Ils occupent actuellement toujours une place importante pour Québec BD ?
Thomas-Louis
Au Québec, le manga a presque 40 % de la part des ventes en BD, en France c’est plus de 50 %. Les jeunes en sont les plus grand·e·s consommateur·rice·s.
Virginie
Justement, est-ce que tu vois, dans les événements auxquels tu participes ou que tu mets en place, un changement de tendance chez les jeunes lecteur·rice·s ?
Thomas-Louis
Assurément, le manga occupe encore une place importante. Je constate toutefois que la part prise par la BD québécoise est plus importante. L’effet l’Agent Jean.
Jean-François
Ah oui, tu vas même jusqu’à parler d’un effet l’Agent Jean ?
Thomas-Louis
Quand tu regardes les rapports Gaspard, c’est un sujet de recherche en soi. Quand tu regardes les trente BD les plus vendues et que, dans les titres les plus vendus de certaines années, plus de la moitié sont d’Alex A., c’est parlant. En 2019, par exemple, dans le top 200, il y avait… 22 titres d’Alex A., soit plus de 10 % des titres les plus vendus qui sont d’un seul auteur ! Et pourtant, on ne le voit jamais à Tout le monde en parle, une émission qui aborde des sujets d’actualité culturelle et qui invite des personnalités publiques importantes.
Virginie
Parce qu’il est dans la culture « jeune » ?
Thomas-Louis
Oui, je pense. En 2022, de mémoire, le tome Saison 2 • Volume 5 de l’Agent Jean a été réédité en format cartonné. Or, la version souple ET la version cartonnée sont parmi les meilleurs vendeurs. Quand tu observes l’augmentation des parts du marché des éditeur·rice·s québécois·es dans le milieu de la BD, je pense donc important de considérer cette popularité de l’Agent Jean. Sans cette série, les chiffres seraient différents.
Virginie
Oui, c’est en effet une grosse locomotive. Est-ce que tu crois que les lecteur·rice·s de l’Agent Jean vont ensuite lire des œuvres de Pow Pow, de Mécanique générale et autres maisons d’édition québécoises spécialisées en BD ?
Thomas-Louis
Peut-être en vieillissant, mais peu le font actuellement, du moins je ne l’observe pas. Il est certain que toute une jeune génération de lecteur·rice·s québécois·es n’aura plus comme référence Tintin, Kid Paddle et autre. Ce sera l’Agent Jean. À mon avis cependant, les jeunes d’aujourd’hui vont continuer à s’intéresser à ce qui se fait au Québec, ce qui est formidable, et ils vont donner à leurs enfants leurs Alex A. qu’il·elles lisaient quand il·elles étaient jeunes, comme nos parents nous ont donné leurs Tintin.
Virginie
Est-ce que tu vois des évolutions chez le lectorat adulte par rapport à la BD ?
Thomas-Louis
J’observe que les 30-45 ans, mais aussi une grande partie des gens intéressés à la BD, me paraissent particulièrement sensibles à ce qui se fait au Québec.
Jean-François
Parlerais-tu d’un effet Rabagliati ?
Thomas-Louis
Oui, il y a certainement cet effet. Toutefois, il est différent. Paul en fait, c’est la première série BD au Québec qui a été bien médiatisée. Du moins, dans l’histoire récente. Cette meilleure médiatisation a amené les médias plus traditionnels à dire : « oh, il existe un autre type de bande dessinée qui est le fun et qui s’adresse aux adultes ». Le terme « roman graphique » a aussi été utilisé pour Rabagliati (et d’autres ensuite). Ce n’était plus de la « simple » BD (et, je place le terme simple entre guillemets), mais du roman graphique.
Jean-François
Oui, ce qui, en fait, est une fausse catégorie. Une catégorie davantage marketing.
Thomas-Louis
Assurément, en tous les cas, les maisons d’édition ont joué là-dessus pour la commercialisation et la médiatisation.
Si je peux ajouter, c’est un peu la même chose avec Guy Delisle. Lui aussi a bénéficié d’une belle couverture médiatique. De sorte, quand il gagne un prix, on parle de lui dans les médias « grand public ». On montre notre fierté, et avec raison. Mais, quand on parle d’auteur·rices jeunesse, ou de la BD dite de « genre », c’est souvent plus difficile de capter l’attention des médias. C’est dommage que ça n’offre pas toujours un portrait juste de la richesse de la BD d’ici.
Il y a une foule d’auteur·rice·s de talent qui n’ont pas le droit à une visibilité médiatique comme iels devraient l’avoir. L’un des intérêts de l’effet Rabagliati et de la forte médiatisation autour de son œuvre, c’est tout de même qu’il a permis à des lecteur·rice·s qui ne lisaient pas de BD de se lancer et de devenir des lecteur·rice·s de BD, de s’intéresser à la production récente. Paul a aussi été une des premières BD à intégrer les programmes scolaires ou, du moins, les listes de suggestions de lecture, ce qui est un pas très important. Ainsi, les élèves sont invité·e·s en classe à découvrir Rabagliati, ce qui peut possiblement leur donner le goût de découvrir d’autres bédéistes du Québec. Ce qui s’est passé autour des Paul a aussi permis d’ouvrir des portes. Entre autres, le marché s’est ouvert, ce qui a permis à des maisons d’édition de voir le jour, par exemple Pow Pow sous l’impulsion de Luc Bossé, Front froid et Nouvelle adresse. Et, si tu demandes à des gens de nommer la BD la plus vendue au Québec, la réponse va être spontanément… Rabagliati !
Mais, je crois que les médias pourraient encore faire plus. Heureusement, il y a des chroniqueur·euse·s, par exemple, Jean Dominic Leduc ou Raymond Poirier, pour parler de la BD produite au Québec et progressivement offrir une visibilité à une plus grande diversité. Il faut ultimement que la BD cesse d’être ce que j’appelle le « cousin sympathique ». On la présente rapidement, on en parle un peu, mais après ça, on parle de choses plus sérieuses.
Il y a constamment un travail à faire pour rester toujours pertinent, il faut toujours rester à l’affût pour que les gens continuent de penser à nous.
Virginie
Dirais-tu que les prix en BD, par exemple le grand prix Angoulême, contribuent à une meilleure visibilité et promotion de la BD ?
Thomas-Louis
Oui, bien que la couverture puisse rester limitée auprès du grand public. Prenons l’exemple de Julie Doucet qui remporte le grand prix à Angoulême. Quand elle a gagné, des journalistes bien connu·es au Québec ont tenté de la rejoindre. Bien de celleux-ci n’étaient pas initialement intéressé·e·s à son œuvre, ou à la BD de façon plus large, mais iels le sont devenu·e·s momentanément. Tout le monde, lors de tels événements, a son mot à dire, tout le monde est fier et content. Toutefois, c’est parfois éphémère.
Virginie
En effet, qu’est-ce qu’il en reste ? Gagner un prix comme celui de Julie Doucet, au-delà de l’effet momentané « boule de neige », que reste-t-il ?
Thomas-Louis
Il y a une renommée qui reste avec un nom tout à coup mieux connu du grand public, alors qu’il ne l’était pas ou peu avant. Pour Julie Doucet, il y a eu de belles expositions, dont une à Angoulême, reprise à Paris. Une autre très belle à Strasbourg. Cependant, c’est dommage, mais il n’y a aucun plan des institutions ici pour les faire traverser au Québec. Pour la suite, tout dépend souvent de la personnalité des bédéistes ou de l’accompagnement qu’iels ont de leur éditeur·rice.
Jean-François
Oui, car les BD sont réalisées par des artistes et les artistes…
Thomas-Louis
… ne sont généralement pas des vendeur·se·s ou des entrepreneur·se·s dans l’âme. De sorte, il faut souvent une machine éditoriale derrière, une maison d’édition particulièrement forte pour médiatiser ses artistes ou une maison très implantée. Mais, pour Julie Doucet, je considère qu’il y a des décorations qu’elle aurait dû avoir au Québec qu’elle n’a pas eues, vu sa renommée à l’international et l’impact de son œuvre.
Virginie
Pour une histoire de médiatisation ?
Thomas-Louis
Probablement, en partie, mais aussi sûrement pour les contenus abordés dans son œuvre, sa manière de représenter la réalité, le choix du langage. À la base, ça ne se veut pas destiné à tous les publics. C’est comme Henriette Valium. À son décès, il y a eu deux belles expos à Montréal, mais ça reste un artiste qu’on gagne à connaître et qui mérite plus de visibilité.
Virginie
C’est pourquoi la mission de Québec BD, et tout le travail réalisé avec et pour les créateur·rice·s, est important.
Thomas-Louis
C’est vrai. Principalement, Québec BD travaille avec les auteur·rice·s, plusieurs projets naissent des discussions avec celleux-ci. Parfois, toutefois, des maisons d’édition qui publient les œuvres peuvent refuser des collaborations, car elles ne cadrent pas dans leurs stratégies de commercialisation. On respecte cela.
Mais, cela reste peu fréquent, d’autant que c’est rare que je propose des idées sans avoir, du moins en partie, le soutien financier en amont. De fait, je peux dire : j’ai tel projet, j’ai tel budget pour le réaliser et, généralement, les réponses sont positives, à moins que les auteur·rice·s ne soient pas disponibles ou que plus largement le projet ne cadre pas dans les orientations des maisons d’édition. Ça peut aussi être une question de timing.
Il y a cependant une nouvelle donnée à prendre en compte depuis que je travaille à Québec BD : les conditions de travail ont beaucoup évolué pour les créateur·rice·s. Avant, tu offrais un voyage pour se rendre à tel événement et les réponses étaient rarement négatives, car déjà, c’était une opportunité. Maintenant, il y a un plus grand souci pour savoir si l’ensemble des activités réalisées sont rémunérées. Et, c’est sain. Bien sûr, dans la mesure du possible, on essaie d’aller chercher les meilleures conditions de travail. Mais parfois, c’est surprenant comment le travail des créateur·rice·s n’est pas reconnu à sa juste valeur par certains événements ou organismes. Les budgets doivent évoluer.
Même dans les salons du livre, pendant longtemps, les animations n’étaient pas payées, les rencontres, etc. Là, elles le sont presque systématiquement ; cela se standardise. La prochaine étape, à mon avis, sera les dédicaces. Il y a justement un projet pilote en France actuellement par rapport à cela. Le projet était dans les 8 ou 10 festivals les plus importants en BD et maintenant, c’est étendu à plus de 20, je crois. Les bédéistes reçoivent un montant fixe pour une présence à un événement. C’est un montant qui est payé au tiers par l’instance invitante, ce qui, bien entendu, joue sur le budget lié à l’organisation d’un événement ou la présence d’une maison d’édition. Les deux autres tiers sont pris en charge par la SOFIA (la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit) et le CNL (le Centre national du livre).
Virginie
Il y a donc toutefois une reconnaissance du temps investi en promotion et en rencontres avec le public ?
Thomas-Louis
Oui, mais quand tu regardes dans le détail le projet mené en France, ce sont les dédicaces avec un acte de création qui sont payées, c’est spécifique donc à la BD, car les illustrateur·rice·s investissent beaucoup de temps parfois pour produire des dédicaces. Il importe toutefois d’aussi considérer les scénaristes, ce qui n’est pas systématique fait. Il est certain que de tels projets ne sont pas sans conséquence sur les événements de promotion du livre, puisque la présence des créateur·rice·s peut devenir assujettie à des budgets, disponibles ou pas, selon les événements.
Au Québec, plusieurs artistes du livre reçoivent aussi des montants (parfois symboliques, certes) pour leur présence à des événements, mais ceux-ci sont généralement pris en charge par les éditeur·rice·s, selon différentes modalités propres à chaque maison d’édition.
Ce qui serait dommage, c’est que les choses transitent vers un modèle où le retour sur investissement est à tout prix recherché. Pour un organisme comme le nôtre, qui souhaite laisser la place au plus grand nombre et qui cherche à promouvoir la BD sous toutes ses formes, c’est contre-intuitif.
Virginie
Ce sont des enjeux importants, en effet.
ÊTRE À QUÉBEC : AVANTAGES ET CONTRAINTES
Virginie
Concernant Québec BD plus spécifiquement, quels seraient pour toi les obstacles que vous pourriez rencontrer pour réaliser votre mission et, au contraire, quels sont les leviers ou les aides ?
Thomas-Louis
Les aides, assurément, reposent en grande partie sur le réseau établi. Nous restons un organisme qui est finalement peut-être plus gros que la structure sur laquelle il repose. Mais au final, on arrive à faire de beaux et gros projets.
Quand je travaille avec la ville de Québec, par exemple, elle me donne de plus en plus de projets, car elle voit que je suis capable, que Québec BD est capable de les réaliser. C’est la même chose avec d’autres partenaires, par exemple Angoulême. Cette année, Patrimoine canadien ainsi que la sous-ministre étaient avec nous à Angoulême, tout comme la responsable du Fonds du livre du Canada et la directrice du Conseil des arts et des lettres du Québec. Prouver notre capacité à mener des projets aide beaucoup l’organisme.
Il y a aussi un avantage qui est un défaut en même temps pour Québec BD, c’est le fait d’être à Québec, une ville assez petite, mais assez grosse aussi, ce qui permet d’être facilement en lien avec les autorités de la ville et les décideur·euse·s. Il y a moyen d’avoir un accès politique contributif. Au même titre, il y a beaucoup d’organisations locales, mais aussi provinciales, étant donné la présence du parlement de la province de Québec. J’ai donc accès ici à des niveaux de fonctionnaires que j’aurais peut-être moins si j’étais ailleurs. Parce qu’iels sont ici, parce qu’iels sont présent·e·s dans des événements. Mais, le fait d’être à Québec, c’est aussi un défaut, car la majorité des éditeur·rice·s et des diffuseur·euse·s sont à Montréal. La majorité des créateur·rice·s aussi. Je suis, à cet égard, loin du milieu et ce n’est pas toujours facile pour cela.
Virginie
C’est en effet un obstacle important.
Thomas-Louis
Oui. En organisant un événement ici, ça veut dire que beaucoup de créateur·rice·s viennent de l’extérieur de Québec, ce qui augmente les coûts. Lorsque l’on travaille avec les maisons d’édition et que cela implique un déplacement, il peut y avoir des choix à faire, liés au budget. Car, il faut penser au transport, à l’hôtel, aux perdiems, etc. À Montréal, tu peux prendre le métro et participer à l’événement pendant quelques heures, et tu retournes chez toi. C’est autre chose, ça peut faciliter la participation. Mais, on a quand même un beau bassin de créateur·rice·s à Québec, on reste chanceux. C’est pour cela, par exemple, que nous avons pu mettre en place, et j’espère que nous le referons d’année en année, un mini-salon dédié aux bédéistes de la ville de Québec.
PROMOTION DE LA BD ET INITIATIVES DE FORMATION
Jean-François
J’ai une autre question qui est un peu « champ gauche », mais, depuis que l’Université du Québec en Outaouais (UQO) offre un baccalauréat en BD, as-tu senti un effet ? As-tu vu émerger une nouvelle génération ?
Thomas-Louis
C’est certain qu’un effet est perceptible, mais je serais curieux de savoir le nombre de finissant·e·s qui poursuivent en BD après six-sept ans. Parce que plusieurs ont sorti des choses, et [ont] fait leur marque, mais, pour d’autres, la trace s’est malheureusement perdue.
Jean-François
Christian Quesnel a fait sa marque, par exemple.
Thomas-Louis
Oui, mais Quesnel faisait de la BD avant de suivre la formation.
Dans la première cohorte, il y a eu par exemple André St-George et Frédéric Lavergne. On parle ici des premières années. Mais, de ce groupe-là, il en reste peu qui ont poursuivi en BD. À chaque année cependant, il y a des noms qui ressortent. Iris et Camille Perron Cormier, par exemple. Cependant, la formation pour laquelle j’ai observé plusieurs retombées en nombre de personnes qui l’ont suivie et ont publié, ce sont les formations de Jimmy Beaulieu offertes en différents lieux (bibliothèques, cégeps, festivals, etc.).
Jean-François
En termes de pépinière ?
Thomas-Louis
Oui exactement, en termes de pépinière de talents. À l’UQO, ça reste un programme universitaire. C’est formidable qu’un tel programme existe, et les retombées sont importantes pour la reconnaissance de la BD. Mais, je serais curieux de voir les effets qu’aurait un programme comparable offert dès le cégep, dans une formation technique professionnelle par exemple, donc plus tôt dans le parcours de formation scolaire.
Virginie
C’est vrai qu’une telle formation pourrait être porteuse.
LA BD AU FÉMININ
Virginie
Tu nommais tout à l’heure les bédéistes Iris et Camille Perron. À l’espace Québec à Angoulême, dans le cadre du festival international de BD, j’ai remarqué pour l’édition 2024 une forte présence de femmes bédéistes. Est-ce une tendance ?
Thomas-Louis
Au Québec en général, les femmes en BD occupent en effet une place de plus en plus importante. C’est remarquable. On est très chanceux. On entend aussi moins parler des éditrices, mais les femmes jouent actuellement un rôle très important dans l’édition en BD, notamment en France, entre autres chez Casterman. Au Québec, il y a moins d’éditrices dans le monde de la BD, mais beaucoup plus d’autrices. Dans les métiers du livre en général, je dirais que les femmes occupent de plus en plus de rôles centraux.
Virginie
On n’est donc plus dans la BD en tant qu’objet de production et de consommation essentiellement masculin ?
Thomas-Louis
Oui, et ça fait assez longtemps que les choses progressent en ce sens. Personnellement, depuis 2005, j’observe que le nombre d’auteurs et plus particulièrement d’autrices a explosé au Québec, tout comme le nombre de plateformes, de maisons d’édition, etc. Les publics sont aussi différents ; les femmes consomment de plus en plus de BD.
MULTIPLICATION DES LIEUX DE PROMOTION DE LA BD
Virginie
Est-ce que tu sens un ralentissement, est-ce que la vague s’essouffle au regard de l’intérêt pour la BD ?
Thomas-Louis
Je ne sens pas que l’explosion continue comme elle l’a été il y a quelques années, mais il y a une stabilisation. Cependant, de nouveaux enjeux émergent. Les maisons d’édition commencent à se serrer un peu la ceinture. Pour le festival, par exemple, il y a des années où elles ont investi beaucoup plus. Il faut dire que les événements se multiplient et qu’elles doivent faire des choix.
Actuellement, par exemple, il y a le festival BD de Montréal, qui se tient un mois et demi après nous, il y a le festival BD de Prévost en août et le RVBD de Gatineau à l’automne.
Virginie
Oui, sans compter les nombreux salons du livre qui se tiennent au Québec où la BD occupe une place de plus en plus importante.
Thomas-Louis
Oui. Donc, pour les éditeur·rice·s et diffuseur·euse·s, il faut parfois être sélectif·ve·s sur les investissements, car les budgets ne sont pas nécessairement plus grands.
Jean-François
C’est vrai que le festival BD de Québec a longtemps été le seul festival au Québec consacré à la BD, jusqu’à ce que celui de Montréal puis les autres apparaissent. Existe-t-il des collaborations avec ces événements ?
Thomas-Louis
En fait, il y a une volonté, entre autres avec le festival de BD de Montréal, mais, comme le festival de Québec se tient un mois et demi avant, c’est difficile de concilier les horaires respectifs. Je suis très pris pendant longtemps par le festival à Québec et quand je termine, iels sont de leur côté bien avancé·e·s ou complètement pris·e·s dans l’organisation du leur. Mais, il y a des choses dans les airs, notamment en termes d’exposition. C’est la même chose pour les projets internationaux. Il y aurait toujours davantage de collaborations possibles. En même temps, si on vise tous les mêmes places, à un moment on risque de ne plus avancer. Il faut en fait trouver des manières complémentaires de faire et d’agir.
Par exemple, on a collaboré avec le festival de BD de Montréal pour l’initiative BDécembre où, chaque jour du mois de décembre, à la manière d’un calendrier de l’avent, on offrait des suggestions communes de lecture de BD1. C’est quelque chose qu’on a créé à Québec BD, et j’ai embarqué Montréal. Il y a assurément moyen de faire de plus en plus de choses en concertation, mais je pense que ça va être plus sur des projets pour le milieu, pour les créateur·rice·s qu’autour de nos événements respectifs.
Jean-François
Et, qu’en est-il des collaborations avec le milieu scolaire ?
Thomas-Louis
Il faudrait qu’on mette plus d’énergie là-dedans honnêtement. Je trouve qu’on a moins exploité cet aspect dans les dernières années et c’est quelque chose que je voudrais relancer. Mais, ce n’est pas facile, c’est un autre réseau et c’est une question de taille d’équipe aussi. Ça prendrait des forces dédiées au scolaire.
Jean-François
Mais, tu y verrais un intérêt pour Québec BD ou le festival ?
Thomas-Louis
Oui. Par exemple, on a fait il y a deux ans des rencontres en ligne pendant le festival avec des classes. L’accueil a été fantastique. Cette année, on l’avait prévu, mais sans savoir que ça tombait sur le jour de l’éclipse. Comme les écoles ont annoncé tardivement qu’elles allaient fermer, on a dû annuler à la dernière minute. On va se reprendre l’an prochain.
Virginie
Pour le scolaire, ou du moins les élèves pendant la période d’été, vous avez tout de même la BDthèque mobile, c’est un beau projet.
Thomas-Louis
Oui. C’est en effet un projet porteur qui donne de la visibilité à Québec BD depuis 2015, en plus de permettre de faire la promotion de la lecture et de la création de BD auprès de la population. C’est un très beau projet né d’une collaboration porteuse avec la ville de Québec et d’autres partenaires. Le projet a d’abord été bâti pour intervenir auprès des jeunes inscrits dans les camps d’été de la ville puis le projet s’est davantage déployé dans les parcs de la ville puis dans certains événements ciblés, telles les fêtes de quartier, par exemple, ou des lieux, comme le Grand marché de Québec.
Le scolaire demeure donc très pertinent, mais il faut que le monde embarque, que les partenaires soient multiples, comme c’est le cas par exemple pour la BDthèque. Quand je regarde à Montréal, durant le mois de mai, c’est le mois de la BD. On la célèbre dans les bibliothèques, les centres de services scolaires sont demandeurs d’activités… c’est assurément aidant.
Jean-François
Trouves-tu que les gens ou organismes travaillent un peu trop en silo ?
Thomas-Louis
Parfois oui, heureusement pas tout le temps. Mais, les collaborations porteuses pourraient être encore plus nombreuses. Tout le monde y gagnerait.
LE FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA BD À ANGOULÊME
Virginie
Pour conclure Thomas-Louis, parle-nous de ton implication et donc celle de Québec BD au festival international de la BD à Angoulême ? Avec l’invitation faite au Canada d’être invité d’honneur, les mandats ont dû se multiplier ?
Thomas-Louis
Tellement, sans aucune commune mesure avec ce qui se vit habituellement en fait. Angoulême 2024, ce n’est pas moi dans un premier temps qui ai eu le mandat concernant la place du Canada comme invité d’honneur. C’est une invitation politique en fait et elle s’est d’abord gérée au niveau de l’ambassade. Le ministre a délégué Patrimoine Canada pour gérer le projet. Or, Patrimoine Canada travaille avec Livres Canada Books, et c’est donc eux qui ont eu le mandat d’organiser la présence canadienne. Mais, comme ils n’étaient jamais allés à Angoulême, alors que Québec BD oui, ils m’ont engagé pour le faire avec eux. Le centre culturel canadien m’a engagé pour gérer le volet artistique, le festival d’Angoulême m’a engagé pour faire l’exposition sur la BD produite au Canada, et j’ai monté, en partenariat avec le Conseil des arts et des lettres du Québec et la ville de Québec, le projet de l’espace Québec visant le rayonnement des artistes bédéistes de la ville de Québec. J’avais quatre chapeaux. Cette année, assurément, Angoulême a été très prenant pour moi.
Virginie
Oui, et tu me disais que même l’exposition officielle du Canada D’un océan à l’autre : cap sur la BD canadienne, tu as été obligé de l’élaborer très rapidement ?
Thomas-Louis
Oui, je l’ai montée en un peu plus de trois semaines. Ça vaut la peine, comme on dit, d’avoir des contacts. Et, c’était pancanadien.
Virginie
Oui, en effet, chaque province était représentée.
Thomas-Louis
Je suis allé rencontrer les gens du festival d’Angoulême à la mi-octobre et j’avais des délais très courts, soit jusqu’à la mi-novembre, et le budget a tardé à se confirmer (comme c’est habituel, remarquez). C’est sûr, étant donné son mandat, Patrimoine Canada avait, avec ce projet, une volonté commerciale, soit d’amener les éditeur·rice·s canadien·ne·s à créer [d]es liens et vendre des droits. Faire rayonner la BD canadienne dans le monde, quoi. Il y a eu un beau travail de fait collectivement pour intégrer aussi de plus petit·e·s éditeur·rice·s qui n’auraient pas nécessairement eu accès aux programmes normalement pour montrer la diversité de ce qui se fait ici. Le volet artistique, lui aussi, a été pensé rapidement, et c’est le Centre culturel canadien qui est allé chercher des fonds, de concert avec le Conseil des arts du Canada. Pour l’espace Québec, c’est aussi le Conseil des arts du Canada et la ville de Québec qui étaient partenaires. Beaucoup de personnes ont donc mis l’épaule à la roue, surtout si l’on ajoute à celles-ci les maisons d’édition qui ont rapidement embarqué dans le projet. Au bout du compte, tout le monde a été très content de la présence de plus de 60 créateur·rice·s. Je ne m’attendais pas à ce qu’on puisse rassembler autant de monde, étant donné le temps qui jouait contre nous. La collaboration se fait aussi sur des détails. Ayant l’expérience de l’événement et une bonne connaissance des réalités du milieu de la BD, j’ai pu intervenir pour éviter certaines situations qui auraient créé des frustrations, mais qui, dans d’autres contextes, auraient été normales.
Jean-François
Il y a un choc de culture dans les manières de faire ?
Thomas-Louis
Oui, on pourrait dire cela, mais on a trouvé une belle façon de collaborer pour atteindre un objectif commun. Parfois, c’était pour de petites choses. Par exemple, en juillet, quand on a commencé à en parler, je leur ai demandé s’ils avaient commencé à réserver leur hébergement pour avoir des chambres au centre-ville pour les membres officiels. C’est un enjeu majeur à Angoulême et tout le monde joue du coude pour les chambres. J’ai fait jouer mes contacts à la ville vers la fin.
Jean-François
Oui, parce que ton réseau de contacts à Angoulême est riche.
Thomas-Louis
Oui, ça fait des années que j’y vais au nom de Québec BD. C’est un moment de l’année important pour la promotion de la BD québécoise qui est au cœur de la mission de l’organisme.
Virginie
Merci, Thomas-Louis, pour cet échange riche. Vous pouvez être fiers, en tous les cas, de tout ce que vous faites pour promouvoir la BD, ici et ailleurs.
Thomas-Louis
Merci à vous deux.
Annexe 1 : Québec BD – quelques éléments de présentation (https://quebecbd.com/)
Québec BD est un organisme à but non lucratif (OBNL) dont le mandat premier est de concevoir, organiser et administrer des événements ou des initiatives de promotion pour la bande dessinée pour le grand public. Québec BD travaille de plus au développement du milieu du 9e art québécois en permettant aux auteur·rice·s et aux différent·e·s intervenant·e·s de l’édition de la bande dessinée de se rencontrer, d’échanger et de participer à des activités diverses, au Québec et à l’étranger.
Un événement phare : le festival – Plus vieil événement consacré à la bande dessinée au Canada, le Festival Québec BD (anciennement le Festival de la bande dessinée francophone de Québec) est né en 1988, de l’initiative de madame Sonia Gagnon et de monsieur Réal Fillion. D’abord, un événement regroupant une dizaine d’auteur·rice·s et quelques activités parallèles, le FQBD est devenu une manifestation réputée pour la quantité et la qualité de ses invité·e·s et de ses activités. Ce faisant, au fil des années, l’organisme Québec BD a su forger sa place sur la scène nationale et internationale, en plus de développer de nombreuses activités à l’année.
En 2017, Québec BD a célébré son 30e anniversaire et l’organisme s’est vu décerner le Prix de l’Institut canadien de Québec, visant à souligner la contribution exceptionnelle d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’un organisme culturel à la vie littéraire de la Communauté métropolitaine de Québec au cours de la dernière année. Quelques années auparavant, soit en 2013, le directeur de l’organisme, Thomas-Louis Côté, a de plus remporté le Prix du développement culturel du Conseil de la culture (Prix François-Samson) dans le cadre des Prix d’excellence des arts et de la culture des régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Cet honneur vise à reconnaître le travail d’une personne dont l’initiative récente a eu un impact significatif sur le développement culturel d’un organisme et d’une discipline, ici la bande dessinée.
Annexe 2: La BDthèque mobile
Depuis 2015, la BDthèque mobile Québec BD a sillonné les arrondissements de la Capitale-Nationale (ville de Québec) pour promouvoir la création et la lecture de bandes dessinées. Camps de jours, écoles et événements, toutes les occasions sont bonnes pour permettre aux animateur·rice·s de Québec BD de transmettre leur amour du 9e art. Présenté sous la forme d’une remorque facile à installer, le module d’animation comporte tout ce qu’il faut pour présenter aux participant·e·s une foule d’ateliers. En plus d’équipements de dessin, la BDthèque offre également une vaste sélection d’albums en lecture libre pour permettre à tous·tes de découvrir une panoplie de séries et de créateur·rice·s d’ici et d’ailleurs.
Découvrez-la dans cette courte vidéo. https://vimeo.com/390055015
- Du 1er au 31 décembre 2023, Québec BD et le Festival BD de Montréal (FBDM) se sont unis à nouveau pour proposer BDécembre, un calendrier de l’Avent de bandes dessinées québécoises. À chaque jour, il était possible de découvrir sur les réseaux sociaux un nouveau titre paru dans l’année, à lire ou à offrir ! ↩︎
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net