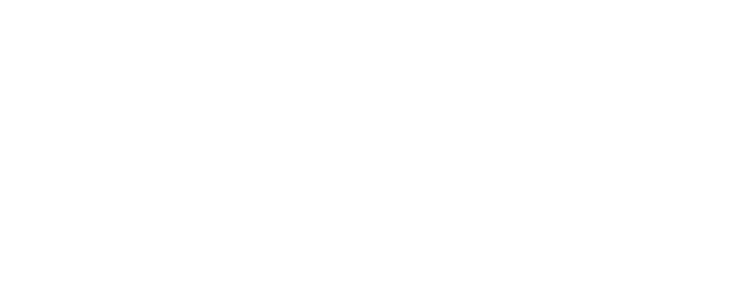Exploration des narrations modulaires : une exemplification de la littérature analogique participative
Dans cet article, un réseau d’œuvres (Tauveron, 2002) permet d’aborder les œuvres interactives, dans une perspective d’usage en classe. Nous allons nous concentrer sur les pratiques liées aux cultures de l’imaginaire (Ray, 2019; Lescouet & Vallières, 2023). Ces formes interactives, qui mobilisent des gestes de lecture variés, permettent d’aborder les imbrications du littéraire et du ludique dans une culture populaire toujours plus hybride. Après un aperçu des formes de narrations interactives analogiques, comme les romans-dont-vous-êtes-le-héros, les narrations modulaires en cartes ou encore les livres-plateaux, nous allons explorer la diversité du corpus disponible, tant à destination des plus jeunes lecteur·rice·s que des adolescent·e·s.
In this article, a network of works (Tauveron, 2002) is used to approach interactive works from a classroom perspective. We going to focus on practices linked to imaginary cultures (Ray, 2019; Lescouet & Vallières, 2023). These interactive forms, which mobilize a variety of reading gestures, make it possible to address the interweaving of the literary and the playful in an increasingly hybrid popular culture. After an overview of analog interactive narrative forms, such as you-are-the-hero novels, modular card-based narratives and board books, we’ll explore the diversity of the available corpus, aimed at both younger readers and teenagers.
Introduction
La littérature participative s’est fortement diversifiée au cours des 20 dernières années (Clément, 1994; Bouchardon, 2012; Lescouet et Vitali-Rosati, 2022), offrant, par son hybridation avec des formes ludiques établies, telles que le jeu de rôle ou le jeu de cartes à collectionner, des propositions uniques pour comprendre la mise en récit (Soucy, 2023). Plus encore pour les littératures de l’imaginaire (fantastique, fantasy et science-fiction, Ray, 2019) disposant d’un mégatexte fort (Bréan, 2012, 2022), et donc de « blocs » communs connus pouvant être réemployés. Les narrations modulaires, par ce fonctionnement de blocs à agencer, à manipuler ou à transformer, sont un corpus d’analyse passionnant pour comprendre les nouvelles formes narratives et les pratiques limitrophes entre littéraire et ludique, particulièrement fortes dans la culture pop actuelle.
L’imbrication intime des littératures de l’imaginaire et des formes narratives interactives, numériques ou analogiques (Chauvin et Villagordo, 2017) a entrainé la construction d’un dictionnaire de gestes de lecture (Masure, 2017; Citton, 2012) fort et malléable (Lescouet, 2022).
Des nombreuses pratiques issues des narrations d’avant-garde, des lieux de corpus (Emerit, 2016) à l’interface entre littérature et pratiques ludiques, transparaissent dans les propositions de littérature jeunesse.
Il est à noter que des pratiques purement éditoriales, c’est-à-dire des propositions mettant en valeur l’œuvre, mais n’influant pas directement sur sa forme, ne seront pas prises en compte ici.
La diversité des œuvres à l’étude nous pousse à les aborder sous forme d’un réseau d’œuvres (Saint-André et al., 2015), nous permettant de parcourir les formes pour en tirer un panorama de gestes de lectures usuels mobilisés applicables en classe (Sidhu et al., 2021). Nous le verrons, les littératures de l’imaginaire (Ray, 2019) sont très présentes dans le corpus sélectionné et présenté dans cet article. S’il y a une part de choix personnels dans cette sélection, par le biais de nos recherches centrées sur ce corpus, il est également à noter qu’une surreprésentation de ces genres fait partie intégrante de la construction des narrations interactives.
Cette étude des réseaux d’œuvres développera comment ces œuvres peuvent renforcer l’apprentissage d’une diversité de gestes de lecture pour un public jeune, permettant une compréhension intime des phénomènes de narrations de genre (Langlet, 2016), tout en conservant une approche ludique de la littérature. Ce travail se placera au point de rencontre de deux types de réseaux, un réseau générique et un réseau d’écriture (Tauveron, 2002). Nous allons particulièrement nous pencher sur la manière dont les pratiques de lecture ludique influencent la compréhension des codes littéraires dans la littérature de l’imaginaire, notamment à destination d’un jeune public. Pour cela, nous nous intéresserons aux compétences spécifiques nécessaires pour comprendre ces œuvres, et en quoi elles sont également nécessaires pour une meilleure littératie globale.
Le corpus étudié se veut volontairement divers afin de renforcer la perception de continuité et de forte interdépendance culturelle de ces formes. Nous débuterons donc cette étude par un roman-dont-vous-êtes-le-héros (Szpirglas, 2022) pour aborder ensuite la narration modulaire par cartes avec Le chemin de Claude Ponti et Pour la Reine, avant d’ouvrir à des narrations plus ludiques à travers Histoires de peluches (un livre-plateau où se déroule l’histoire) et MicroMacro, une narration par la découverte et la reconstitution d’événements dans une ville-affiche.
Nous ouvrirons enfin le propos sur des pratiques plus rôlistes à destination des plus jeunes. Dans un premier temps, cet article va présenter un bref historique de ces formes narratives, et discuter des implications du numérique dans le retour sur le devant de la scène de ces pratiques. Cela permettra de présenter brièvement les gestes de lectures mobilisés et leurs implications pour la réception de ces œuvres par leur manipulation. La deuxième partie sera consacrée au réseau d’œuvres à proprement parler; tout d’abord pour mettre en regard cette approche théorique avec les études de l’imaginaire actuel, puis pour présenter les œuvres plus précisément. La troisième partie sera consacrée à l’étude de ce réseau d’œuvres pour comprendre les littératures modulaires et pour aborder l’intimité entre les pratiques ludiques et narratives contemporaines.
1. Topographie générale des œuvres narratives interactives analogiques
La diversité des formes narratives interactives, quelle que soit leur classification, permet d’explorer des approches variées de la création narrative collaborative, de l’expérimentation de textes manipulables ou encore de narrations ludiques. Il est important de comprendre l’évolution de ces formes pour saisir la diversité des gestes de lecture mis en place par ce corpus. Nous allons, dans cette première partie, tenter de dégager des tendances, de cartographier de manière plus abordable pour des néophytes l’immensité de ce corpus.
1.1. Des formes à l’histoire longue
La forme la plus répandue des narrations interactives repose sur la coconstruction d’une expérience – que nous appellerons le texte pour les besoins de la démonstration de cet article – par un groupe de personnes à l’aide de règles encadrant les possibilités d’action et permettant à chacun·e d’inscrire ses personnages et leurs actions dans un cadre commun. Ces règles permettent de mobiliser un ensemble d’éléments établis, définis par la documentation accompagnant l’œuvre, et de les agencer en fonction de règles assurant leur cohérence. Ces œuvres reposent souvent sur une asymétrie performative : par exemple, lorsqu’un·e des membres du groupe endosse le rôle de narrateur·rice, tandis que les autres incarnent un·e personnage.
Ces œuvres ont gagné une grande popularité avec la publication des premiers livres de règles de Donjons & Dragons (Arneson et Gygax, 1974), popularisant le jeu de rôles auprès d’un large public. Au cours de ces 50 années de publication régulière, et grâce à la mise à disponibilité du système de jeu basé sur des dés 20 dans le domaine public, de nombreux autres jeux de rôles ont été publiés et ont prospéré.
De nombreuses œuvres moins demandantes que des jeux de rôles ont également été développées, permettant notamment de contourner la difficulté pour le·a joueur·euse-narrateur·rice de préparer la trame globale de l’expérience en proposant des scénarios ou aventures déjà en partie structurés. Des formes ludiques plus cadrées existent également à la frontière de la littérature, proposant des œuvres qui évoluent ou se détruisent au fur et à mesure de leur prise en compte, des œuvres qui reposent sur des enquêtes et des récits à suspense mobilisant les mêmes mécaniques narratives que les romans policiers, et tant d’autres.
Depuis les années 2000, les jeux de table, de plateaux ou de cartes développent une culture narrative. Comme beaucoup de pratiques, cette culture narrative a peu à peu construit un ensemble de codes partagés, permettant de construire des œuvres spécialisées, adaptant ses codes ou les discutant. Les narrations ludiques analogiques à l’étude ici mobilisent un ensemble de gestes de lecture propres aux fictions, mais aussi aux jeux de société – lancer des dés, résoudre des puzzles, déplacer des pions, etc. – qui s’hybrident pour établir des narrations construites et interactives.
Plus encore que la mobilisation de mégatexte (Bréan, 2012), dans une perspective de création d’un décor d’inscription de règles indépendantes, des narrations fortes qui se nourrissent des mécaniques ludiques pour établir leurs structures narratives se développent et gagnent en popularité.
1.2. Perméabilité des pratiques avec les narrations numériques
L’essor parallèle des supports numériques et la popularisation des littératures et narrations natives du numérique qui les accompagnent ont mobilisé des structures proches. Ainsi, les premiers jeux vidéo narratifs comme Colossal Cave Adventure (1976) ou Zork (1977) suivaient des mécaniques semblables, proposant un texte narratif s’affichant à l’écran et invitant les joueur·euse·s à ajouter leurs actions par l’utilisation de textes1. Ces textes remplissent le rôle de description des actions revenant généralement aux joueur·euse·s-personnages.
Cette forte perméabilité a permis d’ouvrir les narrations numériques aux habitudes ludiques ou de manipulation acquises dans les œuvres analogiques, d’inclure des pratiques déjà ancrées dans la littérature jeunesse (Escarpit, 2008), comme la manipulation de pop-up, de languettes ou de cachettes, par exemple; à l’inverse, cela a permis d’inclure dans des œuvres physiques des gestes de navigation usuels du numérique, offrant notamment un nouveau souffle aux livres-dont-vous-êtes-le-héros, en permettant d’explorer l’hypertextualité sur papier (Moran, 2018).
Des gestes de lecture numériques ont pu être repris par des narrations analogiques – non numériques – ou être un facteur de leur popularisation. Nous pouvons bien sûr penser à l’habitude prise de naviguer via des « liens », c’est-à-dire l’habitude d’activer un élément permettant d’arriver à un autre fragment de l’œuvre similaire au précédent.
1.3. Hybridation des gestes de lecture
Par gestes de lecture, il sera ici entendu un mouvement du corps ou d’une partie du corps du·de la lecteur·rice lui permettant de découvrir une partie de l’œuvre non visible sans son effectuation. Ils sont la manière de communiquer notre présence physique et de transmettre notre attitude, notamment en direction d’une œuvre, et donc, pour ce qui nous intéresse, d’un univers second. Ils sont à la fois intimes, propres à chacun·e, et collectifs, car appris en commun. Ils font partie d’un lexique, lui aussi commun, qui permet l’interaction et l’intercompréhension.
La proximité des corpus et des structures narratives permet une forte perméabilité des gestes de lecture. À titre d’exemple, les méthodes de sélection par swipe, un geste introduit dans les applications de rencontre sur téléphone intelligent, ont ensuite été développées comme mécanique de réponse à des propositions diégétiques de personnages dans des applications narratives (dans Reigns, par exemple), puis sont devenues une méthode de sélection de cartes, revêtant alors les codes esthétiques d’origine d’inscription du geste.
Une autre forme de jeu narratif, qui propose à la fois une application numérique et du matériel imprimé, est également rendue possible grâce à ces hybridations (Lescouet, Décamp, 2021).
La littérature de science-fiction demande une actualisation, au sens d’Umberto Eco (1985, p. 27), où, comme dans toute lecture, le texte exige du·de la lecteur·rice un travail afin de remplir et de compléter les espaces de non-dits ou de déjà-dits. Ce travail est bien entendu coopératif, c’est-à-dire qu’il est suggéré par le texte qui, lui, ne demeure qu’une machine propositionnelle. Mais, en littérature de science-fiction, où le·a lecteur·rice doit constamment passer d’une allusion à l’autre et d’une hypothèse à une autre (Landragin 2018, p. 144), iel se retrouve confronté·e, par l’immersion fictionnelle, à la nécessité de donner un sens aux étrangetés rencontrées tout en consultant mentalement une vaste « pseudoencyclopédie » qui se nourrit de tous les autres ouvrages de science-fiction, mais également, plus largement, des images en circulation dans la société, qu’il s’agisse d’éléments techniques ou bien scientifiques (Langlet 2006, p. 9).
Cette immersion fictionnelle nécessite donc du·de la lecteur·rice un travail cognitif, c’est-à-dire une vigilance accrue vis-à-vis des indices, qui sont autant d’éléments amenés à rejoindre, mais aussi à nourrir, la xénoencyclopédie de l’œuvre (ibid., p. 144).
Ce travail cognitif est également soutenu par l’inscription physique et concrète du texte, qu’il s’agisse de l’encre d’impression sur du papier, ou des bits sur des serveurs (Cavallo et Chartier, 2001). Cette matérialité est donc nécessaire afin que le·a lecteur·rice puisse prendre connaissance du texte, pour qu’iel le manipule (Hayles, 2008).
L’habitude construite au fil des œuvres (Jauss, 1978) permet, dans le cas des œuvres interactives, de mobiliser des mécaniques plus intriquées et plus complexes. Il devient possible de bâtir des narrations plus élaborées, d’ajouter de nouveaux gestes ou d’imaginer des interactions nouvelles entre des éléments appris séparément. Il y a maintenant une forme d’apprentissage pour accéder aux narrations ludiques les plus complexes. De la même manière que la lecture demande un apprentissage et que certains genres demandent des compétences d’interprétations particulières, certaines formes narratives mobilisent des gestes propres et des valeurs ou sous-entendus particuliers.
2. Réseaux d’œuvres et narrations de l’imaginaire en construction
Les réseaux d’œuvres permettent de penser des liens au sein de corpus déterminés et de rejoindre des méthodologies d’analyse issues de la littérature comparée à des usages déjà établis en éducation sans avoir toutefois à établir de lieux de corpus indépendant, tout en ouvrant la possibilité de discuter des applications directes des propositions construites. Bien que cet article ne vise pas à donner des directions concrètes pour la classe, chacun·e peut se saisir de ce corpus selon ses besoins particuliers.
2.1. Intimité de l’interaction avec le mégatexte
Nombre de genres littéraires reposent sur un ensemble d’éléments partagés unifiés à travers les œuvres, se construisant au fur et à mesure de la publication des œuvres, de l’expérience lectorale et également des succès populaires, permettant ainsi à ces éléments de faire leur entrée dans la culture populaire.
En science-fiction, cela est particulièrement fort avec ce que Damien Borderick nomme « méga-texte » (1995) un ensemble multimédiatique et multiculturel constituant l’imaginaire de science-fiction sur un rapport d’intertextualité fort.
the coding of each individual sf text depends importantly on access to an unusually concentrated “encyclopedia” a mega-text of imaginary worlds, tropes, tools, lexicons, even grammatical innovations borrowed from other textualities” (p. 18).
Ce mégatexte permet d’assembler un ensemble de notions partagées qui peuvent être mobilisées sans explications (ou avec des explications mineures) dans de nouvelles œuvres. Ce concept, propre aux littératures de l’imaginaire dans son extension et son approche globale de l’intertextualité, s’approche d’une forme étendue de l’encyclopédie du lecteur d’Umberto Eco (1985). À la suite de Simon Bréan (2022), nous pouvons ouvrir le concept en dehors de la science-fiction, tant la fantasy présente une similarité dans cette littératie locale particulière au genre.
le megatext de la science-fiction nous semble renvoyer, dans la fantasy, à une érudition mythographique, expression qui désigne le processus d’intertextualité qui voit les créatures et mondes de la fantasy s’ajouter à un répertoire dynamique d’objets prodigieux, selon des stratifications conduisant au syncrétisme ou à la scolie.
Plus encore que l’érudition mythographique (Besson, 2015) généralement attendue pour ce genre, le mégatexte permet de penser les connexions au sein du genre contemporain et de ses productions. Comme l’explique Simon Bréan, l’érudition est dépassée, complétée par la transmodalité des supports. Il ne s’agit plus uniquement d’une culture encyclopédique située (bien qu’elle y participe, établissant une méga xénoencyclopédie), mais d’une actualisation effective des évolutions du genre et de son imaginaire généré au sens large. Plus encore qu’une production de novum (Suvin, 2000) ou d’estrangement (Huz, 2022), la profondeur de l’univers et sa continuation construit un univers fictif étendu complexe et unifié.
Le mégatexte se construit au fil des expériences des individu·e·s. Ainsi, la perception personnelle des différents éléments est fortement influencée par les œuvres où ils ont été rencontrés. Un exemple de cela pourrait être perçu dans les vaisseaux spatiaux : si l’élément en lui-même est largement inclus dans l’imaginaire populaire, les particularités qui lui sont accolées varieront selon si le·a lecteur·rice a d’abord rencontré l’univers transmédiatique de Star Wars ou de space operas plus pointus.
Comme nous l’avons abordé plus tôt, le mégatexte est l’ensemble des éléments communs à un genre, permettant de se retrouver dans les nouvelles œuvres. Il s’agit d’une forme de culture collective, qui se construit au fil des œuvres et de leur succès dans le public. La connaissance de ces éléments permet également de les mobiliser directement pour intervenir au sein de l’œuvre, ils permettent de savoir comment agir directement dans une œuvre dont on connait les codes.
Dans le cas des œuvres à l’étude, deux ensembles de connaissances unifiées coexistent : le mégatexte de genre, mais aussi l’encyclopédie de gestes construite par les œuvres ludiques (Lescouet, 2023). Cette double érudition permet la compréhension des œuvres et l’agentivité de chacun·e en leur sein.
La popularité de ces formes ludiques pose la question de l’importance de leur maitrise pour comprendre les œuvres narratives futures.
Pour les manipulations des œuvres narratives, nous pouvons mobiliser ce concept en l’adaptant toutefois légèrement : un ensemble de gestes connus et partagés est construit au fil de la popularisation des œuvres et de leur expérimentation par le public. À cela s’ajoute une part d’évolution technologique : de nouveaux supports apportent de nouveaux gestes, mais aussi une notion de mode, comme de nouvelles pratiques, par exemple, ludiques avec la popularisation d’une plus grande variété de narrations impliquant des jeux de société, de plateaux ou de cartes.
Ce mégatexte de lecture est donc transgénérique (Besson, 2015) au sens le plus fort du terme, puisqu’il concerne plus les processus de lecture que leurs composantes esthétiques. Il reste cependant fortement ancré dans les cultures de genres, et notamment de l’imaginaire, qui sont surreprésentées dans les œuvres ludiques (Langlet, 2006) et qui se propagent donc au sein de publics semblables (Hommel, 2017).
Ainsi, les parcours de lecture intimes de chacun·e, influencés par des courants forts dans la découvrabilité et la disponibilité des œuvres, comme nous l’avons vu par des tendances globales du marché de l’édition, se construisent autour des intérêts et des pratiques des individu·e·s. Or, ces parcours peuvent être influencés par des médiateur·rice·s, des instances de recommandations ou de prescriptions (Bréan, 2018) qui vont à leur tour prendre en charge la diffusion et l’établissement de nouvelles pratiques. Ces diffusions sont diverses, mais peuvent s’organiser sous forme de réseaux d’œuvres, de corpus organisés et structurés autour d’un enjeu ou d’une problématique, et ce, consciemment ou non.
2.2. Du parcours de lecture au réseau d’œuvres
Comme nous avons pu le discuter jusqu’ici avec l’importance des parcours de lecture propre à chacun·e, c’est par l’expérience des œuvres que les gestes de lecture sont appris : l’apprentissage des règles qui rendent possible l’expérimentation des narrations ne peut se faire que par la circulation au sein des œuvres. Ce parcours est certes influencé par l’ordre chronologique de ces rencontres, mais aussi par les liens qui sont tissés entre les œuvres et leurs mécaniques narratives.
Cette nécessité, pour comprendre le corpus et ses finesses, d’avoir une vision d’ensemble, non globale, mais du moins collective des œuvres, implique l’usage de réseaux d’œuvres pour les découvrir.
Ainsi, le réseau est le point de départ d’activités de lecture et d’écriture; quel que soit son type, il permet de travailler « tout ce qui met le texte en relation, manifeste ou secrète, avec d’autres textes » (Genette, 1982, p. 7). De plus, la lecture en réseau, comme le souligne Tauveron (2000, p. 42-52), répond à trois objectifs d’apprentissage :
[…] elle permet l’éducation d’un comportement de lecture spécifique qui suppose la mise en relation des textes déposés dans la mémoire culturelle du lecteur ; elle permet de construire et de structurer la culture qui en retour alimentera la mise en relation ; elle permet enfin, en tant que dispositif multipliant les voies d’accès au texte, d’y pénétrer avec plus de finesse, d’y découvrir des territoires autrement inaccessibles, d’éclairer des zones autrement laissées dans la pénombre. (p. 44)
Ces trois objectifs sont en constante interaction, même si un réseau ou un autre ne met l’accent que sur l’un des objectifs.
2.3. Présentation du réseau d’œuvres à l’étude
Dans le cadre de cet article, nous avons fait le choix de proposer un réseau d’œuvres s’articulant sur une gradation de l’interactivité, d’œuvres mobilisant peu d’action de la part du·de la lecteur·rice à des propositions nécessitant une implication soutenue.
Ce corpus a été sélectionné pour mettre en avant des œuvres traduites en français et disponibles au Québec, notamment pour que leur étude puisse être utilisée sur le terrain par la suite. Ce corpus privilégie des œuvres facilement accessibles à un jeune public. Bien sûr, étudier des propositions passionnantes et plus complexes à destination des adultes, permettrait de penser une suite à ce corpus. Toutefois, leurs mécaniques plus intriquées demandent une maitrise plus fine des gestes de lecture et d’activation de ces œuvres; de telles propositions ne se prêtent donc pas à une approche exploratoire.
Le corpus mobilisable est particulièrement dense, et d’autres exemples auraient pu être sélectionnés. Cet article ne vise pas à exclure d’autres propositions proches, mais à discuter concrètement d’œuvres marquant les formes, par une publication plus précoce ou par une densité particulière. Chacune des œuvres choisies permet d’aborder une mécanique narrative différente, le but étant de dresser un panorama formel et non une analyse rapprochée d’une de ces formes.
La pensée en réseau, demandée par le choix structurel du réseau d’œuvres, a structuré cette recherche. L’exploration de ce corpus s’inscrit plus largement dans nos recherches et suit une méthode plus exploratoire, nous poussant à tester un grand nombre d’œuvres pour ensuite les documenter en fonction de leur structure narrative et des gestes de lecture mobilisés. Cette approche comparative permet d’étudier des œuvres ludiques dans une perspective littéraire et d’aborder des questions de réception intimement liées aux questionnements sur l’évolution des narrations contemporaines. Cette approche ne nous permet pas de présenter ici une analyse de chaque récit et de chacune de ses branches, mais nous permet une focalisation sur l’expérience globale offerte.
3. Comprendre les mécaniques narratives grâce à la construction de la narration
Le réseau d’œuvres qui est mobilisé au sein de cet article, afin de discuter des points saillants d’analyse nécessaires à ce corpus, a pour but d’incarner un exemple parmi d’autres. Le choix a été fait de ne retenir qu’une seule œuvre pour chaque type de mécanique afin de proposer une plus grande diversité d’application des concepts discutés, sans omettre toutefois que d’autres exemples pour chacune pourraient être envisagés.

Le corpus à l’étude ici peut trouver place dans de nombreux réseaux d’œuvres, permettant d’aborder différents éléments :
- Thématiquement, les œuvres interactives peuvent offrir de plonger dans des enjeux de l’imaginaire, notamment pour comprendre au mieux les récits d’enquêtes ou les romans policiers, en permettant aux lecteur·rice·s d’incarner directement un·e acteur·rice de ces investigations.
- Un réseau générique peut proposer de plonger dans la fantasy ou la science-fiction en offrant un complément à des œuvres plus traditionnelles, permettant aux jeunes d’aborder des formes de narrations importantes dans la culture populaire et numérique qui les entoure.
- Un réseau lié à un procédé d’écriture peut également être une option pour valoriser les pratiques d’écritures permettant l’interactivité. Qu’il s’agisse de narrations modulaires ou d’écritures purement interactives ou génératives, le corpus permet de nombreuses ouvertures. Après avoir expérimenté ces œuvres, des ateliers d’écriture peuvent être mis en place pour créer de nouvelles œuvres interactives, mais ces œuvres peuvent également être prises comme prompts d’écriture.
Bien que dans cet article, l’enjeu ne soit pas de développer précisément leur mise en place, l’usage concret des réseaux d’œuvres en classe est documenté dans ces mêmes études. Notons, toutefois, que les œuvres interactives à l’étude se prêtent particulièrement à des ateliers ludiques et des travaux d’équipe; cependant, les dynamiques de chaque groupe seront à prendre en compte pour cela.
3.1. Comprendre les narrations modulaires
Les narrations modulaires sont des narrations reposant sur un ensemble d’éléments déjà décrits, fixés, mais que le·a lecteur·rice agence selon ses envies ou selon des règles fixées par l’œuvre. C’est le principe sous-tendant la célèbre œuvre de Raymond Queneau, Cent mille milliards de poèmes (1961), qui demande au·à la lecteur·rice d’agencer divers fragments de poèmes pour en former de nouveaux. Cette pratique existe dans diverses œuvres d’avant-garde et de poésie contemporaine, bien que ce ne soit pas le corpus qui la met le plus en pratique.
Cette forme ludique de structuration de texte et d’histoire permet d’aborder la composition pour des publics jeunes. Ainsi, nous pourrions étudier Le Chemin de Claude Ponti (2023). Cette œuvre jeunesse est une proposition illustrée composée de plusieurs éléments : 21 cartes cartonnées, présentant une illustration inspirée de l’univers des albums de Claude Ponti sous-titrée d’une phrase, un livret, un petit album jeunesse, un leporello présentant d’un côté une histoire en couleur, de l’autre une histoire à trous en noir et blanc. Le livret et le leporello présentent trois compositions différentes d’agencement des cartes également présentes dans le coffret. Chacune des cartes comporte une partie d’histoire comme « Alors qu’Émile Tonne observe les gens qui passent… » ou « Tandis que la maison saute par-dessus les dormeuses… », un fragment d’événement « À 9 h 27, départ en vacances, en voiture et en famille… », ou une description de situation « Dans un paysage se cachent des secrets… »; elles permettent de façonner de nouvelles histoires, changeant toujours les propositions. L’œuvre ne présente que peu de règles, et l’élément pouvant se rapprocher le plus d’une consigne se trouve dans le résumé du livret : « Il y a des milliards de milliards de chemins différents possibles… à toi d’inventer les tiens ! » La narration est modulaire, parce qu’elle repose sur un ensemble de fragments fixes, les cartes, mais qui sont libres dans l’ordre dans lequel elles sont lues.
Cette œuvre est une proposition très simple, destinée à un jeune public, permettant de familiariser ces lecteur·rice·s à des formes innovantes de littérature.
3.2. Penser les échanges entre narrations ludiques et littéraires
Le concept des livres-dont-vous-êtes-le-héros est attribué à Edward Packard, l’auteur de La Grotte du Temps(The Cave of Time (1979) dans sa version originale) et R. A. Montgomery, un éditeur indépendant. Ce fut l’une des premières littératures interactives contemporaines où le·a lecteur·rice endosse un rôle actif dans la progression de l’histoire. Ce genre se distingue par une structuration du récit en fragments offrant des choix multiples. Chaque fragment narratif se termine par un choix, une alternative proposant deux possibilités ou plus, chacune accompagnée d’un numéro de page ou d’un numéro de fragment permettant d’aller à l’élément narratif suivant correspondant à chacun de ces choix. Chaque choix mène à une section différente, permettant à chacun·e de façonner le récit en fonction de ses choix propres, offrant de multiples chemins et souvent plusieurs fins alternatives. La narration est le plus souvent à la seconde personne, renforçant l’immersion.
Cette forme narrative prend la forme la plus traditionnelle du corpus à l’étude dans cet article, les romans-dont-vous-êtes-le-héros revêtant la forme de romans usuels. Si ces derniers étaient particulièrement populaires dans les années 1980, il est à noter que ces romans reviennent sur le devant de la scène avec la popularisation des narrations ludiques contemporaines2.
Nous avons pu aborder plus tôt une narration modulaire exemplaire pour la jeunesse, mais ces mêmes principes sont également mobilisés dans des œuvres à destination d’un public adolescent, jeune adulte. Pour la reine (For the Queen dans son édition originale) est un jeu de construction d’histoires basé sur des cartes créé par le designer, lauréat du prix Diane Jones, Alex Robert. For the Queen est d’abord paru chez Evil Hat Productions (2018), puis chez Darrington Press (2021) dans une édition enrichie de nouvelles cartes et de nouvelles illustrations. L’édition française, Pour la reine, a été publiée par Bragelonne3 Games en 2020. Le jeu est annoncé comme « a card-based storybuilding game » au dos de son édition originale.
Dans ce jeu, le·a joueur·euse-narrateur·rice incarne un personnage ayant toujours vécu dans un royaume en guerre lorsque la reine décide d’entreprendre un long et périlleux voyage afin de négocier une alliance avec une puissance lointaine et inconnue. L’histoire de départ est très brève :
The land you live in has been at war for as long as any of you [les joueur·euse·s] have been alive. (carte 2)
The Queen has decided to undertake a long and perilous journey to broker an alliance with a distant power. (carte 3)
The Queen has chosen all of you, and no one else, to be her retinue, and accompany her on this journey. (carte 4)
She chose you because she knows that you love her. (carte 5)
Le jeu propose 14 itérations très variées de la reine en autant de cartes, une reine que les joueur·euse·s choisissent pour ensuite construire leur récit en lien avec elle. Chacune fait écho à un imaginaire particulier. L’une est une figure de sorcière traditionnelle, une vieille femme au nez crochu avec des plantes dans ses cheveux défaits; une autre fait écho aux mythologies vikings; une autre encore est une sorte de démon à la peau rouge vif ornée de symboles mystérieux, et ainsi de suite. Ces représentations jouent sur le mégatexte de fantasy, et influent les narrations construites par les joueur·euse·s pouvant alors mobiliser des éléments des corpus en lien avec le mégatexte choisi.
Les joueur·euse·s ne peuvent se baser que sur les illustrations pour, dans un second temps, construire l’histoire au travers des 46 cartes-questions permettant de développer l’univers. La modularité des choix narratifs pouvant être opérés offre une réjouabilité quasi infinie et permet à chacun·e de puiser à l’envie dans le mégatexte pour construire une œuvre unique. Chaque carte est un fragment de l’œuvre, mais moins directement narratif que pour Le chemin étudié précédemment, puisque chacune est une piste de lecture narrative. Leur combinaison est également un peu plus encadrée, puisque le départ de l’œuvre est donné et que les cartes sont piochées tour à tour et peuvent être utilisées ou défaussées (retournées et sorties du jeu).
L’œuvre pousse à une forme de narration orale, mais peut être utilisée comme départ de rédaction.
MicroMacro est une série de jeux d’enquêtes coopératifs conçus par Johannes Sich. La première itération, MicroMacro: Crime City, a été publiée en 2020 par Édition Spielwiese. Il a remporté le Spiel des Jahres et l’As d’or en 2020. L’univers du jeu est annoncé dans un court texte, présent au dos de la boite et en ouverture de la règle du jeu :
Welcome to Crime City – a city with crime lurking around every corner. Deadly secrets, sneaky robberies and cold-blooded murders are commonplace around here. The local police are no longer in control of the situation. Therefore, your investigative skills are now required!
Cette description de l’univers second du jeu est ensuite complétée par la carte-plateau qui constitue le matériel principal du jeu.
La particularité de ce jeu d’aventure narratif est que le plateau est une carte de 110 cm sur 75 cm représentant la carte d’une ville imaginaire et sur laquelle une très grande quantité de personnages accomplissent un certain nombre d’activités. La carte n’est pas figée dans le temps : il est possible de suivre de nombreux personnages à différents moments de la journée, dont certains s’adonnent à diverses activités criminelles.
Le jeu propose une série d’enveloppes contenant chacune un deck de 5 à 12 cartes. Chacune comporte un indice correspondant à un crime spécifique. Le but est que le·a joueur·euse résolve l’énigme, en retrouvant les différentes preuves, les victimes, les mobiles, ainsi que le coupable, composant ainsi une narration riche.
Le jeu n’impose aucune limite de temps et il est appuyé par un site internet proposant des enquêtes supplémentaires, ainsi qu’un mini-jeu en ligne.
Un sequel au jeu original, MicroMacro: Crime City – Full House, a été publié en 2021, suivi en 2022 par MicroMacro: Crime City – All In, qui proposait 16 nouvelles histoires, tandis qu’en 2023, est parue une nouvelle carte, MicroMacro: Crime City – Showdown.
Une particularité frappante est que si chaque édition peut être jouée indépendamment, les 4 cartes peuvent se regrouper pour former un tout plus vaste encore.
La manipulation des cartes-enquêtes donne des indices qui permettent peu à peu de résoudre les énigmes posées par la ville présente sous les yeux des joueur·euse·s. Ces différentes enquêtes peuvent être considérées comme des chapitres, constitués chacun de fragments – les cartes –, qui sont agencés pour former le récit global de cette agglomération.
La manipulation de l’œuvre repose sur des mécaniques connues de la littérature jeunesse, le cherche et trouve, mais aussi de la littérature numérique, reposant sur des mécaniques de point and clic.
Des œuvres plus purement ludiques, jouant sur les enjeux de plateaux, existent également. Le retour sur l’objet-livre est d’ailleurs l’objet d’Histoires de peluches (Stuffed Fables, dans son édition originale), un jeu de rôle coopératif créé par Jerry Hawthorne. Stuffed Fables est paru chez Plaid Hat Games en 2018, tandis que l’édition française, Histoires de peluches, est sortie la même année et a été publiée par Asmodee. Dans le jeu, le·a joueur·euse-lecteur·rice se retrouve dans la peau de peluches cherchant à sauver une fillette d’un génie maléfique, maitre des cauchemars, au sein d’un royaume fantastique nommé The Fall.
Cette aventure narrative se base sur un livre de jeu qui sert de référent de règles, de guide historique, mais également de plateau de jeu, qui offre de nombreux choix de narration, et ce, à l’aide de 5 dés.
Le livre est conçu comme un album jeunesse, faisant également office de plateau pour chacune des phases de jeu.
La popularité des jeux de campagne, qui reposent sur le progrès au sein d’une histoire qui sera propre au groupe qui la façonne (comme la partie de jeu vidéo, Reed, 2019). Ainsi, des œuvres comme Le dilemme du roi, où le groupe doit conseiller un monarque dans les décisions qui vont impacter le royaume et qui vont débloquer les prochains événements du jeu; ou Eila, jeu où le ou les joueur·euse·s incarnent une jeune lapine qui doit choisir sa voie et construire son parcours de vie dans une forêt. Ces œuvres, plus fortement ancrées encore dans la culture ludique, reposent toutefois sur des mécaniques narratives très fortes.
Conclusion
Bien sûr, de nombreuses autres œuvres pourraient être mobilisées pour étudier les narrations interactives selon l’âge des publics visés. Retenons cependant que c’est l’apprentissage des mécaniques narratives interactives et des gestes de lectures qui leur sont liés, qui permet ensuite aux jeunes de devenir acteur·rice·s des créations contemporaines populaires actuelles, qu’elles soient analogiques ou numériques. Plus encore, cela permet d’aborder les enjeux signifiants de ces gestes, comme nous avons pu l’évoquer, ainsi que la perméabilité des médias.
Ces œuvres ont un pouvoir sur la compréhension de la diversité des formes littéraires et la construction d’attentes variées et de compréhension large de ce que peuvent être les littératures de l’imaginaire. L’inclusion d’œuvres populaires dans le corpus offre une reconnaissance de la culture des jeunes et une ouverture à des cultures et corpus en cours de construction, qui peuvent les maintenir dans une position de curiosité.
L’ouverture de la littérature aux corpus hors du livre est importante pour maintenir un rapport entre les nouveaux·lles lecteur·rice·s et les diverses avant-gardes créatrices, notamment sur la construction de corpus ludiques narratifs venant revisiter les genres déjà établis en littérature traditionnelle.
Ces corpus posent également la question de la découvrabilité : leur séparation des corpus littéraires habituels, leur vente dans des boutiques ou des rayons séparés, mais aussi l’habitude de considérer le jeu comme une pratique à destination de la jeunesse, notamment pour les livres-jeux, rend l’expérimentation de ces œuvres plus ardue. L’importance de la culture ludique et sa place de plus en plus majeure dans l’espace médiatique confrontent les études littéraires à de nouvelles formes de narrations s’appuyant sur des mécaniques connues, mais adaptées à de nouveaux contextes, comme pour les narrations vidéoludiques (Vallières, 2023). Ces corpus, en cours de construction parallèle aux formes littéraires institutionnalisées, demandent de l’attention afin de ne pas être ignorés dans le corpus usuel : ces formes sont populaires, de nombreuses copies des œuvres ludiques dont il a été question sont vendues. Cette popularité nous indique une forme d’importance pour l’imaginaire des œuvres et pour les habitudes de consommation narratives du public. Or, une fois que des formes narratives se sont ancrées dans les pratiques, elles influent plus largement les corpus littéraires, comme cela a pu être le cas avec la science-fiction, donnant naissance à un corpus d’anticipation dans la littérature générale et expérimentale.
- Il s’agit principalement de verbes d’action suivi d’un complément simple décrivant l’objet de l’action comme « walk left » ou « go north », « take notepad » ou « watch clock », etc. ↩︎
- L’importance de Gallimard Jeunesse dans la diffusion du corpus en français est remarquable, notamment par son implication dans la publication de la première vague puis dans son retour depuis 2020. Il est à noter que le marketing de cette collection repose sur les mêmes mécaniques que les romans populaires de l’imaginaire, jouant également sur des codes rétro, empruntant aux codes graphiques des couvertures de boites de jeux vidéo rétro. ↩︎
- Le lien avec les littératures de l’imaginaire est ici particulièrement fort, Bragelonne étant une maison d’édition importante pour les littératures de genres, notamment pour la fantasy. Cet élément paratextuel participe de la réception du jeu comme œuvre de fantasy et influe également sur la manière de l’expérimenter. ↩︎
Anderson, T., Blank, M., Daniels, B., & Lebling, D. (1977). Zork. Infocom.
Besson, A. (2015). Constellations : des mondes fictionnels dans l’imaginaire contemporain. CNRS éditions.
Bouchardon, S. (2012). Du récit hypertextuel au récit interactif. Revue de la BNF, 42, 13-20. https://doi.org/10.3917/rbnf.042.0013
Bréan, S. (2012). La science-fiction en France : théorie et histoire d’une littérature. PUPS.
Bréan, S. (2018). La prescription littéraire en science-fiction française. Dans Chapelain, B. & Ducas, S. (éds.),Prescription culturelle. Presses de l’enssib. https://doi.org/10.4000/books.pressesenssib.9361
Bréan, S. (2022). Pour un usage externe des théories de la science-fiction. ReS Futurae. Revue d’études sur la science-fiction, 20. https://doi.org/10.4000/resf.11250
Broderick, D. (1995). Reading by starlight: postmodern science fiction. Routledge.
CCH, J. (2023). Eila et l’éclat de la montagne. Iello.
Cavallo, G., & Chartier, R. (éds.). (2001). Histoire de la lecture dans le monde occidental. Éditions du Seuil.
Chauvin, C., & Villagordo, É. (2017). Imaginaire informatique et science-fiction, du cyberpunk à nos jours. ReS Futurae, 10. https://doi.org/10.4000/resf.1180
Citton, Y. (2012). Gestes d’humanités : anthropologie sauvage de nos expériences esthétiques. Armand Colin.
Clément, J. (1994). Fiction interactive et modernité. Littérature, 96, 19–36. http://www.jstor.org/stable/41704639
Crowther, W., & Woods, D. (1976). Colossal Cave Adventure. CRL.
Eco, U. (1985). Lector in fabula : le rôle du lecteur, ou la coopération interprétative dans les textes narratifs. Grasset.
Emerit, L. (2016). La notion de lieu de corpus : un nouvel outil pour l’étude des terrains numériques en linguistique. Corela, 14(1). https://doi.org/10.4000/corela.4594
Escarpit, D. (éd.). (2008). La littérature de jeunesse : itinéraires d’hier à aujourd’hui. Magnard.
Gygax, G., & Arneson, D. (1974). Dungeons & Dragons: Rules for Fantastic Medieval Campaigns Playable with Paper and Pencil and Miniature Figures. TSR, Inc.
Hach, H., & Silva, L. (2020). Le dilemme du roi. Iello.
Hayles, N. K. (2008). Electronic Literature: New Horizons for the Literary. University of Notre Dame Press.
Hawthorne, J. (2018). Stuffed Fables. Plaid Hat Games
Hawthorne, J. (2018). Histoires de peluches. Asmodee.
Hommel, É. (2017). Lectures de science-fiction et fantasy : enquête sociologique sur les réceptions et appropriations des littératures de l’imaginaire [Thèse de doctorat, Université de Lyon]. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01679661
Huz, A. (2022). Démêlés avec le novum : démontages et remontages de la notion dans une perspective culturelle intermédiatique. ReS Futurae. Revue d’études sur la science-fiction, 20. https://doi.org/10.4000/resf.11338
Landragin, F. (éd.). (2018). Comment parler à un alien : langage et linguistique dans la science-fiction. Le Bélial’.
Langlet, I. (2006). La science-fiction : lecture et poétique d’un genre littéraire. Armand Colin.
Lescouet, E., & Décamp, F. (2021). Jeux de société, narrations et applications : entretien. Carnet de la Fabrique du Numérique. https://carnet.fabriquedunumerique.org/jeux-de-societe-narrations-et-applications/
Lescouet, E. (2022). Gestes de lecture numérique et lecture immersive de science-fiction. ReS Futurae. Revue d’études sur la science-fiction, 20. https://doi.org/10.4000/resf.11250
Lescouet, E. (2023). La science-fiction des réseaux, des profils mégatextuels ? Journée d’études organisée par Alexandra Saemmer, Documenter les littératures des profils. Université de Montréal.
Lescouet, E., & Vallières, A. (2023). Dystopie et séries young adult : former l’imaginaire politique des adolescent·e·s. RELIEF – Revue Électronique de Littérature Française, 17(1), 82–100. https://doi.org/10.51777/relief17561
Lescouet, E., & Vitali-Rosati, M. (2022, mai 31). Documenting Electronic Heterogenous Literature. ELO (Congrès). https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/26694
Masure, A. (2017). Design et humanités numériques. Éditions B42.
Moran, P. (2018). Mise en scène du choix et narrativité expérientielle dans les jeux vidéo et les livres dont vous êtes le héros. Sciences du jeu, 9. https://doi.org/10.4000/sdj.1010
Packard, E. (1979). The Cave of Time. Bantam Books.
Ponti, C. (2023). Le chemin. L’École des loisirs.
Queneau, R. (1961). Cent mille milliards de poèmes. Gallimard.
Ray, A. (2019). Traduire les termes du futur : Analyse du traitement des termes-fictions dans la traduction de l’anglais au français de la littérature de science-fiction [Thèse de doctorat, Linguistique, Université d’Orléans].
Reed, A. A., Murray, J., & Salter, A. (2019). Adventure Games: Playing the Outsider. Bloomsbury Academic. https://doi.org/10.5040/9781501346576
Robert, A. (2018). For the Queen. Evil Hat Productions.
Robert, A. (2020). Pour la reine. Bragelonne Games.
Rosenthal, O., & Ruffel, L. (2010). Introduction. Littérature, 4(160), 3-13.
Saint-André, M.-D. de, Montésinos-Gelet, I., & Bourdeau, R. (2015). Intégrer la littérature jeunesse en classe à l’aide de réseaux littéraires. Documentation et bibliothèques, 61, 22–31.
Saint-André, M.-D. de, Montésinos-Gelet, I., & Charron, A. (2022). Soutenir la créativité des élèves du primaire par des activités métatextuelles et hypertextuelles dans les réseaux littéraires. Revue de Recherches en Littératie Médiatique Multimodale, 16.
Sich, J. (2020). MicroMacro: Crime City. Édition Spielwiese.
Sich, J. (2021). MicroMacro: CrimeCity – Full House. Édition Spielwiese.
Sich, J. (2022). MicroMacro: Crime City – All In. Édition Spielwiese.
Sich, J. (2023). MicroMacro: Crime City – Showdown. Édition Spielwiese.
Sidhu, P., & Carter, M. (2021). Exploring the Resurgence and Educative Potential of ‘Dungeons & Dragons’. The Journal for Educators.
Soucy, É. (2023). Quelles sont les pratiques déclarées d’enseignants du primaire utilisant une approche intégrée du français ? Canadian Journal for New Scholars in Education, 14.
Szpirglas, M. (2022). Écrire de la fiction pour vivre la théorie des organisations : le roman dont vous êtes le héros, un dispositif pédagogique innovant. Revue française de gestion, 304, 107-122. https://doi.org/10.3166/rfg.304.107-122
Tauveron, C. (2000). Pour une pratique en résonance des textes littéraires à l’école. Langage & pratiques, 25, 42-52.
Tauveron, C. (éd.) (2002). Lire la littérature à l’école : pourquoi et comment conduire cet apprentissage spécifique ? De la GS au CM2. Hatier.
Vallières, A. (2023). (Ré)Concilier jeux vidéo et littérature numérique. Sciences du jeu, 20-21. https://doi.org/10.4000/sdj.6036
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net