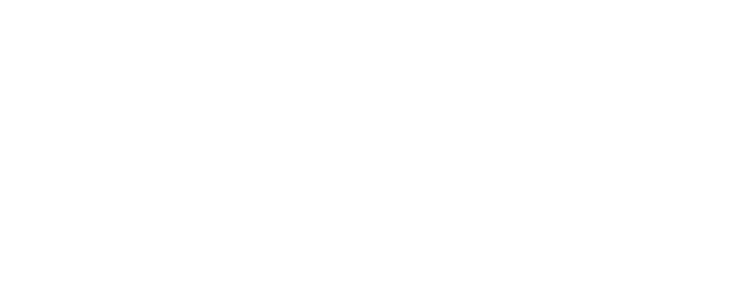L’expérience de la collaboration dans l’enseignement et la production d’une création artistique à l’université
La collaboration dans les cours d’arts plastiques s’établit grâce à un amalgame d’étudiant·es, de matériaux, d’idées et de compétences. Cet assemblage de facteurs humains et non humains peut créer des expériences pédagogiques uniques pour les étudiant·es au premier cycle universitaire. L’idée de l’artiste comme génie solitaire persiste depuis le modernisme, malgré le fait que de nombreuses galeries, biennales et foires d’art ont accepté la collaboration comme mode de création artistique. Dans cette étude, nous examinons les expériences en collaboration des étudiant·es en création au sein de groupes d’étudiant·es, d’artistes professionnel·les et issus des institutions postsecondaires.
Collaboration in the studio art classroom is an amalgamation of students, materials, ideas, and skills. This assemblage of human and non-human factors can create unique pedagogical experiences for students. However, the idea of the artist as a lone genius persists from modernism despite the fact that many galleries, biennials, and art fairs have embraced collaboration as a way of art making. In this article we look at the experiences of students, professional artists, and post-secondary instructors who utilize collaboration.
Introduction
En tant qu’artiste et éducatrice chargée d’enseigner le cours de premier cycle en éducation artistique intitulé Professional Practice for Art Educators (Pratique professionnelle pour les éducateurs artistiques), je me suis demandé en quoi consistent les pratiques professionnelles pour les artistes et les éducateur·rices d’arts communautaires. J’ai travaillé sur de nombreux projets artistiques en collaboration avec différent·es collaborateur·rices et j’ai commencé à réfléchir à la manière dont ces expériences m’ont aidée à devenir une meilleure artiste et une meilleure éducatrice. En travaillant avec les autres, j’ai appris à mieux me connaitre et à mieux communiquer. Je suis intéressée par l’intersection de l’éducation et des arts plastiques parce que les enseignant·es reproduisons la manière dont ils avaient appris à faire les choses, tant dans la pratique artistique que dans l’enseignement.
La collaboration dans la classe d’arts plastiques s’établit grâce à un amalgame d’étudiant·es, de matériaux, d’idées et de compétences. Cet assemblage d’actrices et d’acteurs humains et non humains peut créer des expériences pédagogiques uniques pour les étudiant·es. Il peut également créer un réseau de soutien qui aide les étudiant·es au début de leur carrière d’artiste et d’enseignant·e en arts plastiques. L’idée de l’artiste comme génie solitaire persiste depuis le modernisme malgré le fait que de nombreuses galeries, biennales et foires d’art ont adopté la collaboration comme mode de création artistique, avec des expositions comme le collectif General Idea au Musée des beaux-arts du Canada en 2022, ou des œuvres collaboratives et participatives à la biennale Manifesta.
Dans cette étude, j’ai examiné les expériences de collaboration artistique entre des étudiant·es, des artistes professionnel·les et des professeur·es universitaires. Les projets de collaboration englobent une grande variété de pratiques, notamment l’art sonore, le land art, la sculpture et la conservation muséale. Ces formes d’art comprennent souvent des éléments techniques complexes qui peuvent être mieux réalisés par plusieurs personnes travaillant ensemble. À partir de l’expérience de travailler ensemble des étudiant·es, et artistes professionnel·les, l’étude suggère d’adopter une orientation de travail en collaboration qui peut encourager les enseignant·es à planifier des travaux collaboratifs dans leur classe.
Cette étude s’appuie sur la phénoménologie pour décrire les expériences des participant·es. La phénoménologie permet une description approfondie des expériences des participant·es, mais elle ne tient pas pleinement compte de l’agentivité des acteurs non humains et privilégie le sujet humain parce que tous les objets existent dans le cadre de la perception qu’en ont les personnes. C’est pourquoi la théorie de l’acteur réseau (Latour, 2005) a été utilisée pour tenir compte de ces facteurs non humains tout en privilégiant l’expérience du·e la participant·e. J’ai eu recours à la méthode de l’entretien de recherche afin que les participant·es racontent leurs expériences en privilégiant à la fois leur relation avec leurs collaborateur·rices ainsi qu’avec les matériaux et les technologies qu’elles et ils ont utilisés.
Cet article est organisé en huit sections : l’introduction, l’analyse bibliographique, la méthodologie, les constats, les recommandations, les limitations et la discussion de la recherche ainsi que la conclusion.
1. L’analyse bibliographique
1.1. Qu’est-ce que la collaboration ?
Bien que cette question semble à première vue assez simple, il est utile de rappeler que la collaboration s’exerce dans le cadre d’un large éventail d’activités, du travail d’idéation collective à la prise de toutes les décisions relatives à un projet par le biais d’un consensus. O’Meara et MacKenzie (1998) décrivent ces activités dans deux catégories générales : hiérarchique et dialogique. Dans le domaine des arts, une pièce de théâtre serait probablement hiérarchique, avec tous les acteur·rices, metteur·ses en scène, machinistes, etc., qui travaillent ensemble à la réalisation d’un objectif commun, mais il existe une hiérarchie claire et définie pour la prise de décision. Deux danseur·ses qui improvisent ensemble, en revanche, sont plus proches de l’approche dialogique.
Ce large éventail d’activités, par exemple, un acteur qui suit les instructions d’une réalisatrice, deux danseurs qui improvisent ensemble, deux artistes qui planifient une exposition dans laquelle elles prennent chacune la direction de différentes parties, rend difficile l’élaboration d’une définition commune de la collaboration. Dans le cadre de cette recherche, les participant·es se situaient dans l’ensemble du spectre de la collaboration, de l’élaboration d’une idée en commun et de la fabrication de différents objets artistiques à la réalisation de l’ensemble du travail par le biais d’un consensus.
1.1.1. Coopération ou collaboration
Malgré une définition relativement large, tous les types de travail de groupe ne sont pas synonymes de collaboration. Thomson et Perry (2006), qui viennent du milieu de l’administration des entreprises, affirment qu’il doit y avoir un résultat souhaité commun pour que le travail de groupe soit collaboratif. À titre d’exemple, les communautés de pratique (CdP) ne relèvent pas toujours de la collaboration. Selon Wenger (1999), dont le travail est ancré dans l’apprentissage social et l’éducation, les communautés de pratique (comme celles entre des artistes, des étudiant·es ou des équipes sportives) sont des groupes de personnes qui créent ensemble une pratique en déterminant les membres et les conditions de cette pratique. Cela permet de construire une identité de groupe, qui évolue au fil du temps et qui aide à définir les comportements acceptables au regard des normes établies. Les membres des CdP apprennent des autres membres du groupe par le biais de pratiques formelles et informelles; les membres reproduisent les normes et les comportements qu’elles et ils observent. Les artistes, par exemple, apprennent à parler des œuvres d’art en participant et en observant les autres lors de critiques. Il s’agit d’un processus important, mais pas d’une collaboration.
Dans le cadre d’une collaboration, les objectifs du projet doivent être déterminés ensemble, grâce à une compréhension commune du processus artistique. Il faut développer ce processus en tant que groupe, et cela nécessite un dialogue. Cela demande aussi de l’ouverture et du temps.
Alors que les membres d’une CdP apprennent les un·es des autres grâce à des normes et des pratiques communes (comme celles d’une profession) sociales et culturelles (par exemple, le recours aux activités d’appréciation critique dans les classes d’arts plastiques), la collaboration implique de son côté un engagement plus marqué envers un objectif commun.
1.1.2. Importance des compétences dans la collaboration
Chercheur dans le domaine de la gestion et du commerce, Michael Schrage estime, dans Shared Minds: The New Technologies of Collaboration (1990), que la collaboration est un moyen de mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons. En utilisant des compétences à la fois compatibles et divergentes, la collaboration nous permet d’interagir avec d’autres personnes ayant des connaissances différentes des nôtres et d’apprendre grâce à elles. Schrage affirme également que la collaboration met à profit des outils distincts qui créent diverses valeurs, et que le langage et la communication sont les outils les plus importants de la collaboration. Ceux-ci sont importants dans le cadre de la théorie de l’acteur-réseau et permettent d’engager des acteur·rices qui font la différence dans le réseau (Latour, 2005). En guise d’exemple, la communication s’effectue différemment en personne et à l’aide d’une application de messageries; même un moyen simple comme consigner des règles de conduite sur une feuille de papier peut changer la façon dont on interagit au sein d’un groupe.
La collaboration permet également de développer des compétences humaines. Al Hurwitz (1993), chercheur dans le domaine de l’éducation, suggère que la collaboration crée la confiance entre les collaborateur·rices et a une valeur socialisante. Hurwitz estime que la collaboration devrait mettre l’accent sur le processus plutôt que sur le produit, en permettant aux étudiant·es de réfléchir ensemble. Cela permet aux matériaux et à la technologie de faire la différence au sein de la collaboration, en changeant la façon dont les collaborateur·rices interagissent, et en faisant un modification dans le résultat du projet, et ce, en devenant des participant·es actif·ves. Cela contribue à tisser des liens non seulement entre les personnes, mais aussi entre les matériaux.
Schrage (1990) et Hurwitz (1993) ont tous deux affirmé que les compétences interpersonnelles ainsi que le matériel et les technologies font une différence dans la collaboration. Selon leurs écrits, le succès de la collaboration repose sur le fait d’apprendre à connaitre son·a collaborateur·rice et de comprendre comment le matériel et les technologies influencent le fonctionnement et la dynamique du travail commune. Cet amalgame de personnes, de matériaux et de technologies sera exploré plus en profondeur dans cette étude.
1.1.3. Les dynamiques de pouvoir dans la collaboration
Il existe un autre acteur important au sein de la collaboration, qui affecte les interactions des autres acteur·rices, il s’agit du pouvoir (Leiby et Henson, 1998). Il est très peu probable, mais pas impossible que le pouvoir détenu par deux collaborateur·rices soit égal. Il ne s’agit pas d’un défaut, mais plutôt d’un élément qui doit être pris en compte dans le réseau ainsi constitué. Ce pouvoir peut être issu de la dynamique sociale, de la classe socio-économique ou d’autres facteurs. Cela peut devenir encore plus complexe dans les grands groupes de collaboration.
Ann Leiby et Leslie Henson, dans « Common Ground, Difficult Terrain: Confronting Difference Through Feminist Collaboration » (1998), suggèrent d’avoir recours à ce qu’elles nomment la collaboration féministe comme point de départ pour examiner la dynamique du pouvoir. Elles ont étudié les collaborations entre des éducateur·rices à l’université. Elles suggèrent que les enseignant·es et les élèves reconnaissent les dynamiques de pouvoir qui découlent de leurs expériences passées et la manière dont elles peuvent affecter leurs pairs. Leiby et Henson ont recommandé que nous nous engagions dans notre propre résistance à ceux·lles qui sont différent·es de nous et que nous nous interrogions sur la cause de cette résistance. Elles reconnaissent que le milieu académique est hostile à la collaboration et privilégie plutôt les dynamiques d’autorité et d’individualité.
Il existe une différence de pouvoir évidente entre les élèves et les enseignant·es au sein de la classe, mais il est également important de reconnaitre qu’il peut y avoir une différence de pouvoir entre les élèves en raison de facteurs, tels que le sexe, l’ethnie, l’âge et le statut socio-économique. Ces différences peuvent jouer un rôle important dans la collaboration des élèves.
1.2. Collaboration dans la salle de classe en arts plastiques
Au fil du temps et des différentes périodes artistiques, les pratiques de collaboration ont été perçues différemment. Il est important de comprendre comment et pourquoi ces changements ont eu lieu, et quelles sont les attitudes qui influencent aujourd’hui notre vision de la collaboration. Dans cette étude, il s’agit des différents niveaux de collaboration, d’une part, prendre toutes les décisions ensemble, d’autre part, travailler ensemble pour trouver un concept et puis sur la fabrication de manière indépendante.
1.2.1. Remise en question du génie solitaire
Les pratiques d’enseignement actuelles sont fortement influencées par l’idée moderniste de l’artiste génial solitaire. Dans The Author, Art and the Market: Rereading the History of Aesthetics (1994), Martha Woodmansee retrace l’idée du génie solitaire dans les arts en faisant appel à l’histoire de l’art et elle constate que les idées de paternité ont considérablement évolué au fil du temps. Woodmansee décrit comment, pendant une grande partie de l’histoire de l’art occidental, les artistes travaillaient dans des ateliers où les apprenti·es et les maitres collaboraient ensemble sur les œuvres d’art. Bien que cette situation soit hiérarchique, elle est aussi collaborative, puisque les maitres et les apprenti·es travaillent à la réalisation d’un objectif unique, l’œuvre d’art. Cela démontre que la perspective de l’artiste en tant que génie solitaire est une construction culturelle plutôt qu’une représentation de la manière dont les artistes travaillent généralement.
Karen Burke LeFevre utilise un cadre sociologique pour approfondir cette idée dans Invention as a Social Act (1987). Elle soutient que cette conception du génie solitaire dans le milieu académique et dans la culture populaire est une fiction et qu’elle n’a jamais été exacte, même pendant le modernisme. Burke LeFevre décrit comment tout travail se construit sur des systèmes partagés de langage et sur d’autres connaissances et pratiques qui l’ont précédé. Elle soutient que c’est le capitalisme qui pousse le récit du génie solitaire dans les arts et dans les universités. Nous devrions, selon elle, valoriser les pratiques collaboratives et chercher à exposer le travail non reconnu des collaborateur·rices qui permet des inventions, comme discuter des idées, donner des suggestions et être une caisse de résonance. Même si cette tendance commence à diminuer aujourd’hui avec le postmodernisme, on en observe toujours des traces dans le système de publication par auteur·rice; il doit y avoir un·e premier·ère auteur·rice, même lorsqu’un article est écrit en collaboration. Il y a aussi des artistes, comme Christo, qui ne voulaient pas nommer leurs collaborateur·rices en pensant que cela diminuerait la valeur de leurs travaux.
Karen E. Gover (2016) arrive également à une conclusion similaire dans « The Solitary Author as Collective Fiction », où elle considère l’artiste et l’écrivain·e comme une personne qui travaille au sein d’un amalgame complexe de systèmes. Gover sépare l’idée qu’un·e artiste peut avoir créé l’objet, comme une œuvre d’art ou un livre, de l’idée du·e la créateur·rice de génie. Elle suggère que nous pouvons considérer l’auteur·rice comme faisant partie d’un système complexe qui permet la création, sans rejeter l’idée qu’elle ou il a effectivement créé la chose. Ainsi, l’auteur·rice est en fin de compte responsable de la création, mais il ou elle a été aidé·e par une structure enchevêtrée de choses et de personnes. Cette approche est similaire au cadre défini par la théorie de l’acteur-réseau. Latour (2005) décrit les idées et les concepts comme faisant partie d’un réseau d’interconnexion entre les personnes, la nature et les facteurs sociaux.
Lorsque nous reconnaissons les systèmes nécessaires à la création et que nous rejetons l’idée du génie solitaire, nous ouvrons la voie à une autre compréhension de la collaboration dans les domaines de l’art et de l’éducation. Cela suggère une méthode de création plus ouverte qui reconnait les vastes contributions des personnes et des choses, comme les technologies, les idées des autres et les matériaux que l’artiste utilise.
Cela fait écho à Linda Brodkey qui a suggéré, dans Academic Writing as Social Practice (1987), que, lorsqu’on crée des œuvres artistiques, on entre dans une discussion déjà en cours, nos idées et nos créations sont en relation avec les œuvres qui ont été conçues avant les nôtres. Nos idées se fondent sur ce qui existe déjà. Selon Brodkey (1987), nous sommes influencé·es par les normes et les pratiques des différentes communautés auxquelles nous appartenons, et par leurs façons particulières de faire et de voir les choses. Pour travailler de manière collaborative, nous devons apprendre le langage et les procédures de l’autre. Brodkey considère la collaboration comme une expérience d’apprentissage et articule un discours autour du concept de la différence. Elle estime qu’il est important de maintenir les différences entre les personnes plutôt que de les invisibiliser dans le cadre de la collaboration. Ce type d’apprentissage permet aux étudiant·es de comprendre le monde non seulement à partir de l’expérience de l’enseignant·e, mais aussi à partir de l’expérience des autres étudiant·es dans la classe d’art. Ces interactions leur permettent de mieux comprendre les expériences de vie et les préférences esthétiques de leurs camarades. Cela peut signifier approfondir l’appréciation des autres styles d’art, ou des autres méthodes et façons de fabriquer des objets.
Tout au long de l’histoire de l’art, les artistes se sont appuyés sur les œuvres qui les ont précédés. L’art repose sur le partage d’idées, de compétences et de techniques, et n’est pas créé sans le contexte qui le précède. De nombreux mouvements artistiques du XXe siècle, tels Fluxus, l’art conceptuel et le dadaïsme, ont réfuté l’idée de l’artiste comme génie solitaire (LeFevre, 1987), mais cette idée persiste encore pour beaucoup.
1.2.2. Empathie, réciprocité et collectivité
Les compétences interpersonnelles sont nécessaires pour une collaboration réussie. Dans « Empathy, Surviving, Collective Reflexivity », Murray et al. (2016) se sont penchés sur la manière dont nous abordons les rapports avec nos collaborateur·rices. L’empathie est un mode d’être qui permet de s’impliquer dans la vie de l’autre. L’empathie nous permet de prendre en compte les valeurs des autres et de nous poser la question « Devons-nous ? » plutôt que « Pouvons-nous ? ». Cela implique une réflexivité et un engagement continu entre les collaborateur·rices.
L’article de Katerina Reed-Tsocha, « Collective Action and the Reciprocity of Friendship » (2016), examine le rôle de l’amitié dans l’action collective. Reed-Tsocha définit l’amitié comme une identification empathique avec l’autre. L’amitié implique d’être ouvert·e et vulnérable à l’autre, et comporte donc à la fois des risques et des avantages. Lisa Tillman-Healy a également décrit l’amitié dans « Friendship as Method » (2003), et comment l’amitié a son propre rythme, son propre contexte et sa propre éthique qui la façonnent, comme la collaboration. Tillman-Healy a déclaré que, lorsque les amitiés transcendent les groupes sociaux, elles prennent une dimension politique où la personne dominante peut défendre l’autre. Elle a eu recours à cette conception de l’amitié en étudiant la vie d’un groupe d’hommes homosexuels au sein d’une équipe de baseball qu’elle a intégrée. L’amitié nécessite une réciprocité, ainsi que la création d’un langage commun. Les considérations éthiques doivent également être prises en compte lorsqu’il y a un déséquilibre de pouvoir au sein de l’amitié. La personne qui a le plus de pouvoir doit être consciente de la manière dont les décisions sont prises, et si ses opinions priment sur celles de ses collaborateur·rices.
Peter Batt et Sharon Purchase, dans « Managing Collaboration Within Networks and Relationships » (2004), soulignent également l’importance de la confiance dans la collaboration en entreprise. Pour cultiver cette confiance, un·e collaborateur·rice peut être amené·e à mettre de côté ses intérêts immédiats pour se concentrer sur les objectifs de la collaboration. Pour cultiver l’amitié, ce qui est immédiatement le plus bénéfique pour une personne doit parfois être mis de côté pour soutenir l’autre. La confiance permet une communication ouverte, une qualité que Batt et Purchase (2004) ont également décrite comme nécessaire à la collaboration.
D’un point de vue philosophique, Michelle Boulous Walker suggère, dans Slow Philosophy (2016), qu’être lent·e, attentif·ve, ouvert·ve et généreux·se permet d’entrer en contact avec l’autre sans se l’approprier. Elle décrit une ouverture aux idées des autres où on essaie de les comprendre mieux. Cela crée un lien entre l’autre et soi-même, qui nous permet de nous rencontrer sans annihiler l’autre ni s’annihiler soi-même. Cette ouverture prend du temps et est transformatrice. Elle retarde le jugement et maintient l’ambiguïté des actions qui peuvent également s’appliquer à la collaboration. Plutôt que de porter un jugement immédiat sur une idée ou un processus, cela permet de prendre le temps de bien comprendre le contexte et les expériences qui y ont conduit, c’est-à-dire d’entendre l’autre sans le·a juger.
Si on comprend l’impact des autres, les histoires et les contextes qui influencent notre production artistique, cela peut nous aider à réfléchir aux moyens de collaborer. À titre d’exemple, on peut se demander : quelles expériences et quels processus sont identiques à ceux des personnes avec qui nous collaborons ? Lesquels sont différents ? Quels sont les points forts de ces similitudes ? Quelles sont ces différences ? Les textes traitant de l’amitié suggèrent qu’un processus s’apparentant à l’amitié (ouverture, curiosité et création de valeurs communes) pourrait être bénéfique à la collaboration. Il est également important de garder l’éthique interpersonnelle au premier plan de la collaboration, car il se peut que l’on doive mettre de côté ses désirs immédiats pour pouvoir travailler avec l’autre. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il y a un déséquilibre de pouvoir entre les collaborateur·rices, qui peut être causé par plusieurs facteurs, comme le sexe, l’âge ou l’expérience professionnelle.
2. Méthodologie
Cette étude combine la phénoménologie et la théorie de l’acteur-réseau pour guider les entretiens et l’analyse des données. La phénoménologie privilégie la description profonde de l’expérience vécue comme moyen d’appréhender le monde. Edmund Husserl (1976) pensait que la science essayait d’adapter les phénomènes aux théories existantes plutôt que l’inverse. C’est pourquoi il estimait qu’il faut revenir à l’expérience comme source de toute connaissance. En utilisant la description profonde, Husserl supposait que nous pouvons atteindre l’essence (ou les qualités essentielles) des phénomènes. Pour ce faire, nous devons mettre de côté nos présomptions sur le phénomène et, ainsi, le voir d’un œil nouveau, ce qui est différent de la manière dont nous interagissons avec les objets dans notre vie quotidienne, ce que Husserl appelait l’attitude naturelle. En guise d’exemple, pour manger, nous n’avons pas besoin de réfléchir aux qualités d’une cuillère, nous la voyons et connaissons son usage. Mais, en utilisant une approche phénoménologique, nous devons penser aux qualités qui en font une cuillère : elle a un manche, un bout arrondi et sphérique pour retenir le liquide. Une cuillère peut être en métal, en bois ou en plastique et rester une cuillère, elle peut être petite ou grande, mais certaines caractéristiques sont nécessaires pour qu’elle soit une cuillère. La phénoménologie affirme que nous vivons toutes et tous dans le même monde; même si nous avons des expériences différentes, nous pouvons parvenir à la même compréhension de l’essence des phénomènes en mettant de côté l’attitude naturelle.
Le problème de la phénoménologie est qu’elle se concentre sur le sujet humain, lui conférant un pouvoir d’agentivité, et minimisant le pouvoir d’agentivité des autres et des objets. On voit les autres seulement en relation avec notre expérience; agissent-elles et agissent-ils comme nous le ferions dans la même situation (Husserl, 1977) ? Cela signifie que nous ne voyons les autres qu’à travers notre propre prisme, en comparaison avec nous, plutôt qu’en tant qu’agent·e unique. La théorie de l’acteur-réseau (Latour, 2005) donne également la priorité à la description approfondie et s’inspire, à bien des égards, de la phénoménologie, mais elle permet au monde objectif d’agir, les acteurs non humains peuvent avoir un pouvoir d’agir dans la situation.
Latour (2005) soutient que notre compréhension du social, et de sa relation avec la réalité, est erronée. Il affirme que le social est créé par les relations entre les acteur·rices, plutôt qu’il en est la cause, et que nous surestimons l’importance des êtres humains dans la construction de la réalité. Dans la théorie de l’acteur-réseau, Latour affirme que nous devrions traiter les acteur·rices humain·es et les acteurs non humains de manière symétrique, et que les acteurs devraient être considérés comme tout ce qui fait une différence, et ne doivent donc pas nécessairement être des objets animés. Ces acteurs forment un réseau par le biais d’associations appelées un assemblage et, par la force, peuvent faire entrer de nouveaux acteurs dans l’assemblage. Chaque acteur est influencé par les autres acteurs du réseau. Les points de passage obligés incluent et excluent certains acteurs de l’assemblage. Pour décrire le réseau, le·a chercheur·euse doit suivre les acteurs qui s’y trouvent, plutôt que d’imposer des limites ou des frontières à l’avance. Le·a chercheur·euse et les objets de recherche font également partie du réseau et ne peuvent en être séparés; l’assemblage n’existe pas sans le·a chercheur·euse. Les réseaux ne sont pas statiques, mais peuvent devenir plus ou moins durables grâce à la force des connexions entre les acteurs.
La théorie de l’acteur-réseau traite les personnes, les objets et les idées qui font la différence, qui ont le pouvoir de changer le résultat, comme des acteurs et rendent compte de leur agentivité dans le récit. Cela crée un réseau de choses, humaines et non humaines, qui font la différence (Latour, 2005). Cet aspect est particulièrement important dans le cadre de cette étude, car, dans la collaboration, les matériaux et les technologies impliqués modifient la manière dont les collaborateur·rices interagissent. Même si la différence peut sembler minime, le fait de prendre en compte l’agentivité des objets modifie la manière dont nous interagissons avec le monde. Isabelle Nizet et Réjane Monode Ansaldi (2017) suggèrent que les objets, abstraits ou concrets, peuvent être le lien, ou objet frontière, entre les acteur·rices humain·es. Les objets peuvent aider à créer une identité commune entre les humain·es. Dans la théorie de l’acteur-réseau les objets frontières aident à former le réseau en créant des liens entre les autres acteur·rices. Les interactions ne relèvent pas uniquement de notre pouvoir subjectif, mais sont influencées par des facteurs non humains; dans le cas de l’art, il s’agit de nos matériaux artistiques, de nos modes de communication, du contexte historique dans lequel nous vivons. Ces facteurs vivent en dehors de nous et continuent d’exister même quand nous ne sommes plus là.
Par conséquent, cette étude s’appuie sur les méthodes de la phénoménologie, tout en tenant compte de l’agentivité des choses à faire une différence. Il s’agit de la manière dont les acteurs non humains affectent nos interactions et notre compréhension des situations. Une façon simple d’y penser est de se demander comment nous communiquons avec nos ami·es différemment par message texte, au téléphone ou en personne. Le téléphone portable devient un acteur important de la conversation.
Les entretiens ont permis aux participant·es de décrire leurs expériences en se concentrant sur leurs actions et leurs interactions, plutôt que d’interroger la théorie sur le pourquoi de ces actions. Les descriptions de l’expérience collaborative seront utilisées pour dégager l’essence du phénomène, en réfléchissant à la manière dont les expériences des étudiant·es se rejoignent et divergent, afin de nous aider à mieux comprendre ce que signifie collaborer.
L’éthique de cette étude a été examinée par le comité d’éthique de l’Université Concordia (Montréal, Canada). Étant donné que cette étude a été réalisée avec des étudiant·es de ma classe, qu’une tierce personne a présenté la recherche alors que je n’étais pas en classe et qu’elle a distribué des formulaires de consentement qui ont ensuite été scellés dans une enveloppe, je n’ai pas su qui avait accepté de participer à l’étude avant que les notes finales pour les travaux des étudiant·es ne soient remises. Les noms de tous·tes les participant·es ont été rendus confidentiels afin de protéger leurs collaborateur·rices ou, dans le cas des enseignant·es, les étudiant·es.
3. Données et analyse
Les données sur la collaboration utilisées dans cet article proviennent de trois sources : deux entretiens avec trois éducatrices en arts visuels au postsecondaire, trois entretiens avec des étudiant·es dans un cours d’art en atelier et deux entretiens avec des artistes professionnelles qui collaborent entre elles. Les trois éducatrices travaillent dans deux universités canadiennes, deux dans une ville de taille moyenne, l’autre dans une grande ville. Deux sont titularisées, et une est à temps partiel. Les étudiant·es ont fait leurs études dans plusieurs programmes, mais ont pris le cours « Professional Practices for Art Educators » à la faculté des beaux-arts de l’Université Concordia. Les deux artistes sont à mi-carrière et ont travaillé plusieurs fois en collaboration.
Les éducatrices travaillent avec des étudiant·es au premier cycle. Elles ont demandé à leurs étudiant·es de réaliser un projet artistique en collaboration. Ces projets étaient fortement déterminés par les étudiant·es, bien que, dans tous les cas, ils étaient soumis à toutes les restrictions de COVID-19, qui étaient différentes selon les lieux. Les éducatrices ont été interrogées sur la manière dont elles organisent leurs cours, déterminent la réussite du projet et interagissent avec leurs étudiant·es.
Les étudiant·es ont été invité·es à travailler ensemble pour choisir un thème et réaliser une œuvre artistique en commun. C’est une démarche très autonome. Elles et ils suivaient le même cours et ont pu choisir leurs collaborateur·rices, ainsi que les matériaux et les concepts de leurs projets. Elles et ils ont également été autorisé·es à déterminer la profondeur de la collaboration et la mesure dans laquelle elles et ils ont travaillé ensemble et de manière indépendante. Il s’agissait uniquement d’étudiant·es de premier cycle.
Les deux artistes venaient d’horizons différents, mais vivaient toutes les deux au Canada au moment de l’entretien. Elles avaient des pratiques très différentes, l’une se basant sur l’art conceptuel et la performance, l’autre travaillant principalement dans le domaine de la sculpture et du land art. Elles avaient toutes deux entrepris des collaborations à long terme, de trois ans ou plus.
La majorité des entretiens, à l’exception d’un seul, se sont déroulés sur Zoom en raison de plusieurs facteurs, notamment la différence de lieu et les préférences des participant·es. L’un des entretiens s’est déroulé en personne dans un lieu public choisi par un participant (un parc public). L’un des entretiens avec les éducatrices a également été réalisé avec deux éducatrices qui ont collaboré à un cours. Elles ont été interrogées ensemble, chacune s’appuyant sur les réponses de l’autre.
En utilisant une méthode phénoménologique, ces entretiens ont permis aux participant·es d’évoquer les expériences de collaboration qu’elles et ils ont vécu·es, tant sur les plans procédural qu’émotionnel. Le fait de demander aux participant·es de recréer leurs expériences étape par étape, comme le décrivent Petitmengin et al. (2019), a facilité ce processus. Dans le cas des enseignantes et des artistes, je leur avais d’abord demandé pourquoi elles et ils décidaient de s’engager dans une collaboration (dans leurs classes ou dans leurs processus artistiques) et, dans le cas des étudiant·es, comment elles et ils décidaient avec qui collaborer et sur quel projet artistique. Ensuite, elles et ils ont été invité·es à expliquer ce qui s’est passé et ce qu’elles et ils en ont pensé.
Ces données m’ont aidé à mieux comprendre les expériences des participant·es en matière de collaboration, ainsi que la manière dont leurs expériences se chevauchent et divergent. Dans la section suivante, nous examinerons les résultats et les points de recoupement pour nous aider à mieux comprendre la collaboration.
4. Constatations
À bien des égards, ces entretiens se sont recoupés, et trois grandes catégories ont permis d’organiser les expériences des étudiant·es, des artistes et des enseignant·es. Il s’agit de la flexibilité et de l’ouverture, de la structure et du processus, et de la communauté et des relations. La flexibilité et l’ouverture servent à décrire les relations des participant·es entre elles et eux, ainsi que les matériaux qu’elles et ils utilisent. La structure et le processus ont aidé les participant·es à naviguer dans l’échange d’idées nécessaire à la collaboration sans se préoccuper du résultat final. Enfin, la communauté et les relations constituaient la structure et l’éthique globales qui ont permis la collaboration. J’avais examiné de près ces trois catégories et la manière dont les éducateur·rices, les artistes et les étudiant·es les ont incarnées. Chaque collaboration était différente et englobait différents aspects de chaque thème.
4.1. Flexibilité et ouverture
Les éducateur·rices qui ont encadré des projets collaboratifs dans leurs classes étaient conscient·es que les étudiant·es auraient différents niveaux de confort par rapport à la collaboration, en particulier parce que les étudiant·es étaient encore dans des situations d’apprentissage à distance ou en mode hybride en raison de la pandémie de COVID-19. H. A. et S. L., qui ont enseigné ensemble dans une classe, ont discuté avec leurs étudiant·es de ce à quoi pourraient ressembler différentes collaborations. Les étudiant·es ont pu définir le niveau de collaboration qu’elles et ils souhaitaient pour leurs projets. Il s’agissait de niveaux de collaboration élevés, comme le fait de travailler ensemble pour réaliser une seule œuvre, et de niveaux de collaboration moins élevés, comme le fait de réaliser des œuvres sur un même thème et d’organiser une exposition commune. Les éducateur·rices devaient être ouvert·es aux différentes façons d’interpréter la collaboration et aux différents niveaux de confort des étudiant·es.
S. V., une autre professeure, a travaillé avec l’un·e de ses étudiant·e qui avait des craintes concernant la collaboration en raison de mauvaises expériences passées. Elle a rencontré cette étudiante à plusieurs reprises, pour faire le point avec elle et la soutenir tout au long du processus. Bien que cela n’ait pas été nécessaire en fin de compte, elle était disposée et ouverte à permettre à cette étudiante de travailler de manière indépendante si elle ne se sentait pas à l’aise pour collaborer avec d’autres.
Même si j’avais mes propres idées sur ce qu’était ou n’était pas la collaboration, les entretiens avec les éducateur·rices m’ont permis de réaliser que la flexibilité des niveaux d’engagement dans la collaboration était bénéfique pour les étudiant·es, en particulier pour celles et ceux qui avaient eu de mauvaises expériences dans le passé. À l’origine, j’avais prévu que tous les groupes réaliseraient ensemble une œuvre d’art, mais, compte tenu de ce que j’ai entendu sur les expériences des autres éducateur·rices, j’ai décidé de laisser les étudiant·es prendre ces décisions en tant que groupe. En ayant moins de contrôle sur les paramètres des projets, j’ai dû m’interroger sur mes idées en matière de travail, de qualité et de capacité dans une classe universitaire. Ces étudiant·es avaient suivi des cours à distance pendant une grande partie des deux années précédentes; conséquemment elles et ils n’ont pas appris à se connaitre aussi bien qu’elles et ils ne l’auraient fait dans d’autres circonstances. Giguère et Lapointe (2020) ont conclu que créer et maintenir de la confiance est important pour la collaboration. En repensant à mes propres expériences en tant qu’étudiante de premier cycle, j’ai pu constater que la flexibilité dans les directives du projet permettait aux étudiant·es de mieux réussir.
Les étudiant·es disposaient également d’une grande flexibilité pour le choix des matériaux. S. V. a permis à ses étudiant·es de choisir n’importe quel matériel, à condition qu’il ne soit pas remis ou distribué en personne en raison de la politique COVID-19 de l’université alors en vigueur. Il s’agissait d’un échange d’art, où un·e étudiant·e s’appuyait sur le travail de l’autre et où cet échange se déroulait dans un sens et dans l’autre, sous forme numérique ou physique. H. A., S. L. et moi-même avons laissé les étudiant·es choisir le matériel qu’elles et ils souhaitaient, comme les enregistrements sonores, les matériaux recyclés, ou l’argile, ainsi que le concept du projet, comme les relations avec les lieux, la communauté et la mémoire. Dans leur cours, H. A. et S. L. ont eu un groupe d’étudiant·es qui a décidé de travailler un matériel assez restrictif avec lequel un membre n’était pas d’accord. Les enseignantes n’ont pas interféré avec cette décision, qu’elles soient d’accord ou non. Cela a permis au groupe d’avoir de l’autonomie et de tirer des leçons des décisions qui n’étaient pas idéales.
Les étudiant·es interrogé·es ont décidé du niveau de leur collaboration en fonction de deux facteurs : le temps dont elles ou ils disposaient pour le projet et leur familiarité avec leur collaborateur·rice. B. P., en particulier, a parlé de la difficulté de trouver du temps pour travailler en dehors des cours. Les étudiant·es ont utilisé la technologie, en particulier la vidéoconférence et le courrier électronique, pour travailler conjointement malgré leurs horaires différents. D’autres collaborateur·rices, comme T. D., ont utilisé des messages texte téléphoniques pour communiquer de manière asynchrone. Ces technologies ont joué un rôle important dans le projet, en facilitant la communication entre collaborateur·rices et de les rendre plus flexibles. Cette combinaison de technologies et de collaborateur·rices a permis aux étudiant·es de surmonter les contraintes de temps et d’espace. Cet aspect était particulièrement important compte tenu de la durée du projet (quatre semaines). Il s’agit d’une différence significative par rapport aux collaborations des artistes qui ont eu tendance à s’étendre sur plusieurs années.
Compte tenu de la courte période de collaboration, les étudiant·es ont opté pour différentes manières de travailler ensemble et séparément. B. P. et son collaborateur ont tous deux modifié leurs méthodes de travail pour se retrouver à mi-chemin. J. G. et sa collaboratrice ont créé une nouvelle méthode de travail basée sur leur intérêt commun, différente de celle que J. G. et sa collaboratrice auraient utilisée individuellement. T. D. et sa collaboratrice ont eu une idée commune et ont créé deux projets distincts avec les mêmes matériaux et les mêmes thèmes. Cette diversité dans les façons de collaborer montre l’importance de la flexibilité pour s’adapter aux différents styles de travail collaboratif. Les étudiant·es ont pu fixer les paramètres de leurs projets et de leurs collaborations.
Comme aucun·e des professeur·es n’a abordé les différentes manières de prendre des décisions en groupe, les étudiant·es ont fait appel à leurs expériences de vie pour décider de la manière de procéder. Comme indiqué ci-dessus, les étudiant·es ont pris différentes décisions en fonction de leurs préférences : un groupe a pris toutes les décisions ensemble, un autre a pris des décisions de manière indépendante dans un cadre convenu, et le troisième a emprunté à ces deux approches.
Les deux artistes ont travaillé pendant de nombreuses années pour la plupart de leurs collaborations, ce qui a permis d’établir une relation profonde entre les collaborateur·rices. Le collectif de C. J. a expérimenté différents processus de prise de décision au fil du temps, et a également modifié les objectifs du projet au fur et à mesure de son déroulement. Le changement des objectifs du projet a permis aux artistes de répondre aux différentes relations avec les personnes et l’espace dans lequel elles travaillaient, c’est-à-dire dans une rue de la communauté. La relation entre L. S. et sa collaboratrice a également évolué au fil du temps, car elles ont développé différentes façons de travailler ensemble au cours de leurs dix années de collaboration, qui se poursuit encore aujourd’hui. Cela a permis aux collaboratrices de s’adapter aux différents besoins du projet et de leur vie quotidienne au fil du temps. Au fur et à mesure de leur travail, elles ont réussi à mieux se comprendre et à mieux connaitre les terrains sur lesquels elles travaillaient. Elles ont développé ces relations à force des activités quotidiennes nécessaires sur un site hors réseau de distribution (sans électricité ni eau courante), telles que le jardinage, le débroussaillage des sentiers et la cuisine commune, en plus de faire du land art. Ces interactions informelles, comme boire un café ensemble, deviennent une partie importante de la construction d’une relation de collaboration, et ont été mentionnées par les deux artistes dans leurs entretiens.
4.2. Structure et processus
Bien que la flexibilité et l’ouverture soient importantes pour la collaboration, une structure doit être mise en place pour que les collaborateur·rices puissent s’y retrouver. Pour les enseignant·es, il s’agissait de plans d’études, en particulier de descriptions de projets et des fiches d’évaluation qui aidaient les étudiant·es à comprendre ce qu’elles et ils étaient capables de faire et dans quel délai. Les artistes, de leur côté, ont pu créer leurs propres formes de structure, comme les réunions hebdomadaires, des règles ou des manifestes, qui ont été ajustées en fonction des besoins du projet et des individus. Plus les personnes impliquées dans la collaboration étaient nombreuses, plus ces structures devenaient complexes. Ces systèmes plus complexes ont permis d’intégrer des voix multiples dans des collaborations même lorsque la prise de décision devenait plus compliquée.
Pour maintenir la flexibilité et l’ouverture, il faut une structure qui aide à guider le processus. La structure du projet peut être dictée par les collaborateur·rices et peut inclure des règles de collaboration, des horaires de réunion structurés, des contraintes matérielles ainsi que d’autres éléments. Les contraintes structurelles créent des lignes directrices pour le déroulement des collaborations et les décisions à prendre en groupe. Dans certains cas, les structures sont restées stables, tandis que, dans d’autres cas, elles ont été modifiées au fil du temps en fonction des besoins. C’est cette structure qui a permis aux collaborations d’avancer.
S. V. a donné à ses étudiant·es l’idée d’un échange matériel comme point de départ à leur collaboration. Étant donné que ce cours était entièrement en ligne et que les étudiant·es n’étaient pas autorisé·es à se rencontrer en personne, S. V. a considéré l’échange comme un moyen productif d’entamer une collaboration. Les étudiant·es ont pu échanger des travaux artistiques de toutes les manières possibles sans contact physique, et en utilisant des moyens électroniques, tels que le courrier électronique, le courrier, en laissant des travaux dans des lieux publics, et en interagissant avec des projections vidéo en superposant leurs œuvres comme moyens de créer ensemble sans se rencontrer en personne. L’existence de ce message-guide a permis aux élèves d’avoir un point de départ pour leur discussion. H. A. et S. L. ont commencé le projet par un remue-méninge en groupe, ces groupes étant ouverts et permettant aux étudiant·es de passer de l’un à l’autre, s’ils ou elles le souhaitaient. Cela a permis aux groupes de trouver leurs propres thèmes et structures, sans obliger les étudiant·es à s’engager dans le groupe pour le processus de fabrication. Cela a aussi permis aux groupes de générer des idées et de contribuer aux idées des autres. H. A. et S. L. ont également fixé des échéances pour le processus tout au long du projet, en vérifiant le progrès du projet avec les groupes à chacun de ces moments. À titre d’exemple, après deux semaines, les étudiant·es devaient présenter leurs concepts aux professeurs. Cela leur a permis d’obtenir un retour sur leur travail avant la remise du projet final et de s’assurer de leur progression tout au long du projet.
Les étudiant·es ont mis en œuvre des processus et des structures qui ont été d’une grande aide pour naviguer dans leurs collaborations. J. G. et sa collaboratrice ont pris toutes leurs décisions, à l’aide d’une vérification mutuelle avant de prendre des décisions définitives. Elles ont aussi créé un horaire avec des dates fixes pour travailler ensemble. J. G. connaissait bien sa collaboratrice, ce qui leur a permis de prendre facilement des décisions par consensus. T. D. et sa collaboratrice, en revanche, ont trouvé ensemble un thème et un matériau, et ont réalisé deux œuvres séparément. Cela leur a permis de prendre elles-mêmes leurs propres directions esthétiques, tout en créant un projet cohérent. B. P. et son collaborateur ont utilisé une approche qui se situe entre celle de J. G. et celle de T. D.; ils ont pris de nombreuses décisions ensemble, mais ont également permis différentes interprétations et méthodes de création dans le cadre de leur projet, qui était une marche sonore. Cela a permis de maintenir certaines différences tout en continuant à travailler ensemble sur un résultat. Ces différentes structures ont permis d’obtenir des résultats différents, en fonction de la manière dont les collaborateur·rices voulaient travailler ensemble pour créer un concept en commun et des œuvres d’art distinctes. Comme nous le verrons avec les artistes, ces structures ne doivent pas nécessairement rester fixes et peuvent changer tout au long du projet.
Les artistes ont eu l’avantage d’une plus longue période de collaboration. La collaboration de L. S. avec son partenaire, qui s’est déroulée pendant plus de dix ans, a permis au processus de rester ouvert, de donner le temps d’apprendre à propos de la vie de l’une et l’autre et de leurs buts avant de commencer à fabriquer les œuvres. Elle et il ont développé des méthodes de travail basées sur le dialogue en cours de collaboration, et ont changé la façon dont elle et il travaillent ensemble au cours des années. Pendant leur collaboration, ils ont pu mieux comprendre les méthodes de travail de l’autre et s’y adapter intuitivement.
La collaboration de C. J. était plus structurée. Les collaborateur·rices ont créé un manifeste ensemble et l’ont périodiquement modifié, en rayant des éléments et en en ajoutant d’autres, en fonction de l’évolution des besoins de la collaboration. Les collaborateur·rices ont également essayé plusieurs méthodes de prise de décision et ont fini par désigner une personne comme roi ou reine, qui, après discussion, avait le dernier mot sur la direction que prenait le projet. Ce poste était occupé à tour de rôle par toutes et tous les collaborateur·rices.
Bien que les structures utilisées, par toutes les personnes impliquées, aient pu être adaptées aux besoins de la collaboration, elles étaient nécessaires pour permettre une communication et une prise de décisions cohérentes.
La collaboration nécessite à la fois un équilibre entre la flexibilité et l’ouverture, et la structure et le processus. Cet équilibre peut se modifier au courant des différentes phases de la collaboration ou au fur et à mesure que la confiance s’installe dans les relations entre les collaborateur·rices. Ces relations sont importantes, non seulement pour créer des œuvres d’art, mais aussi pour se sentir soutenu·e dans sa carrière, comme l’expliquent Tillman-Healy dans « Friendship as Method » (2003) et Burke LeFevre dans Invention as a Social Act (1987), où la solidarité se construit dans le cadre de la recherche et de la création artistique.
4.3. Communauté et relations
Le contexte des cours décrit ci-dessous joue un rôle important dans la motivation des éducateur·rices pour les projets de collaboration. Les cours décrits se sont déroulés en 2021 et 2022, pendant les protocoles de la pandémie de COVID-19. Ce virus, bien qu’invisible, était un acteur important dans chaque collaboration. Dans le cas des cours de H. A. et S. L., les étudiant·es avaient commencé à reprendre les cours universitaires en personne, le cours décrit était en ligne, mais l’université utilisait une méthode hybride à ce moment, avec des séances en personne et en ligne. De ce fait, plusieurs étudiant·es se rencontrent en personne pour la première fois. H. A. et S. L. ont noté que cette situation était d’une certaine manière bénéfique, car les groupes d’ami·es n’étaient pas aussi fermés qu’ils le seraient normalement et les étudiant·es étaient plus ouvert·es à l’idée de travailler avec de nouvelles personnes. La classe de S. V. était entièrement en ligne et l’université interdisait aux étudiant·es de se rencontrer en personne, même en dehors du campus.
Dans le cas de mon cours, qui a eu lieu plus tard que les deux autres, quelques étudiant·es avaient pris des congés ou étaient à temps partiel pendant la pandémie, et les cohortes d’étudiant·es étaient mixtes, avec certaines qui ont seulement fini un an d’université et d’autres qui suivaient leur dernier cours. J’ai noté que les groupes d’amitié étaient moins développés dans la classe, ce qui a permis aux étudiant·es d’être plus ouvert·es à travailler avec des personnes qu’elles ou ils n’avaient jamais rencontrées auparavant. Le projet de collaboration leur a également permis de construire ou de renforcer les liens qu’elles ou ils avaient déjà tissés avec leurs pairs.
Ce sentiment de connexion entre pairs, insuffisamment développé dans le cadre de l’apprentissage en ligne, a été un facteur de motivation pour toutes et tous les éducateur·rices, y compris moi-même. Le développement d’un réseau de soutien professionnel est une partie importante d’un parcours de formation universitaire et, en raison de l’apprentissage à distance, ce réseau n’était pas aussi fort que les autres années. Les projets de collaboration ont permis aux étudiant·es d’établir des liens entre elles et eux et d’apprendre de leurs pairs, une compétence qui les aide à construire des réseaux. Ces réseaux sont particulièrement importants dans le domaine des arts visuels, où les artistes travaillent souvent seul·es dans des studios après l’obtention de leur diplôme. Les artistes, en particulier L. S., ont parlé de l’importance des activités non artistiques, telles que les repas pris ensemble, dans le développement de leur relation de collaboration. Ce type d’activité, comme prendre un café pendant la pause, n’existe pas dans l’apprentissage à distance. H. A. et S. L. ont perçu l’importance de ce réseau de pairs, qui ont fortement motivé le projet de collaboration dans leur classe.
Les étudiant·es étaient plus inquiet·ètes que leurs formateur·rices en ce qui concerne la collaboration. Elles et ils s’inquiétaient de l’équité de la répartition du travail au sein du projet, et B. P. craignait de devoir modifier ses méthodes de travail habituelles. Bien que B. P. ait été réticent au début du projet, il a constaté que le fait de travailler avec son collaborateur lui a permis d’élargir sa pratique artistique d’une manière qu’il a appréciée. J. G. a travaillé avec quelqu’un qu’elle connaissait bien et en qui elle avait déjà confiance, ce qui a dissipé une grande partie de ses inquiétudes concernant la collaboration. D. T. et sa collaboratrice ont travaillé individuellement sur le même thème, évitant ainsi les préoccupations des deux autres étudiant·es. La possibilité de choisir leurs collaborateur·rices et de contrôler la profondeur de la collaboration a permis aux étudiant·es de se sentir en contrôle du processus et donc de s’y engager pleinement.
Les artistes ont développé un sentiment de solidarité envers leurs collaborateur·rices pendant de nombreuses années. Au fur et à mesure que la confiance s’est installée, elles et ils ont pu développer leurs projets et les adapter à leurs besoins. C. J. a estimé que la collaboration au cours de son diplôme de premier cycle lui a permis d’accéder à des occasions professionnelles qu’il n’aurait pas eues autrement, développant ainsi ses compétences en tant qu’artiste. Cela corrobore les sentiments de S. L. et H. A. concernant la collaboration à l’université et en début de carrière.
Les résultats suggèrent qu’il existe des expériences communes de collaboration entre les étudiant·es et les artistes professionnel·les, mais aussi des différences significatives, notamment en ce qui concerne le contrôle qu’elles ou ils exercent sur le processus de création, les artistes choisissant généralement avec qui et quand elles ou ils collaborent (c’est vrai que les étudiant·es peuvent choisir des collaborateur·rices parmi d’autres dans la classe, mais cela reste un choix limité), ainsi que la période de création. Les artistes interrogé·es ont souvent entrepris une collaboration comme un engagement à long terme, plutôt qu’un engagement à court terme, comme cela doit être le cas dans le cadre d’un semestre. Cela leur a permis de disposer d’une période plus longue pour apprendre à se connaitre et à connaitre les méthodes de travail de l’autre. Les éducateur·rices doivent donc en tenir compte lorsqu’elles ou ils conçoivent des travaux collaboratifs. Ce manque de temps a également exercé une pression supplémentaire pour que les étudiant·es soient performant·es et créent : plutôt que de se concentrer sur la mise en place du processus de collaboration, elles et ils se sont concentré·es sur la fabrication de l’objet d’art. Ces différences doivent être prises en compte lors de l’attribution de projets collaboratifs.
5. Recommandations
L’examen des expériences des étudiant·es qui ont travaillé sur des projets collaboratifs fait apparaitre plusieurs points communs qui peuvent nous aider à comprendre comment les étudiant·es peuvent travailler ensemble. La collaboration peut aider les étudiant·es à acquérir des compétences importantes, notamment en communication, et les aider à développer des relations au cours de leurs études de premier cycle. Ces compétences et relations créent des systèmes de soutien pouvant les aider à réussir leur début de carrière, car elles ou ils continuent à apprendre les un·es des autres et à se soutenir mutuellement.
Cependant, les étudiant·es ne savent pas automatiquement comment travailler ensemble, et il est important que les enseignant·es leur donnent la possibilité de se former, à la fois individuellement et en tant que groupe. Il est important de consacrer suffisamment de temps au projet pour que les étudiant·es puissent établir les relations et les compétences nécessaires à la collaboration.
Les discussions concernant les projets, ainsi que les stratégies de prise de décision avant que les groupes ne soient constitués, semblent bénéfiques pour les étudiant·es, car elles ou ils peuvent trouver ce qui leur convient le mieux, et cela élimine la pression de se sentir coincé dans un groupe. Pour les projets collaboratifs de plus longue durée, le fait d’avoir plusieurs petits résultats à fournir tout au long du projet peut aider les étudiant·es à ne pas perdre de vue leur tâche. Même dans le cadre d’un projet d’une durée d’environ un mois, il peut être utile de définir un objectif à mi-parcours. Cet objectif peut être défini par les collaborateur·rices elles et eux-mêmes ou par l’enseignant·e.
La technologie est également un moyen de communication important pour toutes et tous les étudiant·es interrogé·es. Elles et ils ont utilisé la messagerie texte, le courrier électronique et la vidéoconférence comme moyens de communication lorsque leur emploi du temps était serré, ou dans les cas où elles ou ils ne pouvaient pas se rencontrer à cause des restrictions dues à la COVID-19. Cela leur a permis de communiquer de manière asynchrone et d’éviter les déplacements pour les réunions. De plus, elles et ils ont pu se réunir, même lorsqu’elles et ils étaient physiquement séparé·es, et communiquer d’une manière différente de la communication en personne. La discussion sur les stratégies et les technologies de communication, y compris les technologies émergentes, et sur la manière dont elles peuvent aider à gérer le temps aidera les étudiant·es à planifier leur calendrier et leurs projets.
Les étudiant·es ont également pu apprendre à manipuler d’autres matériaux et les techniques de leurs collaborateur·rices. T. D. a découvert l’argile séchée au four grâce à son collaborateur et a également utilisé des vidéos YouTube pour en savoir plus sur l’utilisation de ce matériel. B. P. a été inspiré par l’ouverture d’esprit de son collaborateur, bien qu’ils aient tous deux des méthodes de travail différentes. J. G. et sa collaboratrice ont combiné leurs pratiques, utilisant leurs forces respectives pour créer un projet qu’aucun·e d’entre elles et eux n’aurait pu réaliser seul. Ces combinaisons de technologies, de matériaux et de collaborateur·rices ont donné naissance à des projets qui n’auraient pas pu exister sans tous ces éléments.
Bien que ces compétences puissent sembler évidentes à celles et ceux qui travaillent fréquemment en collaboration, les étudiant·es doivent recevoir un enseignement explicite pour développer ces compétences, tout comme pour l’acquisition de compétences numériques. Nous supposons souvent que les étudiant·es acquièrent naturellement des compétences alors qu’elles doivent être enseignées activement, comme celle des compétences en littéracie numérique (Kirschner et De Bruyckere, 2017).
L’amalgame des étudiant·es, des motivations des enseignant·es, du temps, des matériaux et des technologies permet de nouvelles façons de penser la création artistique dans la classe d’atelier. L’abandon de l’idée du génie solitaire dans les arts nous permet d’envisager d’autres façons de penser et de faire de l’art, et de déterminer quels objets, idées et personnes font une différence dans la collaboration. Cependant, il peut avoir de nombreuses difficultés à travailler ensemble dans la salle de classe de l’université.
6. Limitations et discussion
Favoriser la collaboration en classe peut poser de nombreuses difficultés. Les cadres de collaboration sont simples à certains égards, mais ils posent également de nombreux problèmes aux enseignant·es et aux étudiant·es. En guise d’exemple, l’établissement de relations prend du temps et les enseignant·es sont souvent censé·es couvrir de nombreux points dans leur cours. Les étudiant·es peuvent également s’inquiéter de la manière dont elle et ils sont noté·es lorsque le projet est plus ouvert et flexible. Cette focalisation sur les résultats peut entraver la manière dont les étudiant·es s’engagent dans le processus de collaboration.
Cette recherche s’est déroulée dans un contexte spécifique, soit pendant et directement après la pandémie de COVID-19 dans les universités canadiennes. Les étudiant·es suivaient des cours en ligne et étaient isolé·es les un·es des autres, ce qui a modifié la dynamique de la classe. Nous ne comprenons pas encore tout l’impact de cette période sur les jeunes, et certains résultats peuvent être moins applicables aux cohortes ultérieures. Le contexte canadien peut également donner lieu à une relation de collaboration différente de celle d’autres pays, qui valorisent plus ou moins la collectivité ou l’indépendance. C’est également le cas des personnes interrogées dans le cadre de cette étude, dont certaines étaient plus ou moins intéressées par la collaboration. L’étude de la collaboration dans différents lieux peut donner des résultats variables et des orientations variables. Cependant, les similitudes entre les collaborations avec différentes cohortes dans différentes villes, dans différentes régions, avec les politiques uniques, suggèrent qu’il existe des points communs dans la collaboration.
Conclusion
L’amalgame de compétences, d’idées et de perspectives qui résulte de la collaboration peut être utile à l’apprentissage des étudiant·es. C’est particulièrement vrai lorsqu’elles ou ils terminent leurs études et passent de l’apprentissage auprès de leur professeur·e à leur intégration dans la communauté artistique. Les liens que les étudiant·es établissent au cours de leurs études de premier cycle peuvent les aider à continuer d’acquérir les compétences dont elles ou ils auront besoin dans leur vie professionnelle tout en les soutenant au début de leur carrière. Ce sens de la communauté peut être particulièrement utile dans la pratique artistique, où l’on travaille souvent seul et où l’on est souvent rejeté.
En permettant aux étudiant·es de faire valoir leurs propres expériences, talents et perspectives dans le processus de collaboration, on leur donne non seulement le sentiment que leurs points de vue sont appréciés, mais aussi qu’elles ou ils peuvent apprendre de leurs pairs. Ce modèle d’ouverture aux autres est une orientation précieuse pour l’apprentissage tout au long de la vie.
Batt, P. J. et Purchase, S. (2004). Managing Collaboration Within Networks and Relationships. Industrial Marketing Management, 33(3), 169–174. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2003.11.004
Boulous Walker, M. (2016). Slow philosophy. Bloomsbury Academic.
Brodkey, L. (1987). Academic Writing as Social Practice. Temple University Press.
Burke LeFevre, K. (1987). Invention as a social act. Southern Illinois University Press.
Callon, M. (1999). Actor-network theory: The Market Test. Dans Actor network theory and After (pp. 181–196). Blackwell Publishers.
Gover, K. E. (2016). The Solitary Author as Collective Fiction. Dans Collaborative art in the twenty-first century (p. 65–76). Routledge.
Giguère, M.-H. et Lapointe, F. (2020). L’accompagnement et l’expérience au cœur d’une collaboration chercheur-CP. Formation et profession, 28(2), 120-123. http://dx.doi.org/10.18162/fp.2020.a204
Husserl, E. (1977). Cartesian Meditations: An Introduction to Phenomenology (D. Cairns, trad., éd. de 1977). Springer.
Hurwitz, A. (1993). Collaboration in Art Education. National Art Education Association.
Kirschner, P. A. et De Bruyckere, P. (2017). The Myths of the Digital Native and the Multitasker. Teaching and Teacher Education, 67, 135–142.
Latour, B. (1999). On Recalling ANT. Dans Actor network theory and After (pp. 15–25). Blackwell Publishers.
Latour, B. (2005). Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory. Oxford University Press.
Leiby, M. A. et Henson, L. (1998). Common Ground, Difficult Terrain: Confronting
Difference Through Feminist Collaboration. Dans Common Ground: Feminist Collaboration in the Academy (p. 173–192). State University of New York Press.
Murray, T., Albright, T. et Obcarskaite, E. (2016). Empathy, Surviving, Collective Reflexivity. Dans Collaborative Art in the Twenty-First Century (p. 94–104). Routledge.
Nizet, I. et Monod Ansaldi, R. (2017). Construction de bénéfices mutuels en contexte collaboratif : pistes théoriques et méthodologiques. Phronesis, 6(1-2), 140–152. https://doi.org/10.7202/1040224ar
O’Meara, A. et MacKenzie, N. (1998). Reflections on Scholarly Collaboration. Common Ground: Feminist Collaboration in the Academy (p. 209–227). State University of New York Press.
Petitmengin, C., Remillieux, A. et Valenzuela-Moguillansky, C. (2019). Discovering the Structures of Lived Experience: Towards a Micro-Phenomenological Analysis Method. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 18(4),691–730. https://doi.org/10.1007/s11097-018-9597-4
Reed-Tsocha, K. (2016). Collective Action and the Reciprocity of Friendship. Dans Collaborative Art in the Twenty-First Century (p. 105–113). Routledge.
Schrage, M. (1990). Shared Minds: The New Technologies of Collaboration. Random House.
Thomson, A. M. et Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. Public Administration Review, 66(s1), 20–32. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x
Tillman-Healy, L. (2003). Friendship as Method. Qualitative Inquiry, 9(5), 729–749. https://doi.org/10.1177/1077800403254894
Wenger, E. (1999). Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press.
Woodmansee, M. (1994). The Author, Art and the Market: Rereading the History of Aesthetics. Columbia University Press.
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net