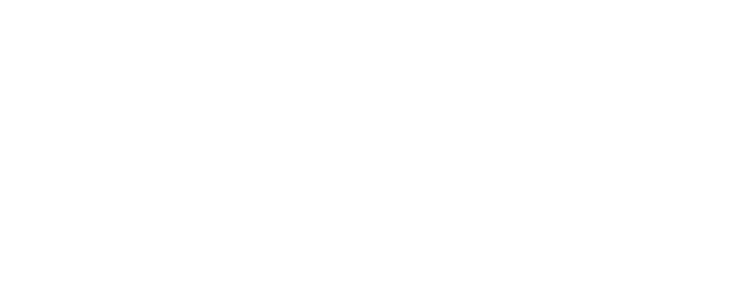Im-produire au moyen du dessin cartographique pour repenser les approches en éducation et en pratique artistiques
Cet article propose de faire le point sur les errances au cœur du projet Viser l’improductivité. Notre attention aux moments « im-productifs » prend racine dans la difficulté d’avoir des temps vacants pour explorer les impasses du processus créateur et dans le terreau de la recherche des systèmes de production actuels (Gillick, 2009). C’est un appel à observer les temps « inféconds » en recherche-création et en pédagogie, donnant à l’être ensemble et aux images « mal produites » collectivement toute leur place. L’objectif de cette recherche est d’examiner le rapport entre la fabrication de connaissances et la notion de productivité à l’aune de la pratique artistique et de la cartographie partagée (Olmedo, 2017). Nous traçons un portrait des expérimentations réalisées dans divers milieux : école, université, quartier et groupe de travail interdisciplinaire. Cet article s’inscrit dans une tentative de révéler les processus combinatoires en action dans leur création et leur recherche, tout en abordant les enjeux sociaux, éducatifs ou culturels qui se dégagent de cette recherche-création en développement.
This article aims to take stock of the wanderings at the heart of the Aiming for Unproductivity project. Our attention to “un-productive” moments is rooted in the difficulty of having free time to explore the dead ends of the creative process and the breeding ground for research in current production systems (Gillick, 2009). It is a call to observe “unfruitful” moments in creative and educational research, giving to the being together and to collectively “poorly produced” images their full place. The objective of this research is to examine the relationship between the production of knowledge and the notion of productivity in the light of artistic practice and shared cartography (Olmedo, 2017). We will draw a portrait of the experiments carried out in various environments: school, university, community and interdisciplinary working group. This article is part of an attempt to reveal the combinatorial processes in action in their creation and research while addressing the social, educational or cultural issues that emerge from this ongoing creation-based research.
Dans un contexte d’économie néolibérale, nous faisons face à une pression constante pour produire rapidement des savoirs, courir après les subventions, trouver des lieux de diffusion et augmenter sans cesse notre visibilité (Graw, 2005; Menger, 2022). Le rythme de nos vies s’accélère et le temps nous échappe (Mallet, 2013). Vettraino (2016), cité par Rosa (2023), rappelle que :
L’accélération n’épargne personne, ni aucune sphère de nos vies […]. Si elle affecte autant chacune et chacun de nous, c’est qu’elle régit en profondeur les structures des sociétés occidentales. Au point de nous faire perdre de vue ce qui constitue l’essentiel. (p. 1)
Nous sommes prises dans des contextes où les temps psychique, social et environnemental s’amincissent et se compressent (Guattari, 1989). Nous-mêmes sommes affectées par ce contexte, étant artistes en art visuel, chercheures et enseignantes, nous cocréons en duo et pratiquons la recherche universitaire, depuis 2017, avec difficulté. Nous devons lutter contre nos agendas pour nous accorder du temps commun. Cette recherche-création est née du besoin de fédérer nos différents espaces d’intervention et champs d’action pour dédier des moments à la création. En effet, il est indéniable que nos occupations professionnelles sont marquées par une pression à la production de savoirs et d’objets qui s’avère insoutenable pour les individus et la planète (Stengers et James, 2013). Nous voulons faire plus et plus vite dans des espaces-temps très diversifiés. Imposées par nos activités d’enseignement, de tâches administratives, de recherche, de diffusion, de production d’œuvres et d’exploration créative, nous sautons d’un lieu à l’autre et d’un mode de production à l’autre. Conséquemment, nos activités sont compartimentées entre l’université, l’atelier, les actions dans l’espace public, les milieux scolaires et communautaires.
Cet article présente les prémices du projet de recherche-création Viser l’improductivité comme manière de faire autrement en création, en recherche et en enseignement aujourd’hui. Cette recherche prend racine dans la difficulté que nous avons constatée de disposer de temps pour explorer les impasses et les errances traversées lors du processus créateur en plus de chercher à nourrir le terreau de la recherche dans les systèmes de production actuels (Berthet, 2021; Gillick, 2009). Ainsi, nous auscultons nos pratiques professionnelles, laissons libre cours à nos intuitions et profitons des occasions qui se présentent pour mieux saisir la singularité de nos expérimentations (Guattari, 1989; Rosa, 2023; Stengers et James, 2013). L’amorce de cette recherche nous amène déjà à identifier le cloisonnement existant entre nos divers champs de production et à cerner les gestes productifs et improductifs qui en émergent. Dans une perspective écoféministe, nous voulons repenser nos rythmes de vie et de travail pour un avenir plus soutenable pour nous, la société et la planète.
Ainsi, notre objectif est d’examiner la relation entre la fabrication de connaissances et la notion d’im-productivité, à l’aune de la pratique artistique, de la pratique enseignante et de la cartographie partagée (Olmedo, 2017). De ce fait,porter notre attention sur les moments im-productifs peut rendre lisibles certaines lignes de faille sous-jacentes. Le présent article s’attaque donc à cette question de manière initiale et directe. Nous mettons en lumière l’éparpillement que nous éprouvons dans notre pratique professionnelle subdivisée en quatre espaces de fabrication du savoir et du sensible, soit celui de la pratique de création en duo, celui de l’enseignement, celui de la recherche et celui de l’intervention dans l’espace public. Nous visons à les synthétiser au moyen d’une cartographie expérimentale et d’une méthodologie composite pour générer du sens au cœur de ces productions.
La rédaction de cet article est l’occasion de démontrer comment un amalgame de méthodes de recherche formelles et informelles nous permet de réfléchir à l’im-productivité. Nous choisissons d’intensifier une propension au tâtonnement, au bricolage méthodologique à même cet article. Afin de structurer notre pensée, nous avons repris librement la méthode des 4P mise à jour par l’Équipe LMM et présentée par Martel (2022) : soit les descriptions du portrait des actants impliqués dans cette recherche-création (P1) et du processus de cocréation (P2), de l’articulation du projet de recherche-création (P3) et les productions de 18 mois d’expérimentation (P4). En guise de conclusion, nous reviendrons sur l’état de nos objectifs de recherche et sur les perspectives qui s’ouvrent à nous.
1. Produire de l’art en collectif (P1 et P2)
Notre collaboration, en tant que duo d’artistes, s’est construite au fil des années par le soutien de l’une et l’autre dans nos projets respectifs, tant sur le plan technique que sur le plan théorique, jusqu’à développer des projets ensemble. Nous explorons les modalités de visibilité et d’invisibilité dans les milieux institués de l’art et de l’éducation (Butler, 2016; Holmes, 2007), mettant à l’épreuve la notion d’œuvre et sa production (Poulin, 2014; Wright, 2007). Nous sommes portées par un désir de créer des espaces communs en création, au sein même des cadres astreignants que nos rythmes de vie imposent. Nous souhaitons pratiquer la recherche à notre propre cadence tout en étant à l’écoute du tempo de chacune des personnes avec qui nous créons. De même, à titre d’enseignantes, nous nous intéressons à la place attribuée à l’art dans le système d’éducation, à la variation des approches dans les projets de création et à l’importance de la multimodalité. Dans notre démarche, elle se pratique entre dessiner, parler, écrire, capter et projeter sons ou images pour créer un tout multisensoriel.
1.1. Qui sommes-nous ?
Avant de débuter ce projet, chacune de nous, dans sa pratique singulière, a cocréé avec des personnes invisibilisées, des personnes considérées comme improductives dans notre société, parfois qualifiées d’« êtres jetables » (Butler, 2016). À titre de chercheures-artistes, nous pratiquons une interdisciplinarité spécifique, dans une approche interartistique, en ce que nous cherchons « à désigner des praxis avant toute chose » (Lesage, 2016, p. 22). Plus spécifiquement, bien que nous venions d’horizons artistiques différents, notre rencontre émerge dans le faire collectif.
Camille Courier, artiste visuelle, mène une démarche de création en dessin. Elle crée en grand format et in situ, avec des médiums numériques et traditionnels. Son rapport au dessin s’organise à partir du champ élargi ou expanded drawing (Saillant et Courier, 2023). Depuis 2019, elle réalise des projets participatifs. Ses œuvres lient l’agir artistique et politique en interdisciplinarité. Sa recherche doctorale a porté sur les relations entre gestes de dessiner, parcours d’exil actuels et actions micropolitiques, au doctorat en études et pratiques des arts (UQAM). Engagée dans la recherche-création, elle est également enseignante : chargée de cours à l’UQAM, puis à l’Université Laval et professeure d’arts visuels de la Ville de Paris (France).
Artiste en arts visuels et professeure au baccalauréat en enseignement des arts de l’Université Laval, Claude Majeau crée depuis 2008 des dispositifs artistiques favorisant la participation de personnes en situation de marginalisation. Ses projets suscitent la rencontre dans un jeu de dévoilement, d’appropriation et de singularisation individuelle et collective. Les lieux, les contextes et les récits des personnes participantes dictent les matériaux et les formes pour proposer des images d’affirmation collective présentées en marge des institutions. Sa recherche doctorale portait sur la réalisation et l’analyse d’un projet de création d’art militant avec des personnes mal logées regroupées au sein de comités logements. Voulant comprendre en quoi l’artiste suscite des rapports différents aux savoirs collectifs, elle avance que non seulement les artistes proposent d’autres manières de faire, mais elles et ils agissent sur la création de communs par le geste performatif de dessiner la rencontre (Rancière, 2004a). Pour elle, l’art propose, entre autres, à des personnes qui ne maitrisent pas bien le langage oral et écrit, de faire valoir leur point de vue différemment, et il constitue un catalyseur de l’être ensemble.
1.2. La cocréation pour l’engendrement de communs
Le processus de création collaboratif est au cœur de notre pratique artistique commune, comme de nos approches respectives en recherche. La collaboration artistique favorise l’élargissement des possibilités dans la manière d’aborder et de réaliser un projet (Marguin, 2019). Lors de la cocréation, il se joue une mise en commun des compétences, des connaissances et des incompétences qui permet une resingularisation des personnes et la possibilité de faire plus ensemble (Butler, 2016; Guattari, 2013/2018). Ce processus se prolonge aussi au moment d’interpréter et d’analyser les gestes posés. Le dialogue collectif génère des savoirs pratiques et théoriques pluriels. Nous pratiquons donc une cocréation entre artistes, à titre de duo, et également une cocréation avec des personnes participantes, en phase avec les contextes où nous sommes, dans le cadre de projets communautaires ou scolaires.
Ce choix du nous est résolument politique, puisqu’il s’agit d’une remise en cause des manières de faire de l’art et de la figure de l’artiste essentiellement individualiste (Lamoureux, 2009; Helguera, 2011). Nous cherchons à vivre des rencontres « individuantes » (Morizot et Zhong Mengual, 2018). Comme l’expliquent si bien ces auteur·es, à « la différence de la fausse rencontre et de la non-rencontre, la rencontre individuante laisse des traces précises : elle module notre trajectoire d’individuation » (p. 83). L’individu se transforme en tissant la rencontre, en interagissant avec les autres, avec le vivant et le non-vivant, et en devenant aussi agent·e de son milieu. De même, notre rapport à la création et aux personnes participantes s’inscrit dans une approche transpédagogique et écoféministe. Helguera (2011) propose le néologisme « transpédagogie » en se référant aux projets qui mêlent processus artistiques et « éducatifs » dans des œuvres offrant une expérience clairement différente des académies d’art conventionnelles ou de l’éducation artistique formelle. Le terme est apparu par nécessité de décrire un dénominateur commun dans le travail d’un certain nombre d’artistes échappant aux définitions usuelles utilisées autour de l’art participatif. C’est aussi parce que ces pratiques n’entrent pas non plus dans les approches en art axées davantage sur la production d’œuvres à interpréter, ou la pratique relevant de la médiation culturelle ou de l’apprentissage des savoir-faire artistiques. La transpédagogie est à la fois au cœur du processus de création participatif et de l’œuvre. Ces œuvres créent leur propre environnement autonome, la plupart du temps en dehors de tout cadre académique ou institutionnel.
La création collective permet de développer des communautés à l’extérieur des balises du système de production (Federici, 2022; Poulin, Preston et Airneau, 2019; Stanton, 2024; Zhong-Mengual, 2021). Comme le mentionne Stanton (2024) :
« Les communs » [sont] comme un espace qui engendre des « communautés instantanées », mais également comme une pratique qui reconnaît la nécessité de la négociation — en particulier lorsqu’on veut cultiver l’implication citoyenne démocratique dans des formes artistiques socialement engagées. (p. 1)
Conséquemment, le travail collectif se déploie dans le faire autrement, en particulier hors des stratégies de mesure quantitative (Lamoureux, 2009; Rollot, 2018; Zhong-Mengual, 2021). Ainsi, la création collective s’inscrit dans l’approche de « l’hypothèse collaborative » (Rollot, 2018), centrée sur ce qui se partage et non sur ce qui se possède. Rollot (2018) met l’accent sur les ressources urbaines latentes.
[…] Ces “ressources” que représentent chacune des unions collaboratives ici explorées sont à comprendre en termes d’énergies créatrices, de capabilités potentielles [propres aux personnes participantes] (Nussbaum 2012) (p. 210)
Définitivement, la création collective et collaborative exige, autre autres, de prendre du temps pour connaitre le milieu dans lequel l’artiste se retrouve, pour établir une relation de confiance avec les personnes participantes, pour respecter le rythme d’expression des personnes participantes, pour les outiller afin qu’elles puissent cocréer pleinement au cours du processus de création et de décision (Polliart et Majeau, 2024; Majeau, 2022). En ce sens, Marguin (2019) explique que si, d’un côté, le collectif produit plus lentement, de l’autre, il produit des œuvres à plus grand déploiement et possède davantage de potentiel de dépassement, puisqu’à plusieurs, on explore une panoplie augmentée de possibilités. Ce choix est donc, pour elle, un autre mode de production qui implique des im-productions si on le compare au rythme de travail individuel, comme le démontre sa recherche.
1.3. La résonance
La cocréation décélérante est aussi une réponse à l’accélération de nos vies. Comment laisser place à la dissonance et à l’inconfort que génère ce ralentissement du temps ? Comment nos corps et nos pensées peuvent-ils arriver à ne plus disposer des choses, des gens et de l’environnement, mais à entrer en résonance avec ces Autres et à agir autrement ? Dans un contexte de projet collectif, il devient crucial d’établir un projet commun pour canaliser les énergies créatrices dans des directions qui se fécondent mutuellement. À cet effet, le concept de résonance, tel que développé par Rosa, est très éclairant. La résonance surgit lorsqu’un élément déclencheur vient toucher personnellement ou collectivement les personnes participantes, ou encore les élèves en classe. Elle se caractérise lorsqu’un individu entre dans un état de relation avec quelqu’un ou quelque chose qui l’entoure, en l’écoutant, en se laissant ébranler et en y répondant. La résonance est aussi politique dans la manière dont on réagit et dont on formule nos réponses. Elle implique, pour l’artiste ou l’enseignante1, d’opter pour une posture de « maitre ignorant » comme le décrit Rancière (2004b).
Pour Rosa (2023), la résonance est une forme de relation ou de connexion qui relève de notre présence au monde et implique une attitude d’ouverture, un désir de comprendre et une réaction par la modulation de notre participation aux divers mondes, notamment ceux de l’art (Schaeffer, 2015). La résonance implique aussi une certaine fermeture, un repli, pour répondre avec sa propre singularité. Ce constat de Rosa est particulièrement intéressant dans la collaboration, puisqu’il reconnait la nécessité de (p)réserver une partie de soi pour contribuer au collectif. Si la résonance se déplace, et transforme le projet initial, peut-elle devenir im-productive ?
2. Cadre du projet im-productif (P3)
Le projet im-productif s’inscrit dans un flux de préoccupations en art actuel et d’enjeux sociétaux et environnementaux. Il est en dialogue avec les œuvres et processus créatifs de plusieurs artistes, comme Melik Ohanian (Zone of No Production, Datcha Project), Victoria Stanton (Rest/Resist), Julien Prévieux (Lettres de non-motivation), proposant de suspendre l’activité ou de subvertir la signification de la production en art. Envisageant ces visées improductives depuis d’autres points de vue, le duo d’artistes formé par Marion Laval-Jeantet et Benoît Mangin met l’écologie, comprise comme la science interrogeant nos conditions d’existence, au cœur de leur démarche artistique. À titre d’exemple, ce duo baptisé Art orienté objet tente de déjouer l’objectification et la spéculation financière associées à la création artistique, au profit de « la création d’objets vivants » (https://artorienteobjet.wordpress.com/). Ces divers artistes mobilisent l’improductivité de manière inspirante pour notre projet.
2.1. L’injonction à produire
L’injonction à produire, liée à l’association temps/argent/visibilité, génère une tension importante dans nos vies personnelles et professionnelles. Elle pèse lourd, en particulier pour des pratiques artistiques collaboratives dans lesquelles le temps long s’impose pour produire ensemble (Courier, 2023, Majeau et Polliart, 2020).
L’exigence silencieuse d’atteindre des résultats existe également en enseignement des arts, où la dynamique de création prévoit des phases et des mouvements itératifs (Gosselin et al., 1998) qui peinent à se mettre totalement en place dans un contexte demandant une créativité sur commande, dans des temps scolaires contraints. Boutinet (2010) précise que :
Il ne saurait pas y avoir de linéarité entre conception et réalisation, mais bien circularité créative au travers de cette itérativité qui se soucie très tôt, dès le temps de la conception, de mettre à l’épreuve d’une première forme de concrétisation de telle ou telle partie [du projet]. (p. 75)
Et, que dire du caractère imprédictible intrinsèque au processus de création comme aux résultats ? Menger (2022) rappelle qu’il n’y a pas une intention qui mène la production, mais des moments intentionnels et que le mouvement créatif est aussi ancré et confronté aux limites de la temporalité. D’autant plus que le processus de création tout comme la conduite d’un projet ne sont pas linéaires. En ce sens, nombreuses sont les recherches sur la créativité qui nomment le nécessaire « temps autre » au cœur du processus de création : temps d’incubation (Wallas, 1926), temps de jachère ou d’errance (Gillick, 2009), temps consacré aux activités adjacentes au processus créateur (Menger, 2022), temps de questionnement et de tâtonnement (Berthet, 2021), temps pour laisser libre cours à l’imagination (Richard, 2021; Gosselin et al., 1998). Non seulement nous nous questionnons sur la conduite de projets en milieu de recherche et en milieu éducatif, mais nous constatons aussi que ce temps non linéaire est difficile à susciter, voire utopique. Exemple, en classe d’art, le temps est compté en nombre de périodes, en programmes appliqués, en évaluations trimestrielles et en années. Cela pose la question : comment créer et gérer, dans un même espace-temps, un temps rapide, scandé, et des temps vides pour les gestes improductifs, les « re-jets » nécessaires à tout processus créatif (Boutinet, 2010) ?
2.2. L’im-produire
L’improductivité est facile à définir : « [q]ui ne produit rien, qui n’est pas productif, ne participe pas à la production des biens d’un pays » (CNRTL, 2023). Réfléchissant sur les termes à employer, nous avons cherché quelles connexions et quelles différences existent entre produire et générer.
Retraçant sur le temps long la disparition de la génération comme paradigme majeur d’organisation sociale au profit de la production, l’ouvrage de l’enseignante et chercheure écoféministe Émilie Hache permet de préciser notre saisie du terme « produire » (2024) et de la transposer dans le domaine artistique. Elle examine la notion de production au travers d’une grille critique écoféministe. Cet écrit nous suggère des angles complémentaires pour envisager les rapports entre artistes et monde du travail. D’autres questions nous ont aiguillées, notamment celles de Bojana Kunst (2012) : quelle consommation pour la production artistique ? Qu’est-ce que la paresse, ou le désir de travailler moins pour un·e artiste ? Ces questions nous amènent à détailler l’emprise du capitalisme et le conditionnement par les milieux institutionnels, avec l’aide de différentes postures : artiste, théoricienne, pédagogue. Le marché capitaliste de l’art et sa dimension spéculative affectent le statut économique de l’artiste, qui devient une personne au travail autonome caractérisé par l’individualisme et la compétition entre les artistes et qui, conséquemment, amplifie l’importance accordée à la signature de l’artiste. Une pratique artistique im-productive est-elle symboliquement possible, en porte à faux à l’art viable ? Menger (2022) soulève la double pression subie par les artistes dans ce contexte : l’incertitude propre au processus de création se conjugue à la précarité de leur statut économique. Il constate que le noyau de travail adjacent à la création artistique est très important. Comme le souligne Tackels (2021) :
Je ne dis pas que l’appel à projets ne peut pas avoir du sens dans certains cas, mais la façon dont il s’est généralisé me paraît toxique. Ça fait que l’énergie de l’artiste est dévoyée, mise au service de quelque chose qui n’est pas son travail. Son travail c’est le plateau, c’est le laboratoire, c’est l’école. (p. 5)
S’ensuivent plusieurs questions : im-produire, est-ce un appel à faire autre chose que son travail d’artiste et d’enseignant·e? Est-ce une pratique de l’art et de l’enseignement en marge de leurs milieux institués? Comment l’explorer au sein d’une démarche scientifique ou créative?
L’ambivalence concernant l’autonomie de l’art comme origine de la relation tendue de l’art avec le marché nous a permis de discerner comment les œuvres sont imprégnées par les exigences du marché, mais peuvent du même coup insister sur leur autonomie par rapport à lui, refusant de se soumettre aux considérations économiques. « La liberté de l’art doit donc être comprise comme étant essentiellement conditionnelle. Alors que les forces du marché exercent un pouvoir croissant sur l’art, nous avons plus que jamais de raisons de défendre cette liberté résiduelle. » (Kunst, 2012, traduction, s. p.) Ce sont les institutions et le marché au sens large qui reconnaissent les œuvres et définissent les conditions de la liberté de création des artistes qui veulent vivre de leur art. Ainsi, nous avons dû défier la notion de production en art et revoir pour qui on produit, pourquoi et à quel rythme?
Quant à Poulin (2014), il cherche à comprendre s’il est possible, en art actuel, d’obtenir une dépense improductive menant à une pure perte, qui s’oppose à la société de consommation. À cette fin, il reprend la notion de « dépense improductive » en art actuel, telle qu’élaborée par Georges Bataille. La dépense improductive, le détachement économique, serait utile puisqu’elle agit comme une forme de pouvoir permettant de s’élever socialement. Les artistes qui s’installent dans d’autres espaces que ceux du marché de l’art pourraient être considérés comme improductifs dans ce système. Poulin souligne que, même en étant critiques du système de l’art élitiste et spéculatif, les artistes qui sont en marge de celui-ci y contribuent en ayant recours à d’autres cadres référentiels. C’est-à-dire qu’il constate qu’ils sont jugés utiles dans d’autres systèmes, dont l’action sociale, si on pense aux pratiques du Care, à l’art communautaire, etc. Ces artistes élargissent le champ d’action par son implémentation dans le champ social et en font des œuvres socialement utiles. Pour nous, c’est une manière de comparer les gestes de dessiner en réfléchissant aux interfaces mobilisées entre productions artistiques en marge des institutions, recherche-création et innovation sociale (Fourmentraux, 2011).
Nous sommes également confrontées à cet enjeu dans le champ de l’éducation (Biesta, 2017; Tackels et Baudou, 2021). Est-ce que l’enseignement des arts doit toujours se justifier socialement et être au service des autres matières? Peut-on im-produire en art et en pédagogie? Est-ce possible de rater? Biesta (2017) interroge l’instrumentalisation de l’art dans le domaine de l’éducation :
La disparition potentielle de l’art est particulièrement visible dans l’instrumentalisation continue du rôle des arts dans l’éducation. Ceci est illustré par l’idée selon laquelle la présence des arts dans l’éducation ne peut être justifiée que s’il peut être prouvé que les arts comptent pour autre chose, quelque chose qui compte apparemment vraiment. Cela inclut, par exemple, l’amélioration des résultats scolaires, le développement des capacités d’empathie ou des attitudes prosociales, ou l’acquisition de compétences particulières. Il est évident que dans de tels cas, ce n’est pas l’art qui importe, mais ce qu’il peut produire ou provoquer. La disparition potentielle de l’éducation dans l’enseignement de l’art contemporain est peut-être moins facile à percevoir. Cela a à voir avec ce que je suggère d’appeler des justifications « expressivistes » du rôle des arts dans l’éducation. (Traduction des auteures, p. 37)
Cet éventail des instrumentalisations possibles en art et en pédagogie artistique a soulevé une série de questions complémentaires : im-produire, est-ce laisser place à la vacance et à l’incertitude nécessaires au processus de création? En ce sens, Gillick (2009) insiste sur la nécessité de la vacance et de l’errance pour créer. Pour sa part, Lubard (2019) a documenté l’importance de la recherche et du tâtonnement chez les personnes étudiantes les plus créatives. Leur processus s’avère non linéaire et non réplicable. Il constate que les étudiant·es en art se satisfont plus de leur processus de création et réussissent mieux lorsqu’elles et ils doutent le plus de leurs résultats. Tandis que celles et ceux qui ont une idée précise dès le début sont les plus satisfait·es des résultats, mais les réponses sont les moins intéressantes, en termes d’originalité ou de singularité.
Enfin, poursuivant notre quête d’improductivité, nous avons cherché à déterminer si im-produire en art et en pédagogie signifiait « rater ». Tackels revendique « ce droit au rater quand on enseigne en art », sa réponse s’avère éclairante pour notre enquête :
Je pense qu’il faut imaginer des écoles (d’art) qui cessent de vouloir être la réplique du prétendu monde du travail. » […] « Sans arrêt dans leur formation, les jeunes gens sont sommés de réussir. Je ne dis pas qu’il faudrait qu’ils ratent tout. Mais je crois qu’il faudrait sortir du couple raté/réussite pour introduire la question du processus. (Baudou et Tackels, 2021, p. 7)
Ce dépassement du succès obligatoire et d’une compréhension dualiste dans les apprentissages et les pédagogies artistiques boucle un premier portrait de notre terrain.
3. Le projet im-productif : quels types de savoir émergent de gestes improductifs? (P3)
Nous avons rapidement identifié un paradoxe. Notre hypothèse est que, si l’on vise dans la production théorique ou artistique quelque chose de clair, de discernable, si on n’est pas capable de chercher « avec le trouble » (Haraway, 2016), rien ne peut se pluraliser. Ainsi, la recherche universitaire, du moins en art et en pédagogie de l’art, alimente la relation entre réflexion théorique et pratique artistique afin de mieux l’articuler et dégager des savoirs qui ne préexistent pas à la relation tissée au cours de l’expérimentation. Elle ne vise pas à modéliser la pratique, mais à mieux comprendre comment se tisse la relation avec les participant·es, le lieu, les contextes et les mondes de l’art, dans une société hyperactive où l’image de l’artiste comme individu et une survisibilité médiatique sont plus que jamais valorisées.
À partir de cet ébranlement des cadres de référence au gré de notre enquête sur l’improductivité et de ces questions, nous tentons de saisir l’impact des pratiques de création sur les pratiques éducatives et les pratiques de recherche. La présence de la collaboration rend notre parcours errant plus difficile, car elle implique le sentiment de responsabilité vis-à-vis d’autrui et la peur de lui faire perdre du temps précieux. Nous invitons des personnes participantes et chercheuses à « embarquer dans un bateau où les copilotes savent comment faire marcher le bateau, mais la destination est volontairement imprécise ».
L’improductivité appelle, pour nous, une conscience micropolitique et macropolitique des enjeux relatifs au capitalisme qui touche particulièrement le travail. La perspective matérialiste et féministe (Federici, 2022) guide notre démarche d’exploration, notre construction du savoir scientifique comme valeurs en recherche. Nous envisageons d’approfondir ces impacts sur les « trois écologies » identifiées par Guattari (1989), psychique, sociale et environnementale, dans la manière de faire œuvre. L’approche que nous élaborons concorde avec la pédagogie de la résonance mise de l’avant par Rosa (2023). Il en est de même quant à notre recherche d’alternatives par la création de communs en art, en recherche et en pédagogie (Zhong Mengual, 2021). Ces concepts guident notre recherche sur le geste d’im-produire et sur ses temporalités. Pour saisir, si elles existent, les connaissances qui peuvent émerger de gestes improductifs, nous prévoyons réfléchir aux concepts de rentabilité socioéconomique et de productivité avec des personnes jugées « non productives » (Butler, 2016), par l’examen des gestes cocréés de dessiner et aussi de ce que nous réalisons en duo.
3.1. Description d’une problématique im-productive
Depuis un territoire concentré sur des gestes de dessiner les plus basiques, comme les « moindres gestes » tracés (Alvarez de Toledo, 2001), nous étudions le faire et précisément les gestes productifs et improductifs en création collective. La problématique de notre recherche s’ancre dans un point de vue situé (Haraway, 2007). Ainsi, nous nous attardons à décrire la diversité des relations entre production artistique et travail en la connectant étroitement aux modalités théoriques, esthétiques et techniques que nous mobilisons. Notre posture se nourrit de questions posées par des théoricien·nes qui sont aussi, le plus souvent, des artistes. À l’instar de Beech (2015), nous nous interrogeons sur la pertinence du rejet du travail salarié, du productivisme, et de la production de valeur2 dans la pratique artistique (http://revueperiode.net/la-valeur-de-lart-entretien-avec-dave-beech/). Comme lui, ce qui nous intéresse principalement, c’est « de reconfigurer la façon dont l’art peut fonctionner socialement » (s. p.).
Plus précisément, nous élaborons cette recherche-création collaborative, fondamentale et épistémologique avec les approches donnant une visibilité inédite au type de travail invisibilisé qu’exige le mode de production capitaliste. Nos objectifs spécifiques sont les suivants :
- Développer des dispositifs de création collaborative permettant de cartographier les gestes improductifs et les situations d’invisibilité partagée lors du processus de cocréation;
- Définir un régime d’auctorialité dividuel qui n’efface aucun protagoniste;
- Contribuer à former une relève artistique et enseignante sensible aux enjeux esthétiques et théoriques de l’art communautaire et à ceux de la recherche-création en milieu universitaire.
On veut comprendre les relations entre processus de génération et de production (Hache, 2024) dans la spécificité du « faire-œuvre » de l’artiste collaboratif, à l’instar de ce qu’écrit Hache sur la manière dont la production a supplanté le paradigme de la génération qui lui préexistait. Saisir les différences entre produire et générer en cocréation et en enseignement est donc crucial dans notre démarche. Générer, c’est laisser place à la question d’œuvrer, de ne pas gouverner (Hache, p. 211), s’ouvrir à la dimension non programmée, accueillir l’imprévu, le non contrôlé et contribuer à la création d’un monde commun dans nos actions et gestes à même nos projets.
Cela pose la nécessité d’une agentivité et d’une auctorialité distribuées dans nos pratiques. Dans les prolongements transpédagogiques de notre recherche-création en duo, le positionnement est le même : nous envisageons les processus créatifs en tant que parties prenantes des activités socioculturelles (Glăveanu, 2014), excédant souvent les représentations de la créativité comme qualité individuelle.
3.2. Amalgame d’approches méthodologiques
Nous esquissons des tracés évolutifs de nos expérimentations réalisées dans divers milieux : en duo d’artistes, en milieu scolaire ou universitaire, avec des communautés et avec un groupe de travail interdisciplinaire. Ainsi, la table est mise pour expliciter notre posture critique, nos objectifs, nos questions de recherche resserrées, ainsi que notre méthodologie. Cette dernière amalgame le dessin comme méthode de recherche, notre recours à l’« Artographie » et à la cartographie radicale (Zwer et Rekacewicz, 2021).
La cartographie radicale est un exercice résolument multimodal (combinaison de textes, dessins, pictogrammes et mesures spatiales) qui permet de réfléchir au phénomène de l’improductivité par le langage écrit et dessiné. Il permet de saisir des phénomènes qui s’ancrent dans l’espace à partir d’un point de vue subjectif et d’un langage hors de l’ordinaire pour rendre visible la part invisible de ces phénomènes (Denègre, 2005; Olmedo, 2017; Rekacewicz et Zwer, 2021). La cartographie radicale cherche à souligner les variations de visibilité de nos gestes productifs/improductifs selon les contextes et à adresser des savoirs pluriels, fédérateurs pour le plus grand nombre. Quant à la collecte et l’analyse des données issues de nos expérimentations, pour nous, la cartographie constitue un outil, une méthode multimodale de recherche et aussi un répertoire de présentation des résultats. Celle-ci est utilisée dans son sens large, lors de nos rencontres avec l’équipe de recherche, pour ouvrir un sujet à explorer (Annexe B, Figures 1 et 2) ou encore pour rendre compte de nos lectures à ce même groupe (Annexe B, Figure 3). Suivant une approche résolument multisensorielle et multimodale (Richard et Lacelle, 2020), nous puisons dans le champ élargi du dessin contemporain et cartographique partagé. Pour préciser ce que nous entendons par « dessin élargi », le résumé suivant qu’en fait Antoine (2003) est assez clair :
Cessant d’être défini par l’emploi de techniques et de matériaux particuliers, le dessin au sens élargi caractérise tout type de déplacement le long de la ligne de crête qui relie, à chaque fois sous forme d’un événement singulier, un geste de dénotation et son enregistrement comme tel dans une empreinte matérielle susceptible de durée. (p. 133)
Dans la même veine, Beuys avait expliqué que « [p]enser, c’est dessiner » (Antoine, 2011, p. 142). Plus loin, dans cet article, Antoine (2011) élargit le dessin à :
[…] tout geste de désignation se cristallisant dans une trace, la pratique du dessin échappe aux catégorisations partielles (Beaux-Arts, dessin scientifique et technique, style) qui en ont, depuis plusieurs siècles, restreint l’usage et la portée. Elle retrouve ainsi le rôle de commencement de pensée et de « langue d’avant les symboles » qui est le sien dans la plupart des cultures. (p. 142)
Le recours à une approche multimodale de la création facilite l’ouverture aux expériences proposées, élargit les données recueillies sur le terrain et la forme de leur restitution à travers des cartographies radicales, des conférences-performances et des interventions artistiques collaboratives. Le langage et le récit sont au cœur de nos œuvres d’une manière ou d’une autre, il s’agit de décrire et de nommer nos pratiques im-productives, de relayer ou de donner la parole à la diversité des vacances.
Afin de poursuivre la synthèse de nos approches méthodologiques, soulignons qu’elles sont d’abord nourries par l’approche a/r/t/ographique (Irwin, 2017), reprenant, pour témoigner de l’entrelacement de nos activités, cette dénomination d’artists-researchers-teachers. Komatsu et Namai (2022) expliquent qu’artography vient du « terme hybride d’a/r/t et de graphie, qui signifie description. Les barres obliques dans a/r/t représentent l’identité complexe et enchevêtrée du chercheur en tant qu’artiste/chercheur/enseignant (-praticien) engagé dans une enquête sur la vie basée sur les arts. » (p. 3) Ce type de recherche permet de puiser dans l’expérience de création et d’enseignement pour théoriser la pratique. Elle table sur ces allers-retours dans une forme d’enquête et de pratique réflexive.
L’A/r/tographie réside dans les pratiques d’artistes et d’éducateurs dont les formes d’enquête sont similaires à une compréhension de la recherche-action qui ne suit pas un plan ou une méthode prescrite, mais poursuit plutôt une enquête continue engagée à poser continuellement des questions, à calibrer des interventions, recueillir des informations et analyser ces informations avant de poser des questions supplémentaires et mettre en œuvre une enquête plus vivante. (Irwin et al., 2006, traduit par les auteures, p. 1)
L’artographie permet l’étude de terrains de recherche interreliés (scolaire, universitaire et artistique) avec une approche phénoménologique féministe fertile pour comprendre l’improductivité. Cette manière de regarder les situations de dessin participatif cocréées se définit par une « reconfiguration critique de la phénoménologie [qui] met en lumière les possibilités sociopolitiques d’un mouvement qui aurait pu sembler, en apparence, n’être qu’une question de description » (Al-Saji, 2017, traduction des auteures, p. 143). Nous recourons à la phénoménologie pour mieux comprendre le potentiel de faire l’expérience improductive, et d’en dégager ses significations « mais aussi les dimensions qui génèrent du sens. Telles sont les dimensions structurantes et normatives qui font sens, mais qui n’apparaissent pas elles-mêmes comme sens » (p. 145).
4. Présentation d’une année d’errance active : les productions découlant de ce projet
La mise en place de ce projet a débuté en septembre 2022, et depuis, nous avons réalisé à la fois des activités de création, des communications performatives et traditionnelles, animé un groupe de recherche et réfléchi à notre cadre conceptuel en duo (Annexe A). Quatre cycles-espaces de recherche entrelacés et non linéaires, nommés « fabriques », se déploient selon les circonstances et l’énergie dégagée, dans notre quotidien. Le concept de « fabrique » a émergé lors d’une résidence artistique dans l’édifice de la Fabrique à Québec. Cette ancienne usine de corsets de la Dominion textile a été transformée en lieu de fabrique du savoir. Nous avons identifié quatre fabriques, qui regroupent les sphères où nous œuvrons déjà. La création du site web Viser l’im-productivité cartographie les expérimentations faites à ce jour (https://artistesimproductives.com/).
4.1. Fabrique critique : équipe de recherche LMM
L’implémentation d’un groupe de recherche au sein de l’équipe de Littératie Médiatique Multimodale (LMM) contribue grandement à la réflexion sur nos objectifs de recherche et nos expérimentations. Six chercheur·es d’expérience, principalement de l’UQAM3, ont accepté non seulement de se pencher avec nous sur notre cadre théorique, mais aussi d’entrer dans un processus de partage et d’introspection à partir de leurs propres pratiques en recherche. Six rencontres ont eu lieu durant la dernière année.
Avec ce groupe, nous tentons de cartographier nos moments improductifs en recherche et dans nos vies pour identifier des processus communs. Nous avons varié les manières d’explorer cartographiquement en utilisant divers supports : le tableau blanc numérique, le support papier et le calque de formats divers. Rapidement, nous nous sommes confrontées à la multimodalité de la cartographie, soit l’établissement d’un langage textuel, visuel, symbolique et d’une légende. Le territoire de la productivité et de l’improductivité étant très vaste, les occasions d’incompréhension sont importantes. Les membres du groupe ont souligné à plusieurs reprises l’importance de ne pas trop savoir où on s’en va.
Ces premières expérimentations révèlent la difficulté de dégager de nouvelles connaissances puisque nous en restions à la description des espaces de vie en usant de concepts et langages connus. Denègre (2005) explique que la cartographie n’apporte rien si on rejoue ce qui est déjà su et visible (Annexe B, Figure 3). Cartographier implique donc de prendre le temps de définir à la fois le phénomène observé de façon précise, la légende (signification des couleurs, symboles, marqueurs de relation, etc.) et l’échelle de la carte, ce qui exige beaucoup de temps. Après six rencontres, l’une des chercheures a souligné la dimension heuristique de nos tentatives de cartographier les temps improductifs dans nos vies. La superposition des cartes produites individuellement et collectivement permettait de déceler le caractère rythmique propre à cette alternance d’activités productives et improductives. Une remarque d’un autre chercheur du groupe portait sur les usages différenciés des langages. Il constate qu’au sein du groupe, les chercheures issues du domaine des arts étaient très à l’aise avec les langages plastiques, la mise en images des idées et des liens qu’elles entretiennent. Celles et ceux travaillant dans le domaine de l’éducation sont plus à l’aise avec l’usage du langage écrit. Il se demandait : comment pouvons-nous mettre à profit les recours aux différents langages entre nous, et dans le mode de production des cartographies? De même, il s’interrogeait sur nos relations à l’improductivité :
Il me paraît que nous parlions davantage de ce qui est là, de ce qui est présent dans les moments où se chevauchent et alternent la productivité et l’improductivité. Si c’est le cas, la question devient alors : comment identifier la présence de l’improductivité en recherche et en création? (Participant du Collectif improductif 2024)
À partir de cette reformulation des questions décisives pour notre recherche, nous voulons enrichir nos manières de cartographier.
Faisant le point sur la notion d’amalgame dans nos rencontres, une autre chercheure caractérise notre travail de communauté de pratiques, mobilisant des démarches multimodales non seulement sensorielles, mais aussi disciplinaires. Vu l’importance de la qualité de nos échanges, les membres du groupe ont décidé de signer collectivement leurs contributions théoriques et plastiques en tant que « Collectif improductif », depuis février 2025. Pour certain·es membres du collectif, ce travail sur l’improductivité interroge le sens de ce que nous faisons au quotidien en recherche, qui est intimement guidé par la notion de productivité. Le désir de se décharger des normes existantes, ainsi que la responsabilité vis-à-vis des autres, a été soulignée à cette étape. La question de la nature de la joie associée à la productivité a été posée. Il s’agit de reconnaitre le bien-être que procure le sentiment d’accomplissement issu du fait de « livrer », d’être rentable et reconnu·e.
La nécessité d’éprouver des temps d’arrêt ensemble et de formuler des hypothèses régénératives a également été nommée. Il faut se forcer pour im-produire dans le milieu universitaire. Il faut éliminer volontairement les attentes des autres. D’un point de vue scientifique, la lecture de nos données recueillies sur l’improductivité à un niveau énergétique s’avère une piste très intéressante, notamment dans un contexte d’accélération du rythme de travail, de l’intensification de la productivité liée, notamment, au développement de l’intelligence artificielle générative (IA), dans les contextes d’enseignement et de recherche. Les échanges avec ce groupe de chercheur·es ont permis également de souligner qu’artistes et chercheur·es sont porté·es et nourri·es par les mêmes flux (Menger, 2022). Nous sommes ainsi venu·es à formuler la question suivante : l’énergie improductive existe-t-elle?
4.2. Fabrique éducative : expérimenter l’im-productivité
Être dans l’expérience sensible pour dégager de la connaissance. Simultanément aux rencontres du groupe de recherche, nous avons réalisé une première expérimentation sur des gestes improductifs en classe d’arts plastiques, qui s’est déroulée dans une école secondaire de la Ville de Québec, Joseph-François-Perreault, avec deux classes d’arts plastiques, de 2esecondaire. Grâce à la collaboration d’Anik Sauvé, enseignante spécialiste en arts plastiques, nous nous sommes présentées comme des artistes-chercheures étudiant le geste de dessiner sans intention précise. Ces expérimentations se voulaient intuitives et sans visée scientifique.
Ainsi, nous avons demandé aux deux groupes de dessiner avec des pastels à l’huile blancs sur papier blanc, pendant la présentation d’un nouveau projet par l’enseignante. L’observation participante nous a permis de capter par photographie et par vidéographie les gestes des élèves. Certain·es élèves dessinaient avec grande attention, d’autres gribouillaient de façon plus distraite ou compulsive. Une élève a rempli sa feuille pour ensuite graver dans le pastel gras. D’autres encore jouaient avec le pastel en le faisant tourner. Nous avons pu voir des élèves défaire les revêtements des pastels et en faire des boules, et même détruire complètement le pastel en l’émiettant.
À la fin de la période, les élèves furent invité·es à enduire une couche d’encre de Chine sur leurs feuilles afin de révéler les images produites (Annexe B, Figure 6). Une discussion s’ouvrit avec le groupe sur les résultats et la relation à l’écoute de la présentation de l’enseignante. Cette sollicitation de gestes improductifs avait généré une amplification de l’attention aux gestes et a produit des contenus inédits. Deux types de réactions furent observés : soit le fait que, pour certain·es élèves, il était plus facile de se concentrer sur le propos de l’enseignante, soit l’inverse. L’autre élément est lié à l’étrangeté des images produites sans intentionnalité et un peu à l’aveugle. Elles et ils ne savaient pas trop quoi en penser.
Pour ce qui est de l’enseignante, elle voyait un corollaire avec des images sans grand investissement produites par certains élèves par manque d’intérêt, ou manque de temps. Par ailleurs, la restitution de ces deux expérimentations fut défaillante. L’horaire de l’enseignante est surchargé et elle n’a pu dégager de temps pour permettre un retour sur l’expérimentation avec les élèves. Elle est très active et multiplie les gros projets chaque année. Pour la prochaine fois, il faut insister sur des ententes claires et plus formelles.
Pour l’enseignante, cette collaboration expérimentale fut révélatrice des limites du temps de classe et du découpage de projets selon le calendrier scolaire. Ce sont des contraintes qui orientent grandement l’enseignement des arts plastiques. D’autres pédagogues en arts plastiques ont soulevé également ce problème du rythme des projets en classe4.
Enthousiasmées par notre intervention en milieu scolaire, nous nous demandions comment réagiraient des universitaires à la proposition de gribouiller pendant une conférence. Le désir qui nous habitait était d’amplifier les moyens d’aborder la surcharge de travail, en proposant une conférence remplie de stimulus et de modes de communication. Ainsi, une autre phase d’expérimentations et d’échanges eut lieu lors des deux conférences universitaires : d’abord à l’occasion d’une conférence performative prononcée dans le cadre du Colloque Savoirs au pluriel : savoir partager et savoirs partagés –du Centre de recherche cultures, arts, sociétés (CÉLAT) en avril 2023, à Montréal. La seconde le fut lors du 21e séminaire sur la Littératie Médiatique Multimodale (LMM) organisé par le regroupement AmalGAME, à l’UQAM également, quelques mois plus tard (juin 2023).
Lors de notre communication, nous avons invité les personnes présentes à dessiner (au crayon blanc sur support blanc). En même temps, nous prenions la parole, présentions un diaporama et une caméra-document avec projection sur deux écrans de téléviseur, qui transmettaient en direct les gestes de nos mains en train de dessiner. Le dispositif numérique et de présentation produisait un brouillage discursif : deux écrans, des gestes, des images qui ne concordent pas au discours, des consignes mobilisant l’écoute et le geste de dessiner sans lien explicite. À la fin de notre présentation, nous avons ouvert une discussion sur l’hyperactivité et l’improductivité. Les premières réactions des participant·es étaient les mêmes que celles des élèves à l’effet que le geste manuel soutient l’attention ou la détourne de la conférence. Plus profondément, il a été question de nos rythmes de travail et surtout du peu de temps que nous avions pour faire vivre des expériences signifiantes en contexte éducatif. De même, certaines personnes ont ramené le fait que les temps d’arrêt ou de vacance manquaient pour laisser la tête et le corps penser-ressentir une proposition de création, ou de « bien » réfléchir. De là, nous avons ajusté nos questions pour les étapes ultérieures. Comment pouvons-nous développer des projets pédagogiques qui tiennent compte de l’improductivité dans la dynamique de création et des pratiques informelles, comme les dessins moins intentionnels ou communicationnels, les dessins issus de la gestualité (consciente ou inconsciente)?
4.3. Fabrique publique : l’im-produire dans des communautés
Parallèlement à ces expérimentations, nous avons réalisé un projet de création dans l’espace public. Le projet, intitulé le 769, St-Joseph, s’inscrivait dans le parcours « Illumina », ancré dans le quartier St-Roch à Québec. À l’invitation de Francine Saillant, porteuse du projet, nous avons investi une vitrine commerciale désaffectée. Persuadées de dévier de nos objectifs sur l’improductivité, ce projet a d’abord généré beaucoup de résistance. Il nous amenait à intervenir sur la relation au quartier avec des personnes ayant des problèmes de santé mentale, de logement, de précarité de toutes sortes. Il nous imposait un échéancier serré, un lieu prédéterminé, et une forme d’œuvre impliquant le public. Au fond, nous savions que ce projet nous confrontait à notre contradiction en poursuivant une démarche hyperproductive.
Cette commande était, selon les moments, un vrai supplice et un délice. Nous étions confrontées à un manque de temps par la préparation d’une résidence d’artiste et l’écriture de demandes de financement, mais, en même temps, emballées par la possibilité de creuser le volet communautaire de notre recherche-création. Nous avons donc choisi de tout faire, malgré la surcharge de travail. Nous avons tenté de limiter l’impact du projet en élaborant un dispositif simple et efficace. Nous avons opté pour un médium peu engageant, sans liant, éphémère, peu coûteux, et qui ne demande qu’un contenant, de l’eau et une éponge. À partir d’une surface vitrée enduite de carbonate de calcium dilué, nous avons choisi de reproduire, de copier des images qui nous plaisaient et nous nous sommes laissées porter par le geste expérimental et par la lumière qui émergeait de la soustraction du médium sur un support transparent.
La force du lieu nous a amenées à réfléchir sur son aspect commercial afin de créer une œuvre d’interpellation et d’expérimentation. Nous avons donc investi les deux vitrines-membranes, espaces à la fois du dedans et du dehors, du soi et de l’autre. Dans un premier temps, nous avons peuplé celles-ci de dessins ludiques chapeautés des verbes « FAIRE FACE » (Annexe B, Figure 4 et 5). Prenant les allures d’une étrange marque commerciale, mais qui pose la question de plein fouet : à quoi fais-tu face ici?
Dans un second temps, nous avons invité les membres d’organismes communautaires5 à s’exprimer par l’écriture et le dessin sur ces mêmes vitrines. La plupart des pratiques communautaires sont traversées par une approche pédagogique afin que le processus de création soit lisible pour les personnes participantes. Ici, nous les avons laissées faire face à cet espace commercial vide et à notre proposition assez libre.
Ainsi, peu d’entre elles ont dessiné sur les vitrines que nous avions préparées. À notre grande surprise, elles ont investi davantage l’ensemble du local par leurs dessins directement sur les murs de la boutique désaffectée. Elles ont souligné le besoin de vivre des expériences de création non dirigées et de pouvoir occuper l’espace à leur guise. Cela nous amène à réfléchir sur le type de projet que nous proposons aux groupes communautaires et notre prédisposition, comme en enseignement, à contrôler les résultats pour s’assurer de la réussite de toutes et tous. Avons-nous peur de l’échec et de décevoir?
Finalement, nous avons tissé un lien avec une autre institution du quartier, l’École d’art de l’Université Laval, en écrivant un « Faire Face » sur l’une de ses fenêtres donnant sur le boulevard Charest, en écho avec ce parcours d’art urbain déployé par le projet Illumina. Cette modeste contribution nous aura permis d’entrer en relation avec les organismes du quartier, de partager un court instant de création avec ces groupes et d’ouvrir un questionnement sur ce que nous produisons en art et avec qui. Qui est désigné comme productif et improductif dans les milieux traversés au cours de ces expérimentations retracées ici?
4.4. Fabrique duelle : im-propre dans la pratique artistique
En aout 2023, nous avons réussi à bloquer une dizaine de jours pour créer ensemble à partir des contenus ressortis lors des expérimentations des autres cycles de recherche. Nous étions accueillies en résidence de recherche-création à l’École d’art. Seules dans ce grand espace, pendant que l’essentiel du personnel et du corps étudiant était en vacances, nous avons donc décidé de poursuivre cette lancée en intervenant sur les vitres de l’université à partir des images collectées lors des activités précédentes (Annexe B, Figure 6 et 7). Les nombreux objectifs de cette résidence étaient :
- Éprouver le geste improductif : rendre visible, traduire, les dessins improductifs jusqu’au moment où nous aurons vidé le temps. Que restera-t-il? (Rauschenberg efface le dessin de De Kooning);
- Développer notre cadre conceptuel et cartographier nos réflexions;
- Réinvestir les dessins collectés lors des conférences performatives;
- Expérimenter davantage les propriétés du carbonate de calcium (coulures, temps de séchage, vaporisation, stratification, cristallisation…), les effets de lumière (lumière de couleur, ombre portée) et son potentiel pour réaliser des graffitis (palimpsestes).
Lors de cette résidence, nous avons investi 11 fenêtres en quatre séquences de travail. Dans un premier temps, nous avons fait le tour du bâtiment pour identifier des espaces et des fenêtres intéressantes. Ensuite, nous avons examiné une trentaine de motifs de papier peint. Afin de nous échauffer, nous avons choisi de ne pas trop réfléchir et de reproduire à la même échelle les textures présentes sur le plancher et les murs de brique dans les quatre fenêtres du café étudiant situé au 4eétage du bâtiment. Ce n’est que par la suite que nous avons constaté que les textures créées par le carbonate de calcium et les textures figurant des briques étaient présentes dans notre banque de papiers peints.
Pour la deuxième série de deux fenêtres, nous avons choisi de reproduire les dessins lors des conférences-performances données au printemps précédent à une échelle beaucoup plus grande (Annexe B, Figure 8 et 9). Lors de la troisième série de deux, nous avions le souci de relier la série du 3e et 4e étage pour créer un visuel cohérent de l’extérieur du bâtiment. Finalement, la dernière série, composée de 3 fenêtres, se voulait en résonance avec l’intervention réalisée au 769, Saint-Joseph. Nous avons inscrit « FAIRE FACE » sur les fenêtres de l’École d’art de l’Université Laval. De l’extérieur, notre message était lisible pour les automobilistes, le feu de signalisation étant très long à ce carrefour, elles et ils avaient le temps de le lire. Notre inscription côtoyait l’épigraphe « DOMINION CORSET ». Cette entreprise produisait des corsets destinés aux femmes et fabriqués par des femmes. Cette tension entre fabrique de l’aliénation des corps et fabrique de l’émancipation par les femmes, invisibilité et pratique de l’effacement, résonne avec l’inscription par effacement dans notre mode opératoire. La résonance entre nos gestes artistiques et le territoire investi a créé une proposition surprenante. Œuvre infiltrée sans identification, nos huit dessins sont restés dans les fenêtres durant plus de huit mois. Petit à petit, les étudiant·es les ont altérés, voire effacés graduellement. Il reste encore deux traces de dessin dans des fenêtres après 24 mois.
Avec tout ce programme et nos occupations adjacentes à ce projet, c’est définitivement la pratique artistique qui a été la plus difficile à poursuivre, même si elle constituait le cœur de nos préoccupations. Après la résidence d’artistes à l’École d’art de l’université, il a été très difficile de poursuivre nos explorations avec le carbonate de calcium. Nous sommes confrontées au paradoxe intrinsèque de l’im-productivité, à savoir à un trop plein d’activités dans les autres sphères professionnelles. Que veut dire dans nos vies trop pleines prendre le temps de créer et de le faire sans buts précis?
Conclusion et perspectives
La rédaction de cet article nous a permis de démontrer comment un amalgame de méthodes de recherche formelles et informelles fait émerger des approches inédites en pratique artistique et en éducation à l’aune de l’im-productivité questionnée.
Nous avons d’abord présenté le contexte, nos postures, nos préoccupations et l’articulation de nos recherches. De façon délibérée, nous n’abordons pas la recherche de façon cartésienne et pragmatique (Haraway, 2021). Nous sommes sensibles aux occasions qui se présentent à nous et nous nous laissons porter par nos flux énergétiques. Nos lectures, nos rencontres avec d’autres participent à la construction de ce champ de recherche en mouvement. Nous avons donc fait le choix d’exposer notre travail de tâtonnement comme une manière tout aussi crédible de faire de la recherche que la manière dominante de pratiquer la recherche en sciences sociales ou en sciences de l’éducation. Nous voulons démontrer non seulement des alternatives méthodologiques, mais aussi la difficulté d’arpenter la productivité inscrite profondément dans nos modes de vie, dans les espaces-temps définis par la production et la consommation capitalistes.
Avec ce cadre ambitieux, nous nous sommes lancées dans la recherche tête baissée, nous laissant porter à la fois par nos intuitions et des manières de faire moins rentables à court terme. Nous nous sommes un peu perdues par moments et avons traversé un brouillard assez dense durant nos expérimentations. Faire face à l’inconnu quant à l’aboutissement du processus de recherche n’est pas toujours confortable à titre de responsables d’un projet. Celui-ci impliquait l’expérimentation par essais successifs, ratages, dispositifs de création collaborative-participative en milieux communautaire, universitaire et scolaire. Rapidement, nous avons constaté, en pratiquant le dessin en duo et lors des ateliers, que nous nous distinguions des artistes qui réfléchissent à la décroissance, ou proposent de rompre avec la production d’objets, de pratiquer le non-agir, d’expérimenter le repos comme geste artistique et politique. Nous demeurons en contradiction avec ces approches par notre rythme hyperproductif. Ralentir, peut-être, mais n’être que dans l’immatériel (symboles, savoirs, rituels, communauté) pour créer de nouveaux communs et délaisser la matérialité (biens ou espaces gérés de manière collective) dans la création n’a pas été l’approche privilégiée6.
L’amalgame de réfléchir-faire-défaire nous semble porteur d’une pensée plus holistique et ouverte pour aborder la complexité des contextes de création collectifs et l’émergence de savoirs dans les marges im-productives (Annexe B, Figure 10). Nos questions de recherche nous obligent à naviguer en marge, au moins partiellement, mais nous intégrons cette recherche-création aux stratégies de reconnaissance propres à l’art contemporain : par les œuvres coproduites, par les résidences et les expositions, mais en ciblant des lieux de diffusion hors du périmètre institutionnel de l’art. Aussi, nous intégrons la validation académique des connaissances produites au gré de cette recherche-création, tout en remettant en cause les rythmes de vie, d’apprentissage, d’enseignement. Notre quête s’inscrit à la suite des trois écologies de Guattari qui impliquent de revoir notre rapport de la subjectivité avec son extériorité : qu’elle soit physique, sociale, environnementale, cosmique. Le constat à ce jour est que viser l’improductivité nous a placées sur une orbite d’hyper-productivité depuis deux ans et demi. Pour déployer cette recherche, nous devons faire des pieds et des mains pour organiser nos temps de rencontre où, finalement, il y a, pour le moment, peu de place à la vacance propre à l’errance.
Ces expériences ont été des amorces pour nourrir l’articulation d’un projet plus soutenu. La proposition était de porter attention à ce qui favorise la transmission de connaissances et la capacité de transformation qui vient par l’écoute. Ainsi, l’intention des ateliers en milieu communautaire était de rendre sensibles les temps détournés (distraits, suspendus, perdus) pour expérimenter avec des jeunes et moins jeunes le processus de création, ses phases latentes et la capacité de transformation issue des gestes improductifs. En développant des dispositifs de cocréation et un langage commun avec les participant·es, l’objectif spécifique du prochain projet sera d’identifier et de visibiliser les qualités de ces temps errants dans le projet collectif, qui mettent en relief la notion d’improductivité. Ainsi, nous serons à même d’observer les modalités et configurations de l’auctorialité partagée.
Quant au Collectif improductif, il a émis le désir non seulement de continuer à réfléchir avec nous, mais également d’expérimenter des activités dites improductives ensemble, telles que la marche, le jardinage, les temps de silence. Il semble nécessaire aussi de réfléchir à des activités régénératives ayant pour socle l’improductivité. Nous vivons l’émergence d’un nouveau commun. Une autre voie, que nous n’avions pas prévue !
ANNEXE A: Chronologie du travail
| Dates | Activités | Lieux |
| Septembre 2022 | Décision de développer un travail en duo axé sur nos pratiques communautaires | Montréal |
| Décembre 2022 | Rédaction du projet Viser l’improductivité pour une demande de financement interne de l’ULaval | En ligne |
| 27 avril 2023 | Conférence performance au colloque du CÉLAT | UQAM |
| 4 mai 2023 — | Démarrage du groupe de recherche Viser l’improductivité : 6 rencontres | UQAM |
| 5 et 9 mai 2023 | Expérimentations École Joseph-François-Perrault (secondaire 2) | École de Québec |
| 8 juin 2023 | Création de l’œuvre 769, boul. Saint-Joseph dans le cadre du parcours d’art Illumina dans le quartier St-Roch | Commerce de Québec |
| 13 juin 2023 | Conférence performance lors du séminaire Amalgame — LMM | UQAM |
| Aout 2023 | Résidence d’artistes à l’École d’art de ULaval (2 semaines) | ULaval, Québec |
| 8 et 10 aout 2023 | Activités participatives dans la vitrine du 769, Saint-Joseph | Commerce de Québec |
| 3 novembre 2023 | Colloque art social et inclusion sociale | Cervo-Québec |
| 17 mai 2024 | Colloque Éduquer par l’art en lien avec les enjeux sociétaux, ACFAS | En ligne |
| 2024 | Développement d’un projet im-productif de recherche en art communautaire | École d’art — ULaval |
ANNEXE B: Les images du projet









- Nous préférons le féminin pour parler de la profession enseignante, qui est principalement investie par les femmes. ↩︎
- Beech (2018) avance que la « principale caractéristique de l’art comme mode de production est que les artistes n’ont pas été transformés en travailleurs salariés, comme le requiert le mode de production capitaliste » (s. p.). ↩︎
- Le groupe est composé de Claude Majeau (Université Laval), Camille Courier (artiste-chercheure, chargée de cours Université Laval), Nathalie Lacelle, Moniques Richard, Jean-Pierre Mercier, Audrey Dalh de l’UQAM issu·es de différentes disciplines. Ce groupe signe collectivement ses contributions théoriques et plastiques en tant que « Collectif improductif » depuis février 2025. ↩︎
- Nous avons recueilli leurs déclarations, notamment à la suite de conférences co performées avec le même procédé (recours à la craie blanche, ou au pastel gras, sur support blanc puis encre noire). ↩︎
- Pech-Sherpa est un organisme d’hébergement pour personnes qui ont besoin de soutien communautaire en logement, tandis que Lauberivière est une ressource de première ligne pour personnes en situation d’itinérance. La douzaine de personnes participantes étaient des personnes vivant des situations de grande précarité. ↩︎
- Les définitions d’immatérialité et de matérialité sont de Zhong Mengual (2021), p. 11. ↩︎
Agamben, G. (2006/2014). Qu’est-ce qu’un dispositif? Payot et Rivages.
Al-Saji, A. (2017). Feminist Phenomenology. Dans S. Khader, A. Garry et A. Stone (dir.), The Routledge Companion to Feminist Philosophy. Routledge, p. 143-154.
Alvarez De Toledo, S. (2001). Pédagogie poétique de Fernand Deligny. Communications, 71. 245—275. https://doi.org/10.3406/comm.2001.2087
Antoine, J. P. De l’archaïque au commencement. L’Homme, 165. DOI : https://doi.org/10.4000/lhomme.200
Baudou, E. et Tackels, B. (2021). Entretien avec Bruno Tackels : « Le rater ce n’est pas qu’un événement, c’est un mode d’être et de créer ». Agôn. DOI : https://doi.org/10.4000/agon.8384
Beech, D. (2015) La valeur de l’art : entretien avec Dave Beech (Entretien réalisé et traduit de l’anglais par S. Coudray). Période. http://revueperiode.net/la-valeur-de-lart-entretien-avec-dave-beech/
Berthet, D. (2021). L’incertitude de la création. Intention, réalisation, réception. Presses universitaires des Antilles.
Biesta, G. (2017). Letting Art Teach: Art Education ‘After’ Joseph Beuys. ArtEZ Press.
Boutinet, J.-P. (2010). Grammaires des conduites à projet. Presses universitaires de France.
Butler, J. (2016). Rassemblement. Pluralité, performativité et politique. Fayard.
Courier de Méré, C. (2022). Ombres d’exil : du dessin-scène par nuages de points à l’émergence de trans agirs micropolitiques [Thèse, Université du Québec à Montréal]. https://archipel.uqam.ca/15189/
Courier, C. et Winn, L. (2024). Drawing New Relationalities with Migrants and Immobile Exiles. Journal of Awareness-Based Systems Change, 4(1), 127–153. https://doi.org/10.47061/jasc.v4i1.7065
Denègre, J. (2005). Sémiologie et conception cartographique. Lavoisier.
Federici, S. (2022). Réenchanter le monde : féminisme et politique des communs. Entremonde.
Fourmentraux, J. P. (2011). Artistes de laboratoire. Recherche et création à l’ère numérique. Hermann.
Gagné, M. (2018). Un modèle d’enseignement des arts visuels et médiatiques compris comme un travail de création[Thèse, Université du Québec à Montréal]. http://archipel.uqam.ca/11356/
Gosselin, P., Potvin, G., Gingras, J.-M. et Murphy, S. (1998). Une représentation de la dynamique de création pour le renouvellement des pratiques en éducation artistique. Revue des sciences de l’éducation, XXIV, (3), 647-666.
Graw, I. (mai 2005). On False Polarities and Economic : Good, Market Evil? Text zur kunst.https://www.textezurkunst.de/articles/art-good-market-evil/
Gillick, L. (2009). Pourquoi travailler? Three Star Books.
Glăveanu, V. P. (2014). Distributed Creativity: Thinking Outside the Box of the Creative Individual. NY : Springer.
Guattari, F. (1989). Les trois écologies. Galilée.
Guattari, F. (2013/2018). Qu’est-ce que l’écologie? Le Collectif et associés.
Hache, E. (2024). De la génération. Enquête sur sa disparition et son remplacement par la production. Les empêcheurs de penser en rond.
Haraway, D. J. (2007). Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes. Exils.
Haraway, D. J. (2016). Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene. Duke University Press.
Helguera, P. (2011) Education for Socially Engaged Art: A Materials and Techniques Handbook. Jorge Pinto Books.
Hirschhorn, T. (2016). Dessiner = décider. http://www.thomashirschhorn.com/dessiner-decider/
Holmes, B. (2007). L’extra Disciplinaire : Vers une nouvelle critique institutionnelle. Multitudes Web, 1(28). www.multitudes.net
Irwin, R. L. (2017). Communities of A/r/tographic Practice. Dans Carter, M. N. et V. Triggs (éds.) Arts Education and Curriculum. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315467016
Irwin, R. L., Beer, R., Springgay, S., Grauer, K., Xiong, G. et Bickel, B. (2006). The Rhizomatic Relations of A/r/tography. Studies in Art Education, 48(1), 70–88. http://www.jstor.org/stable/25475806
Komatsu, K. et Namai, R. (2022). Chapter 1 Art = Research: Inquiry in Creative Practice. Dans Arts-Based Methods in Education Research in Japan. The Netherlands: Brill. https://doi.org/10.1163/9789004514140_001
Kunst, B. (2012). Art and Labour. On Consumption, Laziness and Less Work. Performance Research, 17(6), p. 116-125.
Lamoureux, E. (2009). Art et politique : nouvelles formes d’engagement artistique au Québec. Écosociété.
Laval-Jeantet, M. et Mangin, B. Duo Art orienté objet. (Artistes). (1993). Manifeste du Slow Art et Je suis contre !https://artorienteobjet.wordpress.com
Lesage, M.-C. (2016). Arts vivants et interdisciplinarité : l’interartistique en jeu. L’Annuaire théâtral, (60), 13–25.https://doi.org/10.7202/1050919ar
Lubard, T. (14 mai 2019). Le processus créatif : sa nature dynamique et non linéaire [conférence : 39 :19]. Dans le cadre du Colloque : La création en suspend à l’Amphithéâtre Maurice Halbwachs — Marcelin Berthelot. https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/colloque/la-creation-en-suspens/le-processus-creatif-sa-nature-dynamique-et-non-lineaire
Majeau, C. et Polliart, I. (2020). Créative Jonction : réflexion sur le processus de création collaboratif et multimodal avec des communautés. Dans M. Richard et N. Lacelle (dir.), Croiser littératie, art et culture des jeunes : impacts sur l’enseignement des arts et des langues (pp. 243-262). Presses de l’Université du Québec.
Majeau, C. (2022). De la marge vers le large : mise en lumière d’un dispositif de création à relais en art socialement engagé [Thèse, Université du Québec à Montréal]. https://archipel.uqam.ca/15895/
Marguin, S. (2019). Collectifs d’individualités au travail. Les artistes plasticiens dans les champs de l’art contemporain à Paris et à Berlin. Presses Universitaires de Rennes/Arts contemporains.
Martel, V. (2022). Changement à la direction et présentation d’une nouvelle forme d’article à la R2LMM – la documentation de pratiques de cocréation. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 15. https://doi.org/10.7202/1091399ar
Menger, P.-M. (2022). Sociologie du travail créateur. L’annuaire du Collège de France. http://journals.openedition.org/annuaire-cdf/
Morizot, B. et Zhong Mengual, E. (2018). Esthétique de la rencontre : l’énigme de l’art contemporain. Seuil.
Olmedo, E. (2017). L’expérimentretien comme méthode d’enquête. Cartographie sensible et terrains de recherche collaboratifs entre art et géographie. Mappemonde, 121.http://journals.openedition.org/mappemonde/3776
Poulin, C., Preston, M., Airaud, S. (2019). Co-création. Empire et CAC Brétigny.
Poulin, A. (2014). La dépense improductive dans l’art actuel de Michel de Broin, Thomas Hirshhorn et Santiago Sierra : Une approche critique. [Mémoire de la maitrise en histoire de l’Art, Université du Québec à Montréal].https://archipel.uqam.ca/6798/1/M13531.pdf DOI : https://doi.org/10.4000/mappemonde.3776
Rancière, J. (2004a). Malaise dans l’esthétique. Galilée.
Rancière, J. (2004b). Le maître ignorant. Fayard.
Richard, M. et Lacelle, N. (2020). Croiser littératie, art et culture des jeunes : impacts sur l’enseignement des arts et des langues. Presses de l’Université du Québec.
Richard, M. (2021). La conduite de projet et sa mise en œuvres. Notes de cours.
Rollot, M. (2018). Éloge de l’improductivité de l’hypothèse collaborative. HAL Open science. https://hal.science/hal-03016880
Rosa, H. (15 juillet 2023). Épisode 2 : Pédagogie de la résonance : grand entretien avec Hartmut Rosa. Questions d’éducation. Par les penseurs de notre temps. France Culture.https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/etre-et-savoir/pedagogie-de-la-resonance-grand-entretien-avec-hartmut-rosa-4512757
Rowsell, J. et Vietgen, P. (2017). Embracing the Unknown in Community Arts Zone Visual Arts. Pedagogies. An International Journal, 12(1), 90-107. https://doi.org/10.1080/1554480X.2017.1283996
Saillant, F. et Courier, C. (2023). Carnets d’artiste et carnets d’anthropologue. Parcours anthropologiques, 18. https://doi.org/10.4000/pa.2294
Schaeffer, J. M. (2015). Le monde de l’art en ses bords. Palais. (21), 42-46. Presses Universitaires de Rennes/Arts contemporains.
Stanton, V. (hiver 2024). Écrire sur la performance sans écrire sur la performance : l’archive vivante de Sylvie Tourangeau comme espace de mise en commun. Vie des arts, (273). https://viedesarts.com/dossiers/dossier-pratiques/ecrire-sur-la-performance-sans-ecrire-sur-la-performance-larchive-vivante-de-sylvie-tourangeau-comme-espace-de-mise-en-commun/
Stengers, I. et James, W. (2017) Une autre science est possible ! Manifeste pour un ralentissement des sciences (suivi de Le poulpe du doctorat). La Découverte. https://journals.openedition.org/lectures/20426
Wallas, G. (1926). The Art of Thought. Harcourt-Brace.
Wright, S. (2007). Vers un art sans œuvre, sans auteur, et sans spectateur. XVe Biennale de Paris. https://www.scribd.com/doc/46253019/Stephen-Wright-Vers-un-art-sans¬%C5%93uvre-sans-auteur-et-sans-spectateur
Zhong Mengual, E. et Latour, B. (2019). L’art en commun : réinventer les formes du collectif en contexte démocratique. Presses du réel.
Zwer, N. et Rekacewicz, P. (2021). Cartographie radicale : explorations. La Découverte.
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net