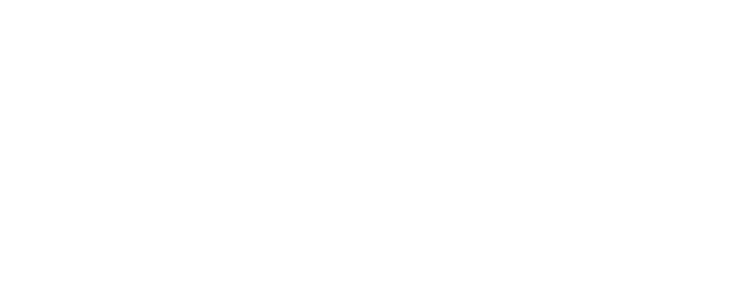Entre dispositifs matériels et dispositions incarnées : appréhender le caractère écologique et épistolaire du processus sémiotique
Face à la complexité de la recherche qualitative, l’auteure revient sur ses propres modes d’investigations pour mettre au jour les savoir-faire, les manières et les moyens auxquels elle recourt pour enquêter et pour, finalement, produire des connaissances. Sa recherche, située au croisement des pédagogies du design et de l’éducation relative à l’environnement, a pour but d’étudier les pratiques éducatives expérientielles du design en situation naturelle et à travers un ensemble de facteurs mêlant autant le social que l’intime, autant le matériel que le culturel. Ce tour d’horizon méthodologique est l’occasion de s’intéresser et de s’interroger à la fois sur le statut et l’influence des modes et des médiums de la recherche, qu’ils soient corporels ou matériels, intimes ou co-élaborés. Leur diversité et leur interrelation forment une prise sur ce processus fait d’imprévus et d’indétermination, et lui permettent d’appréhender le caractère écologique et épistolaire du processus sémiotique.
Faced with the complexity of qualitative research, the author returns to her own modes of investigation to reveal the know-how, the ways and the means she uses to investigate and, ultimately, produce knowledge. Her research, located at the crossroads of design pedagogies and environmental education, aims to study the experiential educational practices of design in natural situations and through a set of factors that combine the social as well as the intimate, the material as well as the cultural. This methodological overview is an opportunity to interest and to question both the status and influence of modes and mediums of research, whether corporeal or material, intimate or co-elaborated. Their diversity and interrelation form a hold on this process made of unforeseen events and indeterminacy, and allows her to grasp the ecological and epistolary character of the semiotic process.
Faire de la recherche, d’autant plus si elle adhère à une approche dite qualitative, relève d’une complexité telle qu’elle ne peut se résumer ni à une procédure formalisée ni à une méthode applicable comparable aux approches quantitatives. Cette difficulté amène nombre de chercheur·ses à clarifier leur démarche (Guillemette et al., 2021; Paillé et Mucchielli, 2016; Paillé, 2011, etc.) et à redoubler de rigueur quant à la crédibilité des résultats obtenus (Savoie-Zajc, 2019; Olivier de Sardan, 2008; Proulx, 2019). Malgré cet engouement méthodologique, Olivier de Sardan (2008) fait de la recherche qualitative un savoir-faire que l’on acquiert par expérience. Cette pratique de recherche, qui serait « d’abord une question de “tour de main”, et procède à coups d’intuition, d’improvisation et de bricolage » (p. 45), laisse néanmoins apparaitre un écart entre les tentatives de planification de la recherche et le vécu de sa réalisation. En revenant sur mes propres pratiques méthodologiques, cet article propose d’investir cet écart, non pas comme un angle mort de la recherche qualitative, mais comme un espace de conversation et de négociation entre différentes manières, parfois divergentes, mais toujours complémentaires, d’investiguer la recherche.
Pluridisciplinaire, cette étude doctorale s’ancre dans les enjeux relatifs à une éducation en temps de crise environnementale. Plus spécifiquement, elle porte son regard sur le déploiement d’approches éducatives, au sein de différents domaines du design, qui font place à l’expérience concrète et incarnée dans l’enseignement du projet de conception. L’ambition de cette étude est de comprendre pourquoi, aujourd’hui plus qu’hier, ces pédagogies se tournent vers une approche qui sollicite le corps qui apprend à travers des relations renouvelées avec la matérialité des choses et du monde. Au terme de cette entreprise, il s’agit de cerner ce que mobilisent et produisent ces activités et dispositifs éducatifs chez les futur·es designers, dans leur pratique du projet de conception et pour la construction de leurs savoirs.
En rappelant dans un premier temps le contexte déclencheur de cette recherche, je souhaite montrer comment la diversité du champ des pratiques éducatives étudiées m’encourage à adopter une investigation située, mais aussi voyageuse. Grâce à un tour d’horizon des méthodologies investies au cours de mes activités de recherche, j’exposerai les savoir-faire, les manières et moyens auxquels je recours. Ceux-ci forment autant de dispositifs et de dispositions médiatiques que d’interpositions et de transpositions modales formant une écologie complexe et agentive. Cet article est l’occasion d’appréhender l’approche qualitative sous l’angle de cette écologie plurielle et hybride en se demandant comment la méthodologie et l’épistémologie s’articulent et s’influencent.
1. Dans un contexte de recherche diffus, le voyage comme genre de l’investigation
En tant qu’architecte, j’ai rapidement constaté les limites de ma formation : je ne savais pas clairement ce que je dessinais, autrement dit, je ne maitrisais ni les tenants ni les aboutissants du projet de conception. Plus tard, en tant qu’enseignante en établissement supérieur dans les domaines du design d’espace et d’objet, je m’aperçois de la nécessité de changer ma pédagogie à la faveur d’une approche plus concrète et plus sensible aux moyens amenant à l’artéfact. Au-delà d’une volonté d’améliorer les compétences des futur·es professionnel·les, ce renouvellement stratégique des apprentissages répond plus largement aux enjeux sociétaux d’une époque qui acte l’influence des activités humaines sur notre environnement. La dérégulation du climat et la fragilisation des écosystèmes constituent alors une porte d’entrée de la recherche pour saisir l’envergure des défis que l’éducation doit relever pour former les futures générations à vivre dans un monde instable et de moins en moins vivable, un défi qui touche tant aux modalités d’exercice professionnel qu’à l’intrication des problèmes à résoudre.
Le design, qu’il soit rattaché au textile, à l’aménagement ou encore à la communication, contribue à cette fragilisation par les impacts de sa production et la promotion d’un mode de vie sans limites. Ces dernières années, en Amérique et en Europe, les revendications de la part des personnes apprenantes et enseignantes se font pressantes : grèves scolaires pour le climat, coalitions étudiantes, bifurcations professionnelles1… alertent sur l’inertie des institutions académiques quant à la prise en compte de l’urgence de la crise environnementale, toutes témoignent à leur façon d’une quête de sens au sein des pratiques éducatives et professionnelles. Cette inadéquation au sein des formations rappelle la nécessité de créer des porosités avec l’éducation relative à l’environnement (ERE)2 tout en s’interrogeant sur les formes que peut prendre un enseignement du design résolument écoresponsable.
Depuis les années 2010, je perçois cet engagement dans l’émergence d’initiatives isolées ou collectives répondant aux enjeux écologiques du projet par un recours plus important à l’expérience concrète du corps. Il se traduit dans l’engouement pour les workshops et l’émergence des chantiers participatifs (design/build), dans l’usage des technologies lowtech ou encore par une recherche innovante dans les matériaux et les savoir-faire. Ces pratiques pédagogiques, qui fondent leur processus d’apprentissage sur un rapport singulier aux corps, à la matérialité et aux milieux de vie, suscitent de nouvelles relations à même d’influencer la manière et la valeur de ce qui est appris.
Faire le constat d’un changement au sein des pédagogies du design m’amène à considérer deux grands objectifs : celui d’informer et celui d’inspirer les pédagogies, afin de soutenir leur engagement envers les questions éco-socio-matérielles du projet. Premièrement, informer les pédagogies mobilise, tout d’abord, une compréhension générale des dispositifs éducatifs proposés, par la documentation et la caractérisation de leurs motivations et moyens, de leurs temporalités et manières de faire. Deuxièmement, inspirer les pédagogies requiert de cerner les apports et les répercussions de ce vécu d’apprentissage tant pour les personnes apprenantes et enseignantes que pour le sens donné aux pratiques éducatives et professionnelles.
1.1. Le caractère multiple du contexte d’étude
Au regard de ce cadre de recherche, penser les modalités de mon investigation me place devant une certaine complexité, celle d’une réalité éducative diverse et peu comparable. Avec le souhait de comprendre des pédagogies émergentes et ses phénomènes, je n’ai d’autres choix que de m’interroger sur les limites de cette enquête tout en m’ouvrant à la pluralité des pratiques étudiées. En cela, mon investigation se veut multiple. Elle ne se focalise ni sur un domaine d’application spécifique ni sur un métier. Elle accueille les différences et les singularités d’une discipline aux limites floues en se demandant : comment embrasser un phénomène éducatif sans réductionnisme ?
Il faut admettre que le design agrège au fil du temps des domaines ayant des finalités, des moyens et des savoir-faire peu concordants. Digne héritier des arts dit « utiles » par sa vocation envers l’artéfact, il évolue au XXe siècle vers un design de planification et de résolution de problème, un design d’interaction et de service, ou encore vers un design social privilégiant le bien commun et la participation des parties prenantes (Vial, 2021[2015]). Cette cohabitation, quasi contre nature, montre certes l’étendue de ses finalités et de ses champs d’intervention, mais, précise Vial (2015), elle active parallèlement les débats sur la nature de ses méthodes revendiquant tantôt des filiations avec les sciences et l’ingénierie, tantôt avec les arts ou les humanités. Prenant compte de cette spécificité, un des premiers théoriciens du design, Archer (1979), reconnait le design comme une discipline dépassant toutes volontés d’affiliation, sorte de carrefour interdisciplinaire où se rassemblent celles et ceux qui se préoccupent des enjeux d’une culture matérielle.
Entreprendre une recherche sur les pédagogies du design, c’est alors témoigner de cette réalité plurielle, expansive et poreuse. Une telle intention peut paraitre ambitieuse, mais elle répond à la réalité d’un enseignement du design multidisciplinaire, multiculturel et multipraxéologique. Néanmoins, la préoccupation environnementale portée par cette recherche me dirige vers les domaines de formation qui contribuent à une production artéfactuelle concrète, tels que le design lié au textile, à l’objet, au graphisme ou encore à l’architecture. Si leurs finalités se rejoignent dans l’amélioration de notre qualité de vie, leurs spécificités ne me permettent pas d’envisager une stricte comparaison. Toutefois, les modes de faire, de penser et d’apprendre des protagonistes sur une question qui les touchent – c’est-à-dire l’influence de leur activité sur l’écosystème – m’apportent un éclairage sur de possibles communs et des singularités, une dynamique propice pour y aménager du sens.
1.2. La vocation diffuse de l’investigation
Cette étude est guidée par deux conditions : premièrement, la nécessité d’aller là où les pédagogies visées se font, et deuxièmement, le souhait de contribuer au développement d’une recherche francophone en science de l’éducation et du design. Ces deux conditions m’incitent à voyager entre deux territoires, le Québec et la France, afin d’appréhender différentes cultures académiques de l’enseignement public. Les équipes pédagogiques de quatre établissements : le Cégep du Vieux Montréal (CVM), la Haute école des arts du Rhin (HEAR), l’École d’architecture de Bretagne (ENSAB) et l’École des arts et des cultures (ÉdAC) de l’Université du Québec en Outaouais (UQO) acceptent de participer à cette enquête multisituée. Pour les sociologues Namian et Grimard (2016), cette géographie diffuse de l’enquête, éprouvée en sociologie face au développement de la mobilité, a l’avantage « de faire tenir ensemble des terrains habituellement dissociés » (p. 24). Elle amène le ou la chercheur·se à changer son angle de vue, lui permettant de distinguer la singularité de chaque terrain et d’enrichir ses perspectives sur le sujet.
En allant d’initiative en initiative éducative, de rencontre en rencontre, l’enquête multisituée fait du voyage un genre à part entière de l’investigation en recherche. En voyageant, j’adopte le point de vue d’une chercheuse-voyageuse, celui-ci diffère, selon Berque (2010), de celui de l’habitant·e. Le géographe précise qu’il s’agit d’une « Question de point de vue : celui de l’habitant n’est pas celui du voyageur, qui a navigué d’échelle3 en échelle et doit pouvoir distinguer les unes des autres » (p. 23). Le voyage me permet ainsi de mettre en rapport les mondes éducatifs visités et de mesurer leurs particularités. Mes rencontres avec les habitant·es des pédagogies m’invitent à voir et écouter leurs vécus et leurs points de vue sur l’apprentissage, des rencontres qui « implique[nt] d’entrer dans le sens de l’Autre », selon Paillé (2010, p. 118). Par ailleurs, soulignant le lien étroit entre les mots « relation » et « récit »4, l’auteur assimile le travail d’analyse et d’interprétation au récit du voyage et des rencontres.
Cette posture explorative de la voyageuse contrecarre toute intention visant la compréhension d’un système global, mais tient compte de la singularité de chaque contexte visité. J’arrime volontiers cette géographie diffuse de la recherche à la pensée archipélique promue par Glissant (1997) qui, passant d’une perspective continentale à celle des archipels, se détourne d’une compréhension systémique. Les terrains me marquent par leurs diversités et leurs singularités, ils proposent des détours et des découvertes fortuites. Chaque initiative pédagogique rencontrée est alors reconnue comme un monde à part entière, porteur d’une réalité insulaire, d’une culture et d’un langage qui lui est propre. En ce sens, l’état des pratiques réalisé par cette étude a vocation de faire apparaitre la singularité de chaque terrain tout en accueillant le pluralisme qu’offre cet ensemble « archipélique ».
2. Une méthodologie bricolée pour une imprégnation plurielle
Cette mise en contact avec les réalités plurielles et singulières des pédagogies du design confère une coloration « qualitative » à cette recherche. Grâce à la portée attributive et prédicative5 de la qualité, la recherche dite qualitative m’aide à saisir l’état des pratiques d’apprentissage en cherchant à définir leurs traits de caractère, leurs propriétés, leurs valeurs… En adoptant les pratiques de l’anthropologue, de l’ethnographe ou du phénoménologue, les chercheurs Guillemette, Luckerhoff, Plouffe et Fall (2018) caractérisent ce type de recherche par trois grands principes : son ouverture à la découverte, qui ne peut se prévaloir de toute préconception, sa fidélité descriptive ainsi que son attention aux phénomènes du « vécu humain à partir de la conscience que les vivants en ont » (p. 14).
Paillé et Mucchielli (2016) y voient « une logique de proximité » (p. 13), c’est-à-dire une méthodologie favorisant une mise au contact des personnes, de leurs actions et témoignages. Cet ancrage de la recherche, au réel des situations d’apprentissage que vivent celles et ceux qui m’intéressent, s’aide d’une méthodologie que je comprends dans sa pleine acception grecque – metá « après, qui suit, avec » et hodós « chemin, voie » – telle une manière de poursuivre un chemin. Se pose alors la question de savoir comment préparer un travail de terrain et d’analyse qui accueille de possibles détours, imprévus ou errances. Volontairement mixte, mon approche de la méthodologie s’oppose à toute volonté de planification rigide et linéaire. Elle me sert de repère au cours de mes investigations et balise mes interventions. Telle une boite à outils, je sollicite ces balises actionnelles et attentionnelles à la demande, en fonction des opportunités et des besoins des situations. La méthodologie me guide sans m’obliger. Elle est pensée pour me laisser découvrir les moyens réellement sollicités au fil des immersions ainsi que les orientations qui en découleront dans mon travail interprétatif.
Cette souplesse, que certain·es diront bricolée, peut sembler fragiliser la rigueur d’une démarche qualitative. Cependant, l’analyse de Savoie-Zajc (2019) en fait une pratique répandue chez les chercheur·ses francophones. Ce bricolage méthodologique s’éloigne, tout d’abord, d’une préconception « naïve » de la réalité (Kincheloe, 2005, p. 324) en embrassant la complexité et l’imprévisibilité du vécu fait « des multiples registres et stratifications du réel social » (Olivier de Sardan, 2008, p. 13). Dans mon étude, le contexte sanitaire (covid) tout comme l’éloignement des terrains et le calendrier pédagogique, ne me permettent pas d’opérer l’ensemble des activités de récoltes envisagées (vidéo, photographie, échantillonnage, etc.). Grâce aux balises, je garde confiance et je m’adapte au cas par cas pour récolter ce que chaque initiative peut me donner.
Puis, le bricolage s’emploie à désacraliser les méthodes et les techniques déjà éprouvées et reconnues par les pairs afin de coller à mes préoccupations. Ainsi, au cours du travail d’analyse, je n’hésite pas à élaborer des grilles de lecture dédiées à l’émergence sensitive au cours des pratiques éducatives, qui s’appuient de grilles existantes (Faingold, 2022; Vermersch, 2019). Savoie-Zajc origine cet intérêt pour le bricolage méthodique (ou bricologie) dans La pensée sauvage de Lévi-Strauss (2021[1962]). En différenciant la posture projective et inédite de l’ingénieur à celle rétrospective et dialogique du bricoleur, l’anthropologue fait du bricolage le signe d’une science concrète capable d’inventorier, de négocier et d’ouvrir le sens des ressources à disposition des chercheur·ses.
Tout en reconnaissant pleinement le bricolage, comme un genre à part entière du processus de recherche, pour ses qualités d’ajustement au réel, mon approche admet des limites, celles d’une non-saturation ou d’une disparité des données. N’adhérant pas au souhait d’une théorisation généraliste et transférable, le travail d’investigation et d’interprétation prend en considération la contingence des contextes, et la singularité des phénomènes émergents (Proulx, 2019). Partant de là, il me semble opportun de regarder de plus près les balises convoquées, qui sont autant de moyens et de manières d’appréhender et de documenter les pédagogies visées dans une logique de proximité et d’investigation voyageuse.
2.1. De l’immersion incarnée à l’émersion descriptive
Aller à la rencontre de celles et ceux qui font et vivent les pédagogies m’incite à appréhender l’expérience éducative à travers un ensemble de facteurs mêlant autant le social que l’intime, autant le matériel que le culturel. Cette approche repose, en premier lieu, sur un travail de terrain, au plus près des situations naturelles et au cours desquelles la démarche de l’anthropologue « consiste d’abord à nous étonner de ce qui nous est le plus familier […] et à rendre plus familier ce qui nous est étranger6» (Laplantine, 2001, p. 24). Basée sur l’immersion au sein des groupes ou communautés étudiées, l’anthropologie est une pratique d’« imprégnation » (Olivier de Sardan, 2008, p. 51) rendue possible grâce à l’observation et à l’interaction. De cette pratique, Ingold (2017) distingue deux postures souvent confondues : celle de l’anthropologue et celle de l’ethnographe.
La première reconnait la nature incarnée de l’immersion que ce soit dans l’incorporation des compréhensions ou par la portée transformationnelle de l’interaction. À chaque escale, je partage le quotidien des classes. Je suis attentive au déroulé des séances consacrées aux expérimentations matérielles, à l’initiation de techniques ou encore à la fabrication d’objets. Lorsque l’occasion se présente, je reproduis certains gestes, tels que l’encrage d’un écran sérigraphique ou le malaxage d’un mélange terre/paille. Je jauge les difficultés et les satisfactions. J’écoute et questionne en accompagnant la mise en mot des vécus d’apprentissage. Toutes ces balises sont autant de dispositions corporelles et actionnelles, qui me font interagir avec les êtres qui me préoccupent – apprenant·es et enseignant·es – et ressentir une forme d’empathie dans le but de réduire les idées préconçues et le manque de nuance.
La seconde posture, celle de l’ethnographe, reconnait la nature descriptive de l’émersion7 qui marque la sortie de l’état d’immersion. Archiviste, l’ethnographe est garant·e de la mémoire physique et concrète de sa propre expérience et de celle du groupe. Au cours des séances, je glane et échantillonne des matières utilisées (bambou, laines, paille de blé, etc.). Je photographie les objets, outils et équipements. Je consigne leurs mesures. En parallèle, j’enregistre des entretiens. Je capture des moments importants : en plan large pour les déplacements, les rythmes, la nature des activités, etc., en plan resserré pour une procédure, la répétition d’un geste, la manipulation d’un outil, etc. Ces balises matérielles forment un dispositif documentaire – images, textes, sons… – faisant état des pratiques et des vécus d’apprentissage, elles m’apprennent sur les êtres qui me préoccupent.
Malgré leurs spécificités, je vois dans ces deux postures une manière complémentaire de saisir et de comprendre l’expérience d’apprentissage. Si la visée descriptive et mémorielle de l’ethnographe reste facilement notable dans le processus de recherche, attribuable à son caractère médiatique et multimodal, la nature incorporée et transformationnelle de l’anthropologue peut paraitre fugace, dans la construction du sens. Cependant, je constate que ni l’immersion incarnée ni l’émersion descriptive ne délaissent les caractères d’une pratique d’imprégnation : la première observe et interagit grâce à la présence du corps; l’autre observe et interagit grâce aux outils de la représentation et de l’archive. En cela, l’imprégnation use d’une double posture tant réceptive que productive afin de maximiser les chances de compréhension, et « de pouvoir observer ou écouter ce à quoi le chercheur n’était pas préparé » (Olivier de Sardan, 2008, p. 51). Mais, au-delà de ce constat, il me semble nécessaire de voir comment la progression du sens en recherche use de cette double investigation.
3. Modes et médiums de la recherche, une écologie dispositionnelle
Cette oscillation des conduites d’enquête montre l’importance accordée par la recherche qualitative vis-à-vis de l’expérience, que ce soit celle des participant·es ou celle des chercheur·ses. Cette double focale – interne et externe du rapport à soi et à l’autre – requiert une attention de tous les instants; elle demande une appréciation multisensorielle et réfléchie sur ce qui peut avoir du sens dans les phénomènes observés. Dès lors, il s’agit de mettre au jour de quelle manière l’expérience éprouvée et partagée informe la recherche, comment se forme et se pérennise le sens tout au long de ce processus.
Face aux difficultés d’accès au vécu intime de l’autre, l’ensemble des techniques et étapes de recherche (collecte, archivage, traitement, analyse, etc.) prend en compte les principes de la sémiotique sociale8 développée par Kress en reconnaissant la diversité des manières et des moyens de recevoir, de comprendre et de produire du sens. Ces manières de (se) représenter et de comprendre le monde sont présentes, par exemple, dans les dessins et les prises de note de la chercheuse, ou dans le touché comparatif d’une matière et l’intonation d’un témoignage. Elles reposent sur des médiums venant concrétiser et distribuer les représentations (livre, matière, écran, corps, etc.). Kress (2019) note que le sens dépend des limites et des affordances de chaque mode et médium, il se nourrit de leur complémentarité et de leur combinaison. En cela, les modes d’investigation, d’analyse et d’interprétation privilégiés par cette étude reconnaissent l’étendue, l’entremêlement et la portée médiologique (Debray, 1999) des « dispositifs matériels », des « dispositions corporelles » ainsi que des « interpositions et transpositions modales ».
Je retiens des dispositifs matériels et des dispositions corporelles de la recherche leur caractéristique commune, celle de mettre l’emphase sur l’écart (dis-) des positions (latin pono « poser, placer »). Cet écart distingue l’origine et la singularité de chaque nature réceptive – qu’elle soit vivante ou inanimée – tout en considérant leur ensemble comme un tout plausible. Se référant aux travaux de Bardin, Lahuerta et Méon, les didacticiennes des arts Richard, Théberge et Majeau (2017) entrevoient trois enjeux au dispositif : celui de donner à voir un processus pour faciliter la réception, celui d’agencer les signes pour développer le pouvoir d’agir, et enfin, celui de « modifier des manières de faire, de créer, pour tenter de faire évoluer les catégories à partir desquelles elles sont pensées » (s. p.).
Pour ce qui est des inter- et trans-positions modales, j’y retrouve les jeux et enjeux relationnels de ces écarts, ce que Martin Krampen réfère à une « sémiotique écologique » (Mareis, 2023, p. 149). Pour autant, l’intermodalité et la transmodalité n’appellent pas les mêmes jeux relationnels. Avec son préfixe inter– « entre », l’interposition se fait synonyme de médiation; les modes de faire, de représenter et de signifier jouant les intermédiaires entre les contextes, les personnes, les médiums, etc. Quant à la transposition, le double sens de son préfixe trans– convoque soit la traversée par les jeux de transfert et de traduction pour « migr[er] d’une forme à l’autre » (Richard et al., 2015, s. p.), soit l’au-delà par le dépassement de chaque mode dans ses capacités à représenter le réel pour devenir un « méta-mode », tel que le définit Kress (2011, p. 255).
3.1. Des dispositifs matériels
En cohérence avec les pratiques éducatives étudiées, je porte une attention particulière aux moyens matériels de mon investigation. Si certains sont sophistiqués, tels que l’ordinateur sur lequel cet article est écrit, d’autres sont cuisinés et élaborés patiemment, récupérés et bricolés. Le travail de terrain est ainsi l’occasion de façonner un carnet pour mes prises de notes ou des pochettes pour la collecte d’échantillons, tous faits à partir de papiers accumulés depuis des années (cf. Figure 1). Ensuite, le travail de transcription graphique réalisé à la suite des collectes m’incite, dans la même optique, à créer un dispositif matériel qui soutienne la minutie et la patience requise pour cette activité. Le recours à une table lumineuse fabriquée, l’élaboration d’encres naturelles (cf. Figure 2) ou encore la recherche d’un papier local et artisanal9 participe à ce souci de cohérence entre les moyens et les intentions de la recherche. De plus, ce dispositif m’assure un vécu positif, qui m’apaise et m’accompagne dans une approche lente de la recherche.


L’ensemble de ces dispositifs matériels soutient l’action de décrire et de documenter les activités d’apprentissage dans le but de représenter et de pérenniser les phénomènes qui se présentent lors du travail de terrain. Saisir ces apparitions fugaces grâce à leur recension et leur description tente de les rendre sensibles et présentes à l’esprit au moyen de signes hétéroclites. Cette démarche ethnographique accumule une somme conséquente de collectes. À titre d’exemple, lors de ma rencontre avec des graphistes en formation à l’ÉdAC, je filme les gestes, les postures, les explorations graphiques réalisées, je photographie le résultat de leurs essais, je reçois de la part des apprenant·es quelques outils fabriqués ou glanés dans la nature, je mesure le support mis en place par l’enseignante pour protéger le sol, etc. Tantôt nommée « corpus » ou « recueil de données »10 (Olivier de Sardan, 2008), cette recension prend ici la forme d’une collection, sorte de journal de pratique polymorphe réunissant des objets hétéroclites produits à partir des observations ou directement extraits des lieux d’apprentissage.
Ce passage de la collecte vers la collection – j’y reviendrai plus en détail à la section 3.3 – engage tout d’abord une appréciation quant à l’état de cette matière première : son potentiel, son accessibilité, sa lisibilité, ses limites, etc. Elle motive ensuite sa mise en condition : archivage, transcription, mise au propre, etc., pour qu’elle devienne un matériau de recherche. La collection sert aussi bien de preuve par la valeur de chaque élément que de récit à la vue de l’ensemble créé. Elle porte en elle des qualités démonstratives qui m’aident à déceler des indices et faire voir ce qui importe; une qualité qui facilite l’appropriation du récit expérientiel en ravivant ma mémoire des évènements ou en plongeant dans la mémoire des protagonistes.
3.2. Des dispositions corporelles
Les dispositions corporelles nous rappellent « que le corps reste le premier des médiums : les dispositions physiques et mentales sont autant de modes de représentation (geste, mimique, parole, aperception, etc.) reposant sur une matérialité dynamique et expressive » (Chaillat et al., 2024, p. 12). Cette centralité du corps dans la formation d’un sens multimodal fait de la sémiotique un processus intersubjectif (Pink, 2011; Kress, 2011) qui met au jour le lien tangible entre le sentir (sap) et le savoir (sapien). Cette dernière repose sur les facultés multisensorielles nécessaires au processus de réception-compréhension-production, une dimension définie comme telle :
La dimension multisensorielle du corps se mesure en fonction de ces capacités et expériences. Elle permet de se tourner à la fois vers l’univers extérieur (extéroception) et vers le monde intime (intéroception) de notre corps. Elle s’active dans la réception d’un message, d’un artéfact ou d’une œuvre, contribuant ainsi à leur dimension productive. (Richard et Monvoisin, 2023, p. 90)
Souvent mis à l’impasse en raison de leur caractère implicite, les enseignements de la (psycho)phénoménologie (Vermersch, 2019) ou encore de l’anthropologie des sens (Pink, 2011) balisent mes investigations en considérant le corps comme un filtre sémantique, et la perception comme une dynamique à la fois active et passive, physiologique et culturelle.
Au cours du travail de terrain, ces dispositions corporelles sont bien présentes lorsque chaque contexte produit en moi une acculturation; lorsque les doutes et les espoirs des participant·es m’interpellent et résonnent en moi; lorsque la reproduction de certains gestes m’imprègne en sensations et me fait ressentir la justesse et les efforts des activités d’apprentissage. Le déploiement interprétatif demande également une mise à disposition particulière de la chercheuse. Pour Paillé et Mucchielli (2016), celle-ci « relève du type de regard posé sur le réel » (p. 140) qui s’apprécie tant par l’angle que par la mesure d’une investigation fidèle au terrain. Elle s’aligne avec « l’attitude phénoménologique » (p. 143) décrite par les auteurs, qui est tout autant une disposition de soi qu’une disponibilité à l’autre rendue possible par la réception des « choses pour ce qu’elles sont, telles qu’elles sont, telles qu’elles se présentent, comme elles se présentent » (p. 145). L’examen phénoménologique, qui en découle, retarde toute interprétation hâtive et procède par relectures successives. Celles-ci amènent une compréhension empathique en revivant l’expérience de l’autre grâce aux potentiels représentatifs de la collection et les facultés aperceptives de l’analyste.
3.3. Des inter- et trans- positions modales
Pour orienter mes techniques de collecte, j’envisage les interpositions et transpositions modales en retenant la déclinaison du terme « décrire », utilisé par Paillé (2011), allant de « transcrire, tracer, exposer » (describere) à « écrire » (escribere). Partant de ces quatre significations : 1) « transcrire » me permet de passer d’un mode à l’autre (du geste à l’écrit, de l’écrit à l’image, etc.) afin de produire des traces des activités sous la forme d’images (vidéo, photo) (cf. Figure 3); 2) « tracer » m’aide à inventorier les moyens matériels significatifs des pratiques d’apprentissage (objets, outils, équipements, etc.) grâce au relevé graphique, puis sa mise au net; 3) « exposer » procède dès le prélèvement d’échantillons (cf. Figure 4) dans le but de donner à voir l’orientation praxique de la proposition éducative; et pour finir, 4) « écrire » soutient l’observation des séances grâce à des prises de notes détaillant aussi bien le déroulé des tâches que la nature des échanges.


Pour que ces collectes deviennent collection et que la chercheuse-voyageuse habite cette mémoire archipélique et collective, les inter- et transpositions modales envisagent l’analyse grâce aux actes de « ménager » et « d’aménager » – du latin mansio, « habiter, séjourner ». Ces (a)ménagements documentaires ont pour but de préserver et d’organiser ce qui a été décrit et recensé. Ménager les collectes revient à fouiller et examiner, en éliminant l’inessentiel, le hors cadre, dans le but de réduire l’illisible et le disparate. Ces activités cherchent certes à valoriser le potentiel informatif des collectes, elles cherchent aussi à dire avec mesure et ménagement. Ensuite, pour aménager la collection, je dispose, combine ou croise les collectes les unes par rapport aux autres, dans le but de tester l’harmonie des assemblages, de jauger leurs proximités ou espacements, tout en renouvelant les ensembles. Ces activités tendent à stimuler les dynamiques de la collection, car le dispositif, reconformable à l’envie, provoque des impressions et expressions qui s’ajusteront tout au long du déploiement interprétatif (Figure 5)11.

Cette progression interprétative est marquée par l’effort de médiation nécessaire pour délimiter la valeur des choses. L’article Productions hybrides/multimodales et apprentissage informel (Richard et al., 2015) fait ressortir son caractère créatif et subjectif. Présent dès « la nature plurielle des lectures » (s. p.) de l’interprète, celui-ci se prolonge dans des « manipulations sémiotiques » (s. p.) travaillant le sens par traduction, combinaison, glissement et autres mises en rapport stimulant la réflexion. Cette recherche prend le parti d’explorer cette créativité interprétative grâce aux affordances de la graphie (du grec graphê « écriture ») en alternant et croisant le mode textuel, fait de signes, au mode visuel, fait de lignes et de figures. Le mode textuel adhère à l’usage privilégié de l’écriture en recherche qualitative et rejoint les principes de « l’analyse en mode écriture » (Paillé et Mucchielli, 2016). Celle-ci se fonde sur l’élaboration d’une pensée librement déposée grâce à un travail d’annotations où « aucun appareillage, moyen technique ou formatage n’est considéré comme nécessaire » (p. 193). Quant au mode visuel, il s’aligne à l’usage privilégié de la représentation en design. Entendu comme un « dessin » à « dessein », il médiatise l’idée par l’attention aux détails et la recherche de l’invariant dans la superposition des tracés.
Ces logiques, gestes et médiations dispositives, Belin (1999) les caractérise tel un réseau dense d’éléments hétérogènes propices à l’acte de disposer, ne sont, selon l’auteur, susceptibles de créer du sens qu’à la condition de préserver la vraisemblance et de garantir la bienveillance de l’environnement de recherche. Pensés dans cette étude pour soutenir l’appréhension et l’appropriation d’une réalité « brute » en toute confiance, ces médiations dispositives facilitent l’effort d’analyse « pour unifier ce qui est disparate » (p. 253) et pour éliminer « une infinité d’hypothèses de façon à créer un système d’attentes mesuré » (p. 258); surtout, elles médiatisent déjà l’idée sous-jacente aux collectes : elle me porte vers la production de connaissances.
4. Pour une épistémologie de l’épistolaire
Je vois dans les logiques dispositives, que nous venons de voir, l’effort de la chercheuse à étendre, démultiplier et ouvrir les manières possibles de comprendre. Cette diversité, je la considère comme une précaution, qui vise à ralentir et dilater le présent de l’imprégnation – de l’observation à l’interprétation – pour mieux l’appréhender; mais aussi, une précaution qui cherche à compenser la singularité et les limites de chaque mode et médium. Cette attention méthodique me permet de cheminer vers l’interprétation, mais elle ne vaut que si ces matérialités et incorporations dispositives se croisent et se rencontrent grâce aux interpositions et transpositions modales. C’est à cette condition que les ressources de la recherche peuvent entrer en résonance et se répondent les unes avec les autres dans un jeu de correspondance.
Alors qu’Olivier de Sardan (2008) fait de la recherche qualitative une affaire de savoir-faire, cette écologie de la recherche appelle à regarder de plus près comment se construit ce savoir. Cet intérêt ne vise pas une réponse applicative ou procédurale, mais questionne la nature épistémologique de la recherche qualitative, plus précisément celle que j’entreprends. Je vois dans cette question les prémices d’une acception épistolaire de ce que peut être une épistémologie qualitative.
4.1. L’épistémologie, une construction écologique du savoir
L’épistémologie emprunte aux sciences12 la constitution d’une connaissance validée car tranchée. Elle recourt aux débats argumentés et se base sur la critique afin d’examiner le monde de manière rationnelle et raisonnée. Au détour d’un article sur la matrice moderne des sciences et des arts, Latour (2005) voit, dans le XVIIe siècle européen, un tournant épistémologique déterminant quant aux manières de concevoir, entendues telles que les manières de former une connaissance. Ce changement repose sur une considération renouvelée de la nature par le fait de discerner deux types de qualités aux choses : les propriétés et les valeurs.
Reconnues par les sciences, les propriétés de la chose constituent « l’étoffe dont le monde est réellement fait » (Latour, 2005, p. 3). Elles font de la chose un objet, que l’on peut étudier, et qui permet de définir le réel par une adhésion commune aux faits (matters of fact). Alors que les valeurs de la chose, qui marquent un rapport intime et senti au monde, sont écartées d’une conception raisonnée du réel. Pour l’auteur, la polarisation des propriétés doit être remise en question au profit d’une épistémologie qui redonne une place aux dimensions affectives des choses (matters of concern) dans la construction des savoirs.
L’enjeu épistémologique de la recherche qualitative, et la difficulté qui en résulte pour les chercheur·ses, est de faire émerger un savoir de et avec la complexité du réel (Kincheloe, 2005), à laquelle une polarisation simplificatrice des qualités ne peut répondre. La revendication affective du savoir, promue par Latour, fait ainsi écho à la pensée complexe d’Edgar Morin (2005) et sa théorie de l’auto-éco-organisation du vivant. Par extrapolation, cette dernière peut nous permettre d’appréhender une construction écologique du savoir. Morin relève deux phénomènes indissociables dans l’auto-éco-organisation : d’un côté sa désorganisation et sa dégradation, de l’autre sa réorganisation et son renouvellement. L’un et l’autre travaillent conjointement à conserver l’intégrité de l’organisme en différant le processus entropique. La complexité de ce processus vital tient, pour l’auteur, grâce à la richesse de sa diversité relationnelle et au dynamisme de son déséquilibre fait d’incertitude et d’indétermination. Ces deux facteurs obligent le vivant à s’ouvrir à son milieu pour se transformer.
L’interdépendance entre le vivant et son milieu ainsi que l’effet transformatif et définitionnel de leur rencontre m’informent sur le caractère écologique d’une progression sémiotique. En cherchant à dévoiler l’état des choses et des pratiques, la recherche qualitative accueille la double acception de la qualité en encourageant l’interdépendance et le dialogue de ces investigations et ressources. Cette ouverture sur la diversité des interactions fait de l’épistémologie qualitative une pensée résolument ouverte, riche et dynamique.
4.2. Une mise en correspondance
Dans L’Anthropologie comme éducation (2018), Ingold reconnait un mode d’investigation commun aux pratiques de l’anthropologie, de l’art, de l’architecture et du design. Toutes développent un savoir basé sur l’interaction; toutes élaborent une correspondance itérative et progressive avec le monde; toutes s’appuient de manière privilégiée « sur la créativité improvisationnelle et l’acuité perceptive des spécialistes » (p. 11). Cette construction singulière du savoir forme, selon l’auteur, une pensée en mouvement qui adhère au flux dialogique qui émane de l’interaction entre les praticien·nes de la recherche et le milieu étudié. Comparable à la compréhension complexe du vivant (Morin, 2005), la recherche est alors entendue comme une ouverture au monde et une mise en mouvement des chercheur·ses; elle accepte une part d’errances où chaque rencontre et imprévu alimentent et transforment leurs savoirs. La recherche s’apparente alors à une forme d’éducation, pour Ingold (2017), qui repose sur une démarche empirique où les chercheur·ses tentent, observent les effets et s’adaptent aux circonstances, à la manière d’« un éclaireur qui fraye un chemin et poursuit sa route pour voir où elle le conduit » (p. 32).
Ingold (2017) insiste sur l’attention requise pour être à l’écoute des faits afin de les découvrir sous un nouveau jour. Il inscrit cette attention dans une relation de correspondance avec le réel qui consiste à « apprendre à voir ce qui se passe autour de nous de sorte à pouvoir, en retour, lui répondre » (p. 32). La correspondance, comme mode du connaitre, puise à la fois dans les logiques de proximité (Paillé et Mucchielli, 2016) et dans les logiques dispositives (Belin, 1999) qui se jouent de l’écart des positions.
En cela, la correspondance cherche à unir grâce à l’éloignement et rendre concordant le sens par le relai des lectures et des réponses. J’y vois un lien propice avec la morphogénèse qui informe non pas par l’imposition de l’idée sur la matière, mais par l’émergence d’un dialogue entre différents champs de force. Construire un savoir serait alors un exercice subtil où la chercheuse, que je suis, se faufile et tente de répondre à travers un ensemble hétéroclite de traces et de données, toutes singulières et agentives.
Si l’épistémologie nait de l’association grecque epi « sur » et hístêmi « être debout » comme un supposé qui tient debout, je prends conscience par les moyens et les manières exposés dans cet article, qu’elle s’élabore grâce à la dynamique, la diversité et l’ouverture de la correspondance. En usant de médiums variés – incarnés et matériels –, l’écologisation du processus de recherche met en correspondance le caractère situé et intermédiaire des médiums qui « offre un repère pour rendre lisibles et pérennes les possibilités d’un agir commun » (Chaillat et al., 2024, p. 10), et leur caractère sensible qui « renvoie au mouvement sinueux du projet [de recherche], qui s’actualise dans la rencontre » (p. 11). Ancré mais sensible, le processus sémiotique fluctue, tâtonne, il se précise progressivement. De là, on peut s’interroger sur la nature épistolaire de la construction épistémologique proposée. Car le mot épistolaire, de son origine grecque epi « sur » et tellô « déposé, endroit », fait de la correspondance quelque chose qui se rédige et se dépose. En soutenant le caractère constructif de l’épistémologie, le caractère l’épistolaire de la correspondance l’entend non pas comme une charpente qui s’érige, mais comme un ouvrage devenu concret, dans son horizontalité, par la stratification de ses dépôts, par la patience de ses croisements et par la répétition de ses passes.
Conclusion
En partageant les modes d’investigation élaborés et employés dans sa recherche, l’auteure offre le témoignage d’une pratique qui cherche à aménager du sens en tenant compte d’une réalité complexe et changeante : une réalité qu’elle ne peut anticiper. Son choix d’étudier les pédagogies, là où elles se font, grâce au voyage et au quotidien des protagonistes, requiert néanmoins une préparation qui répond aux aléas d’un tel trajet.
Si les savoir-faire, les manières et moyens évoqués dans cet article font figure, à première vue, d’un ensemble hétérogène et hétéroclite, celui-ci répond à la prise en compte d’une réalité non idéalisée. Les balises méthodologiques déployées sous la forme de modes et médiums matériels et incarnés de la recherche sont alors autant de repères pour saisir les points de vue et les vécus des habitant·es des pratiques étudiées ainsi que ceux de la chercheuse. J’ai, sans doute par précaution, émis beaucoup de balises dans l’idée qu’une méthodologie tient aussi de l’art du bricolage, un art qui rend disponible à tout moment le bon outil ou la bonne technique. Cette approche prépare la chercheuse aux obstacles et imprévus rencontrés en démultipliant les actions possibles pour appréhender et documenter au mieux le réel. Malgré des récoltes sans aucun doute partielles, ces balises méthodologiques m’ont aidé à garder le cap face aux changements de planification des équipes pédagogiques, aux conditions sanitaires du covid, aux refus de participation, etc.
Ce caractère écologique de la recherche qualitative, tant ouvert qu’interrelié et interactif, embrasse également la complexité du terme « qualitatif » pour reconnaitre les propriétés partagées (matter of fact) et les valeurs éprouvées intimement (matter of concern) dans l’acte de connaitre. Dans ce sens, cette recherche ne nie pas l’influence, parfois problématique, des dispositions corporelles dans le processus de collecte, d’analyse et d’interprétation. Si elle accepte la part subjective et créative qui fait du corps un médium à part entière de la recherche, la chercheuse mesure, lors de son enquête par exemple, les effets perlocutoires de son intervention sur le témoignage des volontaires ou encore les préconceptions culturelles et affectives, toujours sous-jacente, dont elle est empreinte.
De la même manière, elle fait avec les limites et les manques des dispositifs matériels. Car, le travail d’enquête est un temps intense de production documentaire où il faut se résoudre à faire des choix – de capture, d’explicitation, de relevé, de description, etc. –, bons ou mauvais, au risque de passer à côté d’une imprégnation suffisante des pratiques. L’analyse qui s’ensuit est alors, aussi, caractéristique de la somme des « blancs » et des disparités documentaires. Certes, la chercheuse y pallie ultérieurement en les (a)ménageant et en les faisant dialoguer sous la forme d’une collection hybride, mais l’alternance des activités est un jeu subtil qui demande de l’expérience et une attention de tous les instants.
De ce travail, je garde l’idée que la construction du sens, au sein d’une recherche qualitative, tient non pas d’un projet, idéalisé, planifié, à appliquer, mais davantage d’un trajet non linéaire fait de proximités et d’errances, de mise en mouvement et d’immersion. De ce trajet en recherche nait une mise en correspondance entre les vécus et les points de vue, une correspondance suscitant des lectures et réponses, tel un jeu d’articulation entre les forces et les singularités de chaque indice récolté : un jeu propice à souligner le caractère épistolaire de l’épistémologie.
- À ce sujet, on pensera aux revendications étudiantes faites lors de cérémonies de remise des diplômes, aux processus de bifurcation promus par certain·es étudiant·es et professeur·es démissionnaires, ou encore à l’émergence d’un militantisme étudiant telles que les grèves scolaires initiées par Greta Thunberg ou la Coalition étudiante pour un virage environnemental en social (CEVES). ↩︎
- L’ERE a pour objectif de promouvoir une éducation qui nous donne la capacité de nous adapter aux changements climatiques. Elle apparait à l’issue du Programme international d’éducation relative à l’environnement (PIEE), du Programme international d’éducation pour un avenir viable et de la Décennie internationale d’éducation pour le développement durable. ↩︎
- L’auteur précise que le terme « échelle » renvoie ici à l’escale, avec sa racine commune skala, étant le « lieu où l’on descend ». ↩︎
- Pour Paillé (2010), il existe un lien étroit entre les termes « relation » et « récit » grâce à « une ancienne acception du mot “relation” [qui] désignait le récit d’un voyageur » (p. 117). ↩︎
- Je retrouve cette portée attributive et prédicative dans l’étymologie de qualité issus du latin qualis « de quelle sorte, de quelle espèce, de quelle nature ». ↩︎
- Les italiques sont repris tels que dans le texte de François Laplantine (2001). ↩︎
- L’émersion se définit comme une action ou un corps qui émerge d’un fluide ou d’un milieu. ↩︎
- La sémiotique sociale diffère de la sémiotique initiée par Ferdinand de Saussure dans le fait qu’elle s’intéresse davantage au processus de création du sens qu’à l’usage du sens. ↩︎
- Issus de la papeterie montréalaise Saint-Armand, les papiers sont fabriqués principalement en retailles de coton préalablement récupérés auprès de manufactures textiles. ↩︎
- Pour de Sardan, le recueil et le corpus ne suggèrent qu’un seul genre modal, celui de l’écrit. ↩︎
- Ce travail aboutit à la présentation de la collection multimodale lors de l’exposition publique : Les écologies du faire avec…, organisée du 15 au 29 novembre 2024 au tiers lieu de L’Hôtel Pasteur à Rennes. ↩︎
- Du latin scientia « connaissance » et scio « tranché, décidé ». ↩︎
Andrieu, B. et Sirost, O. (2014). Introduction à l’écologie corporelle. Société, 3(125), 5-10.
Archer, B. (1979). Design as a Discipline. Design Studies, 1(1), 18-20.
Belin, E. (1999). De la bienveillance dispositive. C.N.R.S. Hermès, La Revue, 3(25), 243-259.
Berque, A. (2010). Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains. Belin.
Chaillat, E., Charpier, A., Lourie, A., Monvoisin, C. et Reunkrilerk, D. (2024). Design et Médium(s). Sciences du design,(19). Presses universitaires de France.
Debray, R. (1999, août). Qu’est-ce que la médiologie ? Le monde diplomatique.
Faingold, N. (2022). De l’explicitation des pratiques professionnelles au décryptage du sens. GREX.
Glissant, E. (1997). Traité du tout-monde. Gallimard.
Guillemette, F., Luckerhoff, J., Plouffe, M.-J. et Fall, O. (2021). La recherche qualitative : une analyse du vécu humain. Clarification conceptuelle à partir de nos recherches avec des personnes marginalisées. Enjeux et société, 8(1), 10-35.
Ingold, T. (2017). Faire. Anthropologie archéologie art et architecture. Dehors.
Ingold, T. (2018). L’anthropologie comme éducation. Presses universitaires de Rennes.
Kincheloe, J. L. (2005). On to the Next Level: Continuing the Conceptalization of the Bricolage. Qualitative Inquiry, 11(3), 323-350.
Kress, G. (2011). ‘Partnership in Research’: Multimodality and Ethnography. Qualitative Research, 11(3), 239-260.
Kress, G. (2019). L’apprentissage en tant que travail sémiotique : vers une pédagogie de la reconnaissance. Dans V. Rivière et N. Blanc (dir.), Observer la multimodalité en situations éducatives circulations entre recherche et formation.ENS.
Laplantine, F. (2001). L’anthropologie. Payot et Rivages.
Latour, B. (2005). Qu’est-ce qu’un style non-moderne ? Dans C. Grenier (dir.), Qu’est-ce qu’un style non-moderne ? Parenthèse du moderne. Centre Pompidou.
Mareis, C. (2023). Théories du design, une introduction (M. Le Calvé, Trad.). Les presses du réel.
Lévi-Strauss, C. (2021[1962]). La pensée sauvage. Pocket.
Namian, D. et Grimard, C. (2016). Reconnaître les “zones grises” de l’observation : du trouble à la vigilance ethnographie. ERES “Espaces et sociétés” (164-165), 19-32.
Olivier de Sardan, J.-P. (2008). La rigueur du qualitatif : les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique. Bruylant-Academia.
Paillé, P. (2010). Qui suis-je pour interpréter ? Dans La méthodologie qualitative (p. 99-123). Armand Colin.
Paillé, P. (2011). Décrire, analyser, comprendre, interpréter, expliquer. Expliciter, (90), 31-51.
Paillé, P. et Mucchielli, A. (2016). L’être essentiel de l’analyse qualitative (chap. 3). Dans L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales (p. 61-88). Arman Colin.
Pink, S. (2011). Multimodality, Multisensoriality and Ethnographic Knowing: Social Semiotics and the Phenomenology of Perception. Qualitative Research, 11(3), 261-276.
Proulx, J. (2019). Recherches qualitatives et validités scientifiques. Recherches qualitatives, 38(1), 53–70.
Richard, M., Lacelle, N., Faucher, C. et Lieutier, P. (2015). Productions hybrides/multimodales et apprentissage informel : analyse de quelques pratiques d’artistes et de jeunes. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 2.
Richard, M., Théberge, M.-P. et Majeau, C. (2017). Le dispositif de création/médiation Amalgame : croiser les postures et transgresser les frontières. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 6.
Savoie-Zajc, L. (2019). Les pratiques des chercheurs liées au soutien de la rigueur dans leur recherche : une analyse d’articles de Recherches qualitatives parus entre 2010 et 2017. Recherches qualitatives, 38(1), 32-52.
Vermersch, P. (2019). L’entretien d’explicitation. ESF Sciences Humaines.
Vial, S. (2015). Qu’est que la recherche en design ? Introduction aux sciences du design. Sciences du design, 1, 22-36.
Vial, S. (2021[2015]). Le design. Presses universitaires de France.
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net