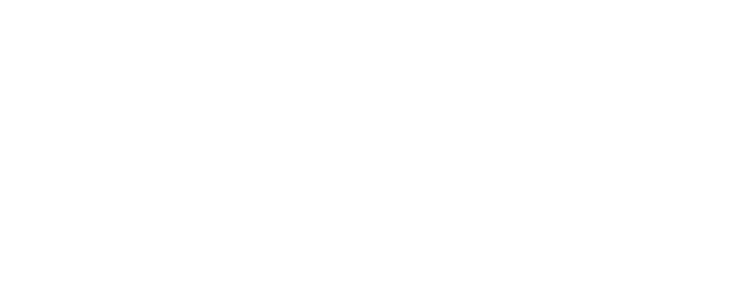Extimité en ligne et expérience artistique : retour sur un module de formation interdisciplinaire pour de futur·e·s enseignant·e·s généralistes
Cet article dresse le bilan d’un module de formation à la HEP Vaud (Lausanne, Suisse) conçu pour immerger des étudiant·e·s, futur·e·s enseignant·e·s généralistes, dans des expériences de création numérique, afin de les inciter à intégrer cette pratique dans leur enseignement et de se construire une posture de créateur·rice. Les groupes participants ont été activement impliqués dans la conception de sites internet, en utilisant divers médias, tels que textes, sons, images et hyperliens pour explorer le concept d’extimité. L’article soulève des interrogations portant sur les différentes approches visant à partager de manière artistique son vécu en ligne, en combinant des éléments réels et fictifs pour enrichir son expression personnelle, et en exploitant différentes modalités pour refléter les multiples facettes de son identité. Les données recueillies permettront d’évaluer l’impact de ces ateliers artistiques sur le groupe participant, en termes de développement de compétences en littératie médiatique multimodale et de construction d’une approche artistique singulière.
The aim of this article is to review a training module at HEP Vaud (Lausanne, Switzerland) designed to immerse generalist teachers in digital creation experiments, with the objective of encouraging them to integrate this practice into their teaching. Participants were actively involved in designing websites, using various media such as text, sound, images and hyperlinks to explore the concept of extimacy. The article raises questions about different artistic approaches to share one’s online experience, combining real and fictional elements to enrich personal expression, and exploiting different modalities to reflect the multiple facets of one’s identity. The data collected will enable us to assess the impact of these artistic workshops on participants in terms of developing multimodal media literacy skills and building a singular artistic approach.
Introduction
Dans la société actuelle hyperconnectée, on pourrait penser que les enseignant·e·s maitrisent facilement la production et l’analyse de contenus numériques. Pourtant, les données du Programme international pour le suivi des acquis (PISA) de 2018 montrent qu’en Suisse, 65 % des enseignant·e·s en arts visuels et 58 % des enseignant·e·s en français n’utilisent jamais d’appareils numériques avec leurs élèves durant la semaine. Il semble donc que de nombreux enseignant·e·s se sentent encore insuffisamment compétent·e·s pour intégrer les technologies mobiles dans leur enseignement. Pour répondre à ce défi, il est essentiel de réfléchir à l’intégration de ces technologies dans la formation des futur·e·s enseignant·e·s.
Une première recherche-intervention menée entre 2019 et 2023 (Périssé, 2024) a exploré les pratiques numériques en arts visuels auprès d’élèves de 8 à 15 ans en France et en Suisse, ainsi que dans la formation des futur·e·s enseignant·e·s à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (HEP Vaud). Cette étude a cherché à identifier les similitudes et différences entre les démarches de création intégrant les technologies mobiles dans un contexte pédagogique et celles de l’art contemporain, dans le but de proposer des pistes concrètes pour la formation des enseignant·e·s. En 2022, cette recherche a conduit à la création d’un module interdisciplinaire intitulé « Création multimédia : construire un site internet au croisement des mots, de l’image et du son ». Ce module invite les étudiant·e·s à concevoir un site web intégrant les dimensions littéraire, visuelle et sonore, tout en explorant le thème de l’extimité, qui désigne l’extériorisation de l’intimité sur les réseaux sociaux numériques pour valider l’image de soi (Paveau, 2015).
La deuxième recherche présentée dans cet article analyse l’impact de ce module sur les étudiant·e·s généralistes1 de la HEP Vaud, en termes de développement de la compétence à créer (Gosselin et al., 2014) et de compétences en littératie médiatique multimodale (Lacelle et Lebrun, 2014). Nous posons la question suivante : comment l’intégration de pratiques numériques et artistiques dans un cadre interdisciplinaire mobilisant la notion d’extimité permet-elle aux étudiant·e·s d’entrer dans une démarche de création artistique tout en développant des compétences spécifiques en littératie médiatique multimodale ? Cet article présente la problématique, des apports théoriques autour de la notion d’extimité et l’approche méthodologique de l’étude, ainsi que l’analyse des résultats obtenus, en réfléchissant aux potentialités de ce dispositif pour la formation de futurs enseignant·e·s généralistes en éducation artistique numérique.
1. Problématique
À l’heure d’Internet, comme le démontre le fait que 98 % des jeunes en Suisse possèdent un profil sur au moins un réseau social (Külling et al., 2022), les textes personnels, les photos et les vidéos de la vie quotidienne sont fréquemment partagés sur ce type de réseaux, ou les blogues personnels. Dans le module que nous avons mis en place, il s’agit de mobiliser la pratique créative pour engager une réflexion, avec le groupe participant, sur ces formes contemporaines d’expositions de soi, que l’on peut qualifier d’« extimes ». En partant de leurs expériences quotidiennes, iels sont invité·e·s à scénariser un amalgame2 de médias (texte, image, son) pour exprimer les multiples facettes de leur identité et de leur vécu.
1.1. L’extimité à l’ère numérique : une entrée pour travailler la littératie médiatique multimodale dans l’éducation à la création artistique
Le cadre de la LMM, en tant qu’approche de la littératie médiatique basée sur diverses habiletés à acquérir dans un contexte pédagogique, semble propice à cette entreprise. Selon Lacelle et Lebrun (2014), en créant des messages médiatiques qui intègrent une variété de modes sémiotiques, tels que le visuel, le verbal, le gestuel et le sonore, les apprenant·e·s peuvent améliorer leurs compétences. Dans le cadre de notre module axé sur la création d’un site internet, l’objectif est de faire progresser les étudiant·e·s vers le niveau 4 de compétence en productions multimodales. Ce quatrième niveau porte sur la lecture et la production de contenus multimédias. Il implique l’analyse et la gestion de diverses combinaisons de médias et de formats (comprenant vidéos, images, textes et hyperliens vers d’autres documents) (Lacelle et Lebrun, 2014). Comme le soulignent Acerra et Lacelle (2021), « le texte numérique » est souvent composé de « plusieurs codes, ressources et modes sémiotiques [qui] sont utilisés pour véhiculer le message : matières iconiques (images), verbales (textes), gestuelles (actions et gestes), cinétiques (animations) et sonores (musiques et sons) ».
Au regard de ces différents éléments, notre module propose plusieurs ateliers artistiques, chacun se concentrant davantage sur une modalité tout en abordant les autres. Les ateliers de création littéraire offrent de brèves amorces pour faciliter l’entrée dans l’écriture, intégrant des compétences techniques, telles que la manipulation du texte avec des images via des outils comme Keynote ou PowerPoint, ainsi que la production de vidéos. D’autres ateliers, centrés sur les arts visuels, offrent aux étudiant·e·s l’opportunité d’explorer des démarches créatives issues de la scène artistique contemporaine dans lesquelles sont utilisés les technologies mobiles ou le Web. Iels conçoivent des déambulations artistiques, enregistrant des sons, produisant des images fixes ou animées, et créant des vidéos-danses ou des GIF animés. Iels expérimentent des démarches participatives, invitant le public à contribuer à la création ou à interagir avec l’œuvre via des codes QR et des plateformes en ligne. Un atelier spécifique est animé par un artiste sonore, qui guide les étudiant·e·s dans la création d’ambiances sonores à l’aide de leurs téléphones mobiles intelligents3. L’enjeu est qu’iels puissent, par la suite, sélectionner les modalités les plus appropriées selon le résultat souhaité afin de créer un site artistique qui ne se limite pas à une simple présentation d’œuvres (telle une galerie en ligne), mais qui utilise les propriétés mêmes d’un site web comme matériau artistique. En parallèle des séminaires, les étudiant·e·s sont invité·e·s à enrichir leur site web personnel tout au long du semestre en réinvestissant les pratiques explorées lors des ateliers.
En outre, l’un des autres enjeux du module est de familiariser les étudiant·e·s avec la structure et les principes de production d’un site web. Iels doivent intégrer le principe de variabilité4 (Manovich, 2010), offrant aux visiteur·euse·s la liberté de choisir leur propre parcours sur le site et penser ainsi, lors de la conception, à une interaction fonctionnelle5 (Paquin, 2006). Dans chaque page, certains éléments visuels, sonores ou textuels peuvent avoir « une dimension manipulable » (Lacelle et al., 2017) par les lecteur·rice·s, ce qui va demander à l’auteur·e « d’anticiper les manipulations possibles » et de « modéliser le lecteur ou la lectrice dans le processus d’écriture » (p. 123). Le groupe d’étudiant·e·s de notre module doit ainsi utiliser des hypermédias et des hyperliens pour offrir aux futur·e·s visiteur·se·s la possibilité de choisir un parcours personnalisé à travers le site, repensant ainsi le mode d’interaction des internautes avec le contenu artistique.
Pour créer le site web, il a été proposé aux étudiant·e·s d’utiliser une plateforme en ligne permettant de créer gratuitement des sites internet en langage HTML5, et compatibles avec les mobiles. Nous avons opté pour l’utilisation d’une plateforme en ligne afin de faciliter le travail collaboratif en groupe, avec des équipes de deux ou trois étudiant·e·s intervenant sur le même site internet à distance. Chaque étudiant·e pouvait également s’approprier une partie du site pour un travail plus personnel, tout en permettant aux autres étudiant·e·s d’y accéder et de fournir des retours constructifs.
1.2. Développer une posture de créateur·rice chez les futur·e·s enseignant·e·s en intégrant des pratiques artistiques numériques dans la formation
En outre, le deuxième objectif de notre module est de développer chez les étudiant·e·s une démarche de création personnelle et singulière afin qu’iels puissent s’affirmer comme créateur·rice·s. Il est particulièrement important de cultiver cette capacité chez des étudiant·e·s qui vont enseigner la création, et n’ayant pas suivi de formation artistique en école d’art, en les encourageant à réfléchir sur leur propre processus de création (Gosselin, 2013). Il s’agit de sensibiliser les futur·e·s enseignant·e·s généralistes aux multiples possibilités dans l’enseignement des disciplines artistiques, afin qu’iels puissent, par la suite, accompagner plus efficacement leurs élèves dans la compréhension d’une démarche artistique. Ainsi, les réponses créatives des étudiant·e·s aux consignes dans les disciplines artistiques peuvent souvent se dégager de ce qui est proposé par le·a formateur·rice. Gosselin et al. (2014) proposent quatre types de réponses possibles dans le cadre de l’éducation artistique, visualisés dans le tableau ci-dessous :

L’apprenant·e peut ainsi répondre strictement aux consignes données, mais iel peut aussi opter pour une réponse en « expansion », élargissant ainsi la consigne initiale. Cela démontre déjà une prise de décision personnelle. L’enseignant·e peut alors percevoir un « retournement », concept repris par Gosselin et al. (2014) de Tremblay (2013), qui décrit le passage d’une « commande extérieure à une nécessité intérieure, dans un effort d’élargissement des perspectives » (Tremblay, 2013, p. 172). La subjectivité de l’apprenant·e s’impose de telle manière que les consignes sont modifiées et manipulées, révélant une forme d’audace, voire de désobéissance constructive. L’acquisition d’une démarche de création singulière chez l’apprenant·e s’évalue selon la manière dont iel s’approprie, manipule, voire s’affranchit des consignes pour trouver son propre chemin (Gosselin et al., 2014). Une réponse en « Écho » indique un cheminement significatif entre la consigne initiale et la production réalisée. Enfin, une réponse « Hors » signifie soit que l’apprenant·e est tellement engagé·e dans une démarche personnelle qu’iel n’a plus besoin de se référer aux consignes, soit qu’iel rejette les propositions de l’enseignant·e, exprimant ainsi une position réfractaire. C’est sans aucun doute la réponse en « expansion », en « écho », ou « hors » quand elle dénote une démarche personnelle assumée, que le formateur·rice en didactique de la création artistique souhaite voir émerger chez l’étudiant·e.
Pour Giacco et Didier (2017), accompagner les étudiant·e·s dans la compréhension de leur propre processus de création implique de concevoir une didactique de la création artistique qui « consiste à privilégier et à s’approprier des démarches artistiques. De ce fait, comprendre le fonctionnement de ces démarches nous renseigne sur les mécanismes de didactisation de la création en contexte de formation » (Giacco et Didier, 2017, p. 11). Le rôle du·e la didacticien·ne est alors de mettre à jour le « fonctionnement » des conduites créatrices des artistes, afin d’enrichir la didactique des arts (Lagoutte, 2002; Giacco et Didier, 2017). Roux (1999), quant à lui, préconise de développer l’expression personnelle des apprenant·e·s en leur proposant des situations de création inspirées des démarches artistiques contemporaines, adaptées à leurs intérêts et à leur vécu, permettant ainsi de « faire se rencontrer deux mondes » (p. 123). Dans cette perspective, nous formulons l’hypothèse que le thème de l’extimité favorisera l’implication des étudiant·e·s, car, en les invitant à puiser directement dans leur vécu personnel et quotidien, iels contourneront les blocages liés à l’idée qu’il serait nécessaire de faire appel à une imagination qu’iels pourraient redouter ne pas posséder. En outre, en tant que formateur·rice·s, nous pouvons nous appuyer sur diverses démarches de création d’hier et d’aujourd’hui intégrant une forte part d’extimité, dont certaines utilisant les technologies mobiles et le Web. Il s’agit, d’une part, de présenter ces démarches aux étudiant·e·s et, d’autre part, de les didactiser afin de leur offrir des expériences de création enrichissantes. Nous supposons ainsi que, grâce aux références culturelles et aux pratiques créatives abordées lors des séminaires, de même qu’à leur usage quotidien des technologies mobiles, les étudiant·e·s seront davantage enclin·e·s à s’engager dans une démarche de création numérique originale et personnelle.
Notre objectif principal vise ainsi à évaluer la pertinence et l’efficacité de notre module. Pour ce faire, nous examinons en quoi l’intégration de la création numérique contemporaine et l’exploration du concept d’extimité, à travers les démarches artistiques, peuvent favoriser le développement des compétences en LMM chez les étudiant·e·s, tout en les incitant à développer une démarche de création singulière.
2. Apports théoriques
2.1. Comprendre les pratiques « extimes » numériques par le prisme de l’art
Sans aucun doute, les pratiques « extimes » sur le Web prolongent les journaux intimes, et les correspondances épistolaires. Le passage de ces « expressions de soi » vers des supports numériques a permis l’émergence de formes totalement nouvelles, caractérisées par un amalgame multimodal combinant textes, sons, images et hyperliens ou hypermédias. Pour Tisseron (2002), ces pratiques « extimes » peuvent s’entendre comme « le mouvement qui pousse chacun à mettre en avant une partie de sa vie intime autant physique que psychique » (p. 52), indissociable de la notion de « désir de se rencontrer soi-même à travers l’autre et d’une prise de risques » (Tisseron, 2011, p. 85). Au contraire du journal intime sur papier, le déplacement de ces expressions de soi vers des supports numériques interroge la complexité de ces productions se construisant sur un « caché/montré » (Cauquelin, 2003, p. 7) autour desquelles d’autres internautes sont invité·e·s à commenter. Partager avec d’autres une partie de sa vie intérieure permet de la réfléchir, contribuant ainsi à « la création d’une intimité plus riche » (Tisseron, 2002, p. 53), qui se développe à travers une dynamique constante entre intimité, estime de soi et extimité (Tisseron, 2002). Dans le cadre de nos didactiques en arts visuels et en français, l’analogie avec certaines démarches d’auteur·e·s et d’artistes se révèle particulièrement féconde. Il s’agira, dans les deux paragraphes suivants – l’un centré sur le domaine littéraire, l’autre sur celui des arts visuels – d’identifier quelques caractéristiques propres à ces pratiques de création dites « extimes ». L’objectif ici est d’enrichir nos approches didactiques (Lagoutte, 2002; Giacco et Didier, 2017), afin de permettre aux apprenant·e·s d’expérimenter à leur tour diverses démarches créatives exprimant une forme d’extimité.
2.1.1. Extimité et littérature
À l’ère numérique, l’écriture de soi s’inscrit dans une filiation ancienne. D’Augustin à Rousseau, en passant par Montaigne, tous·tes ont confié les épreuves de leur vie à des lecteur·rice·s, espérant compréhension et approbation, en tant que figures représentatives de la condition humaine. En puisant dans leur intimité des éléments parfois insignifiants, iels les exposent avec une impudeur qui n’est pas sans rappeler les publications des réseaux sociaux d’aujourd’hui.
Plus récemment, Georges Perec et Roland Barthes ont joué un rôle déterminant dans l’évolution du genre. Le premier s’est attaché aux détails les plus prosaïques de ce qu’il nomme l’« infra-ordinaire » (1989, p. 11). Dans Je me souviens (2011), l’énumération impersonnelle de souvenirs collectifs esquisse pourtant un autoportrait en creux : ici, l’extérieur révèle la personne. Quant à Barthes, son Roland Barthes par Roland Barthes (1975) annonce la multimodalité du Web. L’écriture fragmentaire y suit l’ordre alphabétique, non chronologique, et assemble un patchwork d’éléments hétérogènes – photos, partitions, notes manuscrites – que le·a lecteur·rice est invité·e à parcourir librement (Messager, 2019). Pas d’hyperliens, mais un puzzle éclaté.
Or, l’art du fragment rend opaque ce qu’il prétend révéler. Il invite le·a lecteur·rice à construire un sens. L’extime numérique hérite de cette logique : il s’affranchit des continuités narratives et délègue au public la cohérence du récit. Le pacte de véracité entre auteur·e et lecteur·rice, tel que défini par Philippe Lejeune (1996), vacille. Depuis Doubrovsky (1977), l’autofiction mêle fiction et vérité, et l’exposition de soi s’accompagne d’un désir de recréation de soi. Même les formes les plus audacieuses de dévoilement conservent une certaine retenue. Conscient·e·s des risques, certain·e·s se cantonnent à décrire les éléments les plus banals de leur quotidien.
Mais, il serait réducteur d’y voir un simple culte de la déco numérique de la « chambre à soi » (Woolf, 1977). La multimodalité contemporaine pousse au contraire les auteur·e·s à transcender leur triviale routine pour en suggérer les tensions et les mystères.
Le multimodal fait donc évoluer les pratiques d’écriture de soi, quoique les pratiques littéraires traditionnelles peinent à en prendre acte. Le blogue d’Éric Chevillard, par exemple, intitulé L’Autofictif, ne franchit pas le pas : l’écrivain vendéen livre chaque jour trois brefs billets de deux à vingt lignes qui, s’ils relèvent de l’autofiction, se présentent comme des exercices de style appelés à devenir œuvre imprimée à raison d’un volume par an. Pas de son, pas d’image. De même, fasciné par Twitter, Alain Veinstein s’est soumis en 2013 à la contrainte des cent quarante signes pour en explorer les possibilités littéraires. Son projet consistait à tenter d’unifier les fragments composés au fil des jours pour en faire « une sorte de roman par tweets où la vie vécue et la vie rêvée du narrateur sont amenées à se rencontrer » (4e de couverture). Il relève ce que le numérique lui a fait éprouver : « l’impression d’écrire sans avoir à écrire », le sentiment d’une « lecture » en direct via les retweets, la « licence poétique généralisée » (pp. 8-9), mais aussi le repentir impossible sur une plateforme qui conserve tout. Ainsi, au lieu d’explorer les possibilités multimodales, Veinstein s’est finalement résolu à composer un véritable livre, soumis aux règles traditionnelles du récit : « Le souci reste […] que les phrases entretiennent entre elles de bons rapports » (p. 11).
Si, en 2015, Anne-Marie Petitjean, professeure à Cergy-Pontoise, évoque les images et les sons comme inducteurs d’écriture ou comme illustrations (Houdart-Merot et Petitjean, 2015), elle n’envisage pas la possibilité d’une création où texte, image, son, scénario et mise en page seraient manipulés ensemble dans une composition interactive.
On a pourtant vu paraitre quelques romans comme Tout cela n’a rien à voir avec moi (2013), de Monica Sabolo, dans lequel images et SMS insérés ne servaient pas d’illustrations, mais participaient à la construction du récit, invitant le·a lecteur·rice à une enquête pour en décoder le sens. Mais, la critique accueille froidement ces tentatives, surtout lorsqu’elles reçoivent le prix de Flore. La littérature, la vraie, se veut textuellement pure.
François Bon, lui, qui se dit « après le livre » dès 2011 (Petitjean, 2018, p. 130), soutient que le numérique est à l’origine d’une véritable transformation culturelle et créative. L’image et l’écriture seraient des composantes génératives de quelque chose de plus large, à explorer. Étonnamment, Bon n’y voit pourtant rien de nouveau : « la pratique de l’auteur (voix, image, lecture à ses pairs, carnet de notes) a toujours été composite » (cité par Petitjean, 2018, p. 130). Si elle prenait autrefois la forme du livre, « forme industrielle monodique à diffusion lente » (p. 136); elle conserve avec le numérique sa spécificité cross media.
Le numérique permet ainsi d’exhiber le processus et les arcanes de la création, en entretenant un rapport d’immédiateté entre production et publication. Le lecteur accède désormais à la dimension expérimentale de l’activité auctoriale. C’est peut-être là que réside le nouvel aspect autobiographique de l’écriture numérique : son immédiateté et ses potentialités multimodales racontent l’auteur·e en révélant son travail autant que ses propos – souvent eux-mêmes autobiographiques. Elle le raconte de façon fragmentée, tâtonnante, hypertextuelle, privilégiant l’écriture à contrainte et, fréquemment, la forme poétique. Comme le résume Gautier, « le texte numérique a donc des qualités expérimentales propres, qui sont essentiellement liées à sa plasticité et à son inachèvement » (cité par Petitjean 2018, p. 133). Pas étonnant qu’elles soient aussi celles de l’écriture de soi 2.0.
2.1.2. Pratiques amateurs et scène contemporaine : l’extimité dans les arts visuels
Dans les arts visuels, l’intime est devenu, au cours des soixante dernières années, une source d’inspiration majeure pour de nombreuses démarches artistiques contemporaines. Selon Hinzelin (2005), cette pratique du journal intime artistique, qu’il soit photographique (Nan Goldin et Nobuyoshi Araki), cinématographique (Jonas Mekas) ou composite (Allen Ginsberg), est née à la fin des années 1960 en parallèle de nouvelles préoccupations des sciences sociales. L’anthropologie se tourne alors vers l’individu ordinaire et ses attributs (famille, habitudes, biens matériels). Cette période voit aussi l’émergence de courants comme Fluxus, qui interrogent la frontière entre l’art et la vie, en valorisant le quotidien et le processus vécu. Pour Hinzelin (2005), le journal autobiographique devient un espace de réflexion sur un monde en mutation. Il devient aussi un rempart contre l’oubli, à l’image de certain·e·s artistes tels que Jonas Mekas, qui cherche à capturer la matière brute de son existence grâce à sa Bolex6 à portée de main. De même, Nan Goldin, à travers son journal photographique, nous donne accès à la réalité sociale d’une scène new-yorkaise marquée par les maux de son époque (sida, scène underground, drogues). Ces différentes pratiques se construisent à la jonction d’une réflexion vers le monde extérieur et d’une introspection sur sa propre existence (Hinzelin, 2005). Facilitées par l’arrivée des appareils médiatiques, ces pratiques de création se construisent à travers des moyens techniques maniables et rapides, et s’inscrivent plus dans une logique de réactivité que dans une recherche de finalité esthétique (Hinzelin, 2005).
À l’ère numérique, diverses caractéristiques de ces démarches artistiques « extimes » se retrouvent dans les pratiques amateurs, notamment le besoin d’enregistrer et de partager massivement des expériences vécues à travers des moyens techniques accessibles. Ces pratiques numériques « extimes » prennent des formes variées, telles que les blogues intimes ou les publications sur les réseaux sociaux, et utilisent différents médias, comme l’écriture, la photographie, le son et la vidéo. Selon Tisseron (2002), cette extimité numérique regroupe « les gestes porteurs de sensations et d’émotions, les images aussi bien psychiques que matérielles, et les mots » (p. 55). La différence majeure avec le journal intime papier réside dans la possibilité, sur Internet, de recevoir les retours des internautes, faisant de la communauté en ligne un « miroir privilégié de l’identité » (p. 55).
Le téléphone mobile intelligent est devenu l’appareil phare de ces pratiques « extimes », permettant aujourd’hui de partager différentes données avec autrui à tout moment. Pour Allard (2014), ces nouveaux appareils peuvent se définir comme des « technologies pour soi » qui servent de « support d’expression de l’intériorité des sujets » (Allard et al., 2014, p. 139).
Dans la continuité des démarches artistiques du XXe siècle, certain·e·s artistes du XXIe siècle ont également exploité ces « technologies pour soi » ainsi que la logique en réseau du Web pour créer des œuvres basées sur le matériau brut de leur existence ou celle d’autres individus. Dans ces œuvres, l’implication du corps de l’artiste est fréquemment mise en avant, facilitée par la portabilité des appareils, tout en intégrant des pratiques de remix et des démarches participatives faisant intervenir des tiers. À titre d’exemple, l’artiste Sophie Lambert utilise les réseaux sociaux pour intégrer les internautes dans son processus créatif. Dans son projet « 100 corps », elle invite les utilisateur·rice·s d’Instagram à lui envoyer des photos de leurs corps dénudés, explorant l’anonymat du partage à distance. Avec « Confessional I », elle crée une œuvre collective en récoltant des secrets envoyés par les internautes. Philippe de Jonckeere, de son côté, utilise le Web comme médium principal avec son site desordre.net. Ce projet mélange photographie, texte, vidéo et son pour créer un journal intime multimédia labyrinthique, offrant aux internautes une expérience non linéaire qui incarne l’extimité numérique.
Ainsi, une relation semble se nouer entre différentes pratiques artistiques et pratiques amateurs relevant de l’exposition de soi. Mais, il semble important ici, dans une finalité didactique, d’interroger ce qui sépare pratiques amateurs « extimes » de l’ère numérique et pratiques artistiques vues précédemment et utilisant les mêmes ressorts. Ce contraste pouvait déjà s’observer lors de l’appropriation par des artistes d’appareils de l’ère médiatique peu onéreux et à destination des amateur·rice·s. Comme le soulignent Baldner et Vigouroux (2005), même lorsque ces artistes utilisent des dispositifs associés à une esthétique amateur, leur pratique se distingue par une forte dimension de mise en scène et de narration. Ces images, loin d’être de simples captations spontanées, relèvent d’une intention artistique marquée, mêlant réel et imaginaire, ce qui les inscrit dans une démarche créative plus consciente et construite.
Ainsi, ce module propose aux étudiant·e·s, à travers l’acte de création, de porter un regard réflexif sur les productions « extimes » qu’iels produisent ou côtoient au quotidien. Iels sont invité·e·s à produire des fragments issus de leur expérience vécue, puis à les scénariser pour en offrir un point de vue sensible et réflexif. Ce passage par l’acte de création autour des pratiques « extimes » permet également d’appréhender les logiques de production d’un support web multimodal.
3. Méthodologie
3.1. Approche générale : évaluer les apports et les limites par la recherche-développement
L’objectif principal de cette recherche est d’évaluer les apports et les limites d’un module de formation interdisciplinaire que nous avons conçu à destination d’étudiant·e·s futur·e·s enseignant·e·s du primaire, peu initié·e·s aux pratiques de création artistique. Il s’agissait de leur permettre de mieux comprendre les enjeux liés à l’enseignement de la création numérique, à laquelle iels pourraient être amené·e·s à dispenser dans leur pratique professionnelle.
Pour répondre à cette question, nous avons choisi d’inscrire notre démarche dans le cadre de la recherche-développement, selon l’approche définie par Loiselle et Harvey (2007). Celle-ci se structure en trois phases : la conception d’un dispositif innovant, sa mise en œuvre, puis l’évaluation de ses effets (efficacité, utilisabilité, retombées). Ce travail s’inscrit dans la troisième phase, celle de l’évaluation. Bien que les résultats issus de ce type de démarche ne soient pas généralisables, ils permettent de dégager des enseignements transférables à d’autres contextes similaires (Loiselle et Harvey, 2007).
3.2. Description du dispositif
Le module analysé a été proposé entre 2022 et 2024, durant les semestres de printemps, à un total de 43 étudiant·e·s. Il s’organisait sur 8 séances de 2 h 15 (voir Annexe 1). Articulé entre la didactique des arts visuels et celle du français, il visait à accompagner les étudiant·e·s, souvent peu formé·e·s aux pratiques artistiques, dans une exploration créative à partir de leurs usages numériques amateurs (smartphones, tablettes, ordinateurs portables), pour les amener progressivement vers des pratiques artistiques numériques plus élaborées.
3.3. Moyens et outils mobilisés
Pour analyser ce module de formation axé sur la création artistique numérique, il nous a semblé pertinent d’articuler approches poïétique et esthétique, afin de comprendre ce qui se joue dans le processus de création chez les étudiant·e·s, tout en évaluant la portée esthétique ou artistique des productions réalisées.
Perspective poïétique
Dans une logique poïétique (Passeron, 1996), nous avons cherché à comprendre le processus de création vécu par les étudiant·e·s. À cette fin, deux types de données ont été recueillis :
- des récits de pratique rédigés à l’issue du module, permettant aux participant·e·s de mettre à distance leur expérience, d’en identifier les dynamiques et les enjeux (Gosselin, 2020);
- un entretien semi-directif, mené en mai 2024 avec un binôme d’étudiantes sélectionnées aléatoirement, ayant collaboré sur une même production. L’objectif était de recueillir leurs perceptions, leurs ressentis et les significations (Lincoln, 1995) qu’elles attribuent à leur démarche artistique.
Perspective esthétique
Du point de vue esthétique, nous avons souhaité évaluer la portée artistique des productions étudiantes à travers diverses entrées : examen formel des œuvres, considération de l’intention créative, réception potentielle par un public, et contexte de production (Gervereau, 2020). Ainsi, pour évaluer les travaux, nous avons opté aussi pour une approche méthodologique adaptée à des artefacts qui prétendent être, peu ou prou, des œuvres artistiques, car c’est bien ce que nous avons demandé aux étudiant·e·s de réaliser. Ce jugement sera donc un jugement de goût, nécessairement en partie subjectif, mais qui ne saurait pour autant être arbitraire. Nous suivons en cela les propositions de Michaud, qui lui-même s’appuie sur des thèses de Wittgenstein (Michaud, 2011) : plutôt que de formuler des critères a priori, qui risqueraient de ne pas convenir à la diversité des pages web conçues par les étudiant·e·s, il s’agit, pour dépasser une appréciation de type « j’aime ou j’aime pas », de développer celle-ci en cherchant à employer des mots en adéquation avec l’objet que l’on commence par décrire afin que s’élaborent peu à peu les critères qui lui correspondent. L’analyse devient alors un exercice de discernement esthétique, contextualisé et argumenté.
3.4. Triangulation des données et traitement
Cette étude repose ainsi sur une triangulation des données (Denzin, 2017), combinant l’analyse croisée des 43 récits réflexifs de 2 pages écrits par les étudiant·e·s en fin de module, de l’entretien semi-directif avec un binôme d’étudiantes, et de deux pages web créées par deux participantes.
L’analyse de ces données a été conduite selon une démarche thématique (Paillé et Mucchielli, 2016), visant à identifier les éléments récurrents, ou significatifs dans les discours et productions. Nous avons ainsi cherché à évaluer dans quelle mesure la mise en place d’ateliers de création numérique interdisciplinaire, inspirés de références artistiques expertes autour de la notion d’extimité, a permis aux étudiant·e·s de développer à la fois une démarche créative personnelle et des compétences en littératie médiatique multimodale (LMM).
4. Résultats synthétiques
Dans le cadre de cet article, nous avons choisi de présenter une sélection de productions et de retours d’étudiant·e·s, représentatifs des dynamiques observées au sein de l’ensemble du module. Ce choix, nécessairement partiel, a pour objectif de mettre en lumière la diversité des approches de création développées ainsi que le niveau de littératie médiatique multimodale atteint par les participant·e·s. Les réalisations des autres groupes restent néanmoins accessibles, pour la plupart, sous forme d’extraits vidéo sur le site internet Amorce.
4.1. Vers une exploration multimodale servant l’expression des ressentis personnels et le désir d’impliquer l’utilisateur·rice
L’utilisation de la combinaison multimodale par les étudiant·e·s semble découler principalement de leur volonté d’exprimer la complexité de leurs ressentis, de leurs émotions et les tensions qu’engendre leur diversité, tout en cherchant à impliquer davantage le·a spectateur·rice. En guise d’exemple, lors de l’entretien semi-directif, les étudiantes Romane et Fanny (Image 1), ayant basé leur site sur les thèmes des angoisses et des lieux ressources, ont expliqué comment l’utilisation et la combinaison de différentes modalités leur permettaient de traduire diverses émotions, expériences vécues, pensées et ressentis :
Romane : Alors moi, quand j’ai pensé au chalet, je me suis tout de suite dit que j’allais mettre des images parce que quand j’en parle, en général, ça ne donne pas forcément envie aux gens parce que les toilettes sont dehors, il n’y a pas d’électricité. […] ce lieu, il me rappelle aussi un côté où ça m’apaise aussi via le bruit. C’est pour ça que je me suis dit que la personne qui regarde mon site, elle ressent un peu une petite partie de ce que je pourrais ressentir quand je suis sur place. Par exemple, le feu qui crépite. Moi, je trouve que c’est apaisant. […] Donc, l’image et le son, c’est tout de suite ce qui m’est venu. […] C’est vrai que c’est assez difficile de retransmettre une émotion. Je voulais plus que juste une photo.
Fanny : Justement comme elle a dit, pour rendre une sensation, un ressenti qu’on a. Je me disais qu’en proposant des phrases, du texte, ça permettait de comprendre aussi quelle était la pièce et puis qu’est-ce que je pouvais ressentir quand j’étais là. Mais aussi d’associer différents éléments justement comme la mousse de bain qui crépite. Ça pouvait peut-être permettre de vraiment immerger le spectateur dans la pièce et dans l’émotion, l’ambiance. On voulait vraiment retransmettre.
Cet extrait met en lumière la difficulté persistante pour ces étudiantes de transcrire un vécu et des ressentis restant souvent peu extériorisés et qui se trouvent inévitablement transformés par le médium employé. Il est particulièrement intéressant de noter comment Romane se sent déjà embêtée lorsqu’elle tente de transmettre son attachement au chalet familial au cours de ses échanges avec ses ami·e·s : elle reconnait que les mots sont insuffisants pour rendre compte de cette émotion. Une seule modalité ne suffit effectivement pas à restituer la complexité de leurs ressentis. Pour ces étudiantes, il fallait que cela dépasse les mots, « plus qu’une photo ». Ainsi, comme le révèlent de nombreux retours réflexifs, pour transmettre de manière authentique leurs émotions et la diversité de leurs expériences sensorielles, les étudiant·e·s ont recours à la combinaison de plusieurs modalités. Parfois, pour évoquer un souvenir heureux ou une angoisse, il est nécessaire de conjuguer à la fois image et son; d’autres fois, un souvenir prend toute sa dimension dans l’alliance des mots et des éléments sonores.

Le passage d’une modalité à une autre a souvent l’air de se faire de manière associative, comme si le processus créatif dans l’une des modalités déclenchait le processus dans les autres. Une autre étudiante, Alexandra (Image 2 et Vidéo 3), a clairement illustré cette dynamique dans son retour réflexif :
Ce travail créatif numérique s’est révélé être une exploration sensorielle de mon environnement, mais aussi une mise en mots/en images/en son de mon intériorité. Ce que j’ai trouvé particulièrement intéressant dans ce travail, c’est d’expérimenter le processus créatif et de me rendre compte qu’il n’est pas figé ou linéaire. On s’aventure dans le texte, on gribouille, on laisse aller la plume qui fait naître des images ; on explore des prises de vues, on capture milles images, mais aussi des sons insolites, on trie, on sélectionne, on retient, en fonction de ce qui fait sens, résonne, de ce qui connecte avec le reste et soudain l’image engendre un texte ou alors un son inattendu habille l’ensemble. […] J’ai ainsi découvert au fur et à mesure que les multiples dimensions du médium numérique (image, son, mot, connexion-interaction entre les éléments) offrent des portes d’entrée variées et des possibilités de jouer avec ces dimensions interactives.
L’expérience créative a véritablement permis ici à l’étudiante d’appréhender le caractère fluide et itératif du processus de création artistique. À l’instar de retours réflexifs d’autres étudiant·e·s, on retrouve ici l’idée d’une exploration, d’un processus se construisant sur un temps long (un semestre). Cette temporalité joue un rôle essentiel dans ce module : peu à peu, l’étudiante capture différents fragments sensoriels avec son smartphone, écrit de petits textes et s’empare des possibilités offertes par le médium web et ses spécificités. L’utilisation de « cette technologie pour soi » (Allard, 2014) permet à Alexandra de s’engager quotidiennement dans une exploration de son environnement ainsi que de son intériorité. L’approche multimodale facilite une meilleure compréhension de ces investigations internes et externes. L’étudiante met en évidence la manière dont l’engagement dans une modalité expressive peut en activer d’autres, déclenchant un véritable processus de création médiatique multimodal. Alexandra illustre cette synergie en affirmant que « la plume […] fait naître des images », et que, réciproquement, « l’image engendre un texte ou alors un son inattendu habille l’ensemble ». Elle met ainsi en lumière la richesse combinatoire des mots, des images et des sons, et la manière dont ces éléments interagissent, se répondent et se nourrissent mutuellement. Cette circulation entre les modalités permet d’exprimer avec justesse son extimité, à travers les potentialités expressives du numérique. On y retrouve par ailleurs la capture de multiples essais et expériences par le biais de l’appareil, favorisant l’émergence du processus de création, tandis que le stockage de ces diverses données permet ultérieurement l’analyse, le tri, la sélection pour la scénarisation de ses pages web.

Par ailleurs, l’utilisation de différentes modalités pour exprimer leurs émotions et ressentis complexes semble souvent aussi découler de la volonté des étudiant·e·s d’impliquer de manière plus soutenue le·a futur·e internaute, comme le soulignent plus haut Romane et Fanny. Ces dernières mettent en avant comment une attention particulière, tout au long du processus de création, est portée à l’accessibilité, l’ergonomie, l’interactivité et l’expérience utilisateur·rice de leur site web. Des éléments fréquemment mentionnés par d’autres participant·e·s, comme le pointent ces différents extraits des retours réflexifs : une étudiante avance que « chaque média utilisé sur [son] site contribue à une expérience immersive et multisensorielle pour le visiteur », tandis qu’une autre cherche à offrir aux internautes « une expérience riche en sensations et émotions ». Ainsi, le public est invité à interagir et à faire des choix, comme activer des sons, des vidéos ou des liens hypertextes. Chaque élément semble avoir été soigneusement pensé pour encourager l’exploration, la réflexion et l’émotion chez les visiteur·se·s. C’est par la pratique de création et le mode de restitution, à travers un site internet, que l’interaction entre les différents médias prend ici tout son sens, permettant ainsi de saisir certains enjeux de l’intermédialité. Certain·e·s étudiant·e·s vont même plus loin en demandant une action spécifique de la part de l’internaute pour accéder à l’intégralité de la production, comme le montre l’exemple du site web des étudiantes Arijiana et Sabrina (voir dans Vidéo 1) sur le thème des empreintes.
Ce site se caractérise par une mise en avant immédiate de sa multimodalité, Empreintes est son titre, et ce thème décline ses possibles dès sa page d’accueil par une image (photo d’empreintes de chaussures dans le sable), une vidéo (bottes qui laissent des empreintes sur la route et s’estompent au fil de la marche) et… le texte ? Mais, où est le texte ? Il apparait doucement si l’internaute prend le temps de scroller et de scroller encore sur la page – ce qu’il ne manquera pas de faire, avide des effets qu’il soupçonne sur ce type de pages. Le texte ne se livre pas, lui, facilement. Les phrases glissent par segments pour se rejoindre et former un poème qui résiste à l’impatience du·e la lecteur·rice : les caractères sont flous, comme déposés par une encre boueuse. Le dispositif est simple et complexe à la fois. Il exige, comme d’autres, que le public prenne son temps non seulement pour en faire apparaitre une partie, mais aussi pour en prendre connaissance. Cette combinaison multimodale nous laisse, en tant que spectateur·rice·s, l’espace pour une analyse interprétative : je marche, disent-elles, « là où d’autres ont déjà foulé la terre avant moi » : si mes pas n’appartiennent qu’à moi (ce sont mes pas), le fait qu’ils laissent des empreintes relève d’une réalité universelle. Quand les étudiantes prennent, en scénarisant cette page, d’une part, le contrepied de l’instantanéité que promeuvent ces technologies, et d’autre part, évoquent un détail banal de leur vie qui se déploie lentement en évocations métaphysiques, on peut se dire qu’elles se sont faites créatrices, mais ont aussi acquis différentes compétences en création numérique. En effet, l’interaction conceptualisée par les deux étudiantes est de nature implicite, car « aucun indice textuel, visuel ou sonore n’est offert et chaque geste ou action doit être inféré à partir d’une analyse de la scène et du contexte » (Acerra, 2021, 22 avril). Ces différents exemples illustrent de la part des étudiant·e·s une acquisition d’une compétence centrale de la LMM : leur volonté, lors de la conception, de jouer avec l’expérience des internautes, les invitant à devenir de véritables « spectacteurs » (Dumouchel, 1991) en s’impliquant activement dans la navigation et la découverte des contenus proposés.
4.2. Le Web « extime » : quelques éléments pointant un renforcement de la posture de créateur·rice
Voici deux pages web que nous allons analyser pour mettre en lumière ce que nous avons pu observer en général dans les productions des étudiant·e·s : une posture de créateur·rice qui émerge et s’affirme.
4.2.1. La page des balançoires
Cette page web, proposée par Qësendra, met en lumière comment la posture de créatrice se révèle à travers le soin du détail. Fragile, cette attention peut passer inaperçue. L’intention de l’étudiant·e peut se décliner en plusieurs interrogations chez le·a regardeur·se : est-ce qu’elle se fait plaisir dans la délicatesse d’un ruban adhésif presque invisible au coin de l’une des photos, mais pas des autres ? Ou bien laisse-t-elle à l’internaute le plaisir de le remarquer et de s’interroger sur sa présence ? Une chose est sûre : elle s’affirme comme créatrice en ne se contentant pas de positionner ses photos selon les indications de l’enseignante-experte, mais en y ajoutant des éléments, ce qui trahit subtilement son engagement esthétique. Sur cette page web, l’étudiante semble jouer. On y voit des balançoires. Mais, elles sont vides, quoiqu’encore mouvantes – dimension fantastique qui évoque un passé qu’on porte en soi, mais qui ne reviendra plus. On peut supposer qu’elle filme avec les moyens du bord tout en visant l’unité dont on lui a enseigné les mérites en cours. Une telle page ne se fait pas par simple souci d’avoir une page, elle force à une certaine scénographie, à la suggestion d’un sens qui émerge au fil du temps. Le texte qui accompagne les photos et vidéos met au défi le·a regardeur·se de comprendre ce qui apparait comme des commentaires ou des explications. « Un jour/elle a des petits-enfants […]. » Iel se plait à deviner que ce « elle » renvoie à « ma grand-maman ». Mais, tout n’est pas donné, on n’a affaire qu’à une suite d’évocations succinctes.
On comprend aussitôt que la narration qui se cache sous l’évidence de ces légendes appelle à davantage de réflexion. Le rôle des grands-parents, leur part dans la joie des enfants à faire de la balançoire, ce n’est pas rien. Le·a regardeur·se ne peut commencer à comprendre la profondeur de l’intérêt de cette page qu’en mobilisant ses propres souvenirs. Ici, la créatrice de la page ne nous invite pas à seulement raconter sa vie, sinon elle serait plus explicite, plus directement narrative. Ses choix formels invitent à l’interprétation : ce que je suis, ce qui me fait, c’est ce qui nous unit. Quand je parle de moi, je parle de vous. Et, quand vous l’aurez saisi·e, vous aurez saisi l’importance pour moi de ces souvenirs-là, aussi futiles puissent-ils paraitre.
Dans cette page, ce n’est pas tant des grands-parents dont je parle que de l’enfant que je fus et que je ne suis plus. Et, on ne parle pas de l’effet du noir et blanc, de ce que l’accumulation de photos sur un même objet peut vouloir dire de l’obsession d’un souvenir, voire de son vertige (cf. le mal de mer que la vidéo de fond provoque). Le choix des balançoires, leur va-et-vient hypnotique créé délibérément par un effet de caméra subjective, éveille les mouvements de fascination comme de répulsion que nous pouvons entretenir avec le passé. La richesse de sens de cette page ne s’épuise donc pas facilement. Les audios (pas d’un enfant qui court sur le gravier, bruit de chaine de balançoire, chants d’oiseaux dans un parc, etc.) composent par fragments la substance de ce souvenir banal, mais tenace de l’enfance. La créatrice en explore la profondeur et en découvre la saveur; il pousse les internautes à faire de même.
4.2.2. D’une éclosion ironique
Alexandra met en lumière dans cette page web ses réflexions sur les décisions urbanistiques contradictoires de sa ville par rapport au réchauffement climatique. S’agit-il vraiment d’extime ? N’est-ce pas plutôt un reportage photo sur la dernière fierté de la ville, le musée cantonal des beaux-arts ? On pourrait le croire en regardant cette page dont l’arrière-plan est une photo en gros plan du mur où le public en sortant colle les étiquettes adhésives qui lui ont servi de billets d’accès aux collections. On admire le contraste entre les couleurs fluo de la première et les nuances de gris des secondes, entre les courbes de l’une et les lignes de l’autre.
Mais, qu’est-ce qui s’extime ici ? Là aussi, il faut s’attarder pour se rendre compte qu’on n’est pas sur un catalogue numérique, mais sur l’exposition d’un point de vue ironique sur les ravages de la bétonisation citadine. Le reportage porte sur la rencontre toute personnelle d’un sujet avec les hautes températures estivales d’un lieu qui devait être un lieu de médiation des plus accueillants entre la culture et le peuple des villes grâce à la beauté d’une architecture soucieuse des défis écologiques d’un monde en surchauffe. Là est la force du non-dit que la multimodalité permet. Aux regardeur·se·s de prendre le temps de faire leur exploration des lieux (de la page et de ses quelques liens) pour reconstruire le propos suggéré auquel il a affaire.
La première chose qui nous indique qu’il y a une signature derrière cette scène, c’est la présence de l’humour : on déchiffre l’unique phrase qui s’affiche en fragments qui en compliquent la lecture. « Ilôt pour les vulnérables merguez » ! Voilà une créatrice qui s’amuse à nous raconter ce qui la sidère et révèle un certain engagement issu de ses convictions les plus profondes. Le travail multimodal permet cette ironie, et l’autrice l’investit pleinement. Au cas où nous en douterions, elle a prévu un titre, en haut, à droite, qu’on remarque à cause de sa couleur blanche qui l’invisibilise au milieu de la palette colorée des billets d’entrée : « Éclosion ironique ». Ah, c’est donc pour ça qu’une photo est à l’envers ? Et ces merguez, ce sont les visiteur·se·s réduits sur le gril brulant de la cour du musée. On clique sur la flèche ou sur la merguez, qui signale son hypertextualité par un franc soulignement. La première est la lecture d’un texte qui rend compte et commente un article du quotidien suisse Le Temps : la végétalisation promise par la ville n’a pas eu lieu et les visiteur·se·s en sont pour leurs frais (ou plutôt leur chaud). Notons que le ton de la créatrice, qui chuchote un texte aux pauses bien marquées et bien choisies, force notre attention tout comme notre patience. La scénarisation se nourrit des possibilités de l’outil numérique et sans doute du temps qu’il faut pour placer tel ou tel élément, ce qui rend propice la recherche, la construction, l’essai et, partant, l’adoption d’une posture de créatrice qui ne se conquiert pas en un instant.
Mais, là n’est pas le dernier de cet extime souriant… L’humour est plus noir, plus sérieux que prévu (mais aussi plus poétique). On déplace son curseur sur la page, on clique sur n’importe laquelle des photos et une page secrète s’ouvre. En incitant les visiteur·se·s à chercher activement ce lien hypertexte caché, Alexandra semble souhaiter que ses aspirations à la végétalisation des espaces urbains ne soient accessibles qu’à ceux·lles qui s’investissent pleinement dans la découverte. En outre, l’étudiante mobilise des compétences en LMM, car elle exploite « les manipulations possibles » (Lacelle et al., 2017, p. 123) par les lecteur·rice·s, et joue avec eux·lles pour mieux les impliquer en les incitant à scruter la page afin d’y déceler cet hyperlien. Dans la nouvelle page web intitulée « éclosion végétale » qui s’ouvre, Alexandra nous propose une version végétalisée du musée bétonné. Il est désormais niché dans les sous-bois, et on peut y lire la phrase « Quand est-ce que nos angoisses prennent des vacances ? », qui dénote le désir de l’étudiante d’interpeller le·a regardeur·se sur l’écoanxiété omniprésente dans notre société.
4.3. De la scénographie de fragments sensoriels à la construction d’une posture de créatrice
Nous avons choisi de mettre en lumière les pages de ces deux étudiantes, car elles illustrent de manière significative ce qui a été observé durant le module. Les étudiant·e·s élaborent des scénarios, prennent des décisions et développent une intention au fur et à mesure de la construction de leurs sites. Ainsi, même s’iels érigent leurs productions à partir du même matériau web, chacun·e emprunte un chemin unique en enregistrant dans leurs quotidiens divers fragments sensoriels auxquels iels vont associer leurs mots, ainsi que divers éléments empruntés sur le Web. Nous retrouvons ici l’essence d’une démarche artistique, qui se révèle lorsque le·a créateur·rice entre dans « la mise en scène, et s’invente de minuscules histoires intimes, en partie réelle, en partie imaginaire […] » (Baldner et Vigouroux, p. 30). La quasi-totalité des étudiant·e·s ont fait preuve, durant ces trois dernières années, d’un investissement personnel bien au-delà des attentes du module. Alors qu’il leur était demandé de créer seulement dix pages web, dont deux personnelles, la plupart en ont produit près du double. D’autres énoncent dans leurs retours réflexifs combien iels se sentent aujourd’hui créatif·ve·s alors qu’iels ne pensaient pas pouvoir l’être. Certain·e·s, comme Pacôme et ses deux acolytes (image ci-dessous), vont même jusqu’à assumer le fait de se présenter comme artiste. En haut des différentes pages respectives, chaque membre du groupe a apposé leurs prénoms à côté du mot « Artiste ». Pourtant, cette affirmation semble superflue de la part des étudiant·e·s, car iels ont déjà indiqué leur espace respectif dans le menu. Dès lors, cette mise en avant, pour ces étudiant·e·s n’ayant jamais eu de formations artistiques, de ce statut dans leur site démontre une volonté affirmée d’être reconnu·e·s en tant que créateur·rice du contenu présenté.

Comme le schéma présenté par Gosselin et al. (2014), qui illustre les différentes manières dont un·e étudiant·e peut utiliser les consignes dans sa démarche, la grande majorité des étudiant·e·s se situent dans des propositions en forme d’« expansion », si ce n’est d’« écho ». Les réalisations dénotent un engagement personnel important avec des préoccupations plastiques et thématiques qui leur sont propres.
Cependant, éprouver ces enjeux de la création suffit-il à adopter une posture de créateur·rice ? Il faut assurément encore pouvoir se relire, à l’instar des spectateur·rice·s à qui ces fragments de soi étaient adressés. Les retours réflexifs permettent cet achèvement : comme le souligne une étudiante, le site l’autorise à « regarder en arrière sur [sa] croissance créative ». Un autre participant exprime : « on se disait juste pas trop mauvais en orthographe, mais toujours maladroit avec [notre] smartphone lors des prises de vue, on se découvre avec des œuvres, doté d’un “bagage artistique” et une plus grande confiance en soi ». Dans les retours réflexifs, on trouve de nobles mots de différents étudiant·e·s pour parler de ce qui a été réalisé : mon site n’est pas un « lèche-vitrine », « il s’agit d’une démonstration pudique de notre intimité », il est un « refuge artistique et communautaire », il invite à une « proximité authentique » avec ses visiteur·se·s, « nous avons dû nous mettre à nu », etc. Autant d’indices qui révèlent combien ils se sentent transformé·e·s, fort·e·s de nouvelles compétences, celles que cette expérience de création leur a fait acquérir. Il serait pertinent, pour approfondir cette recherche, d’examiner comment ces différentes compétences acquises à l’issue du module sont réinvesties dans leurs pratiques professionnelles.
Néanmoins, ces divers retours et le visionnement des sites témoignent de ce fameux retournement plébiscité par Tremblay (2013) et amène à penser qu’un module interdisciplinaire passant par « l’extime » permet aux étudiant·e·s de s’engager dans une démarche de création où se mêlent imagination, audace et authenticité.
Conclusion
Ainsi en est-il de l’extimité à l’ère numérique comme outil pour travailler la littératie médiatique multimodale et la création artistique. On veut parler de soi, on a une idée, on place un bout de texte, une photo – mais on ne veut pas juste afficher des souvenirs, on veut leur donner un sens, et on veut les adresser aux autres, qu’iels nous ressemblent ou pas, pour qu’iels nous reconnaissent et s’y reconnaissent. À chaque fois, selon des intensités diverses, iels n’ont plus lâché leur site, passant bien plus de temps qu’attendu. La complexité, la subtilité, l’envie qu’on se prend à vouloir commenter et interpréter leur travail en sont la preuve.
Nos « exercices » de création, amorces d’écriture et principes à suivre pour des créations plastiques avaient pour fonction de faciliter la mise au travail. Ils ont mis les étudiant·e·s en mouvement. Sans doute le dispositif les a-t-il amené·e·s à explorer facilement l’une des spécificités de l’extime contemporain : le recours au fragment, qui suggère plus qu’il dénote et s’articule avec aisance à l’hypertextualité – un mot (ou une image) peut amener vers ce qui relève d’un autre mode d’expression, et c’est de cette relation que nait un sens toujours ouvert. En résulte l’envie d’exploration des sens possibles. Une fois embarqué·e·s, les étudiant·e·s s’y consacrent pleinement et invitent leur public potentiel à y consacrer du temps, et à appréhender ce qu’iels leur présentent.
Alors qu’on pensait le monde numérique comme celui de l’instantanéité, les étudiant·e·s obligent les internautes au contraire à une expérience, celle de la patience et du travail de déchiffrement. Là se joue la rencontre entre un·e créateur·rice qui scénarise et un public qui accepte de s’engager. L’extime se révèle dès lors, entre jeux de dévoilement et de rétention, dans ces sites loin d’un étalage obscène pour une rapide consommation.
Des protocoles artistiques, des techniques, des créateur·rice·s, des internautes, des pages, des parcours de lecture, des heures et des jours… La liste n’est pas close de cet atelier en forme d’amalgame. Mais ici, c’est de leur amalgame, un amalgame gagnant, que naissent des créateur·rice·s possibles.
ANNEXE 1
Organisation des huit ateliers de 2 h 15 du module au cours du semestre de printemps
- Présentation de la notion « extime » à l’ère numérique (AVI et français), atelier d’écriture
La première rencontre se veut interdisciplinaire, et présente ainsi une variété d’artistes travaillant autour de l’extimité ou intégrant le Web dans leur processus créatif et qui seront mobilisé·e·s plusieurs fois durant le module. Parmi eux·lles : Sophie Calle, Nan Goldin, Nicolas Baudouin, Erik Beck, Philippe de Jonckeere, Maryse Gagné, ainsi que plusieurs artistes du Net Art, dont ceux présentés sur le site spamm.fr. On y trouve également le travail de la théoricienne Servanne Monjour, axé sur la « Gittérature », ainsi que le collectif d’artistes Lili range le chat, Sophie Lambert et Irvin Anneix.
L’événement est suivi d’un premier atelier, centré sur la littérature, qui se déroule en plusieurs phases; il se veut tout de suite impliquant, quoique ludique; il doit permettre aux participant·e·s de mieux se connaitre et de commencer à travailler ensemble (on pense aux binômes futurs). On propose à chacun·e de rédiger un manifeste sur le modèle de ce qui se fait dans les réunions slam. Il s’agit de compléter une série de phrases qui commencent par « je suis », « je veux », « si j’étais…, je serais », etc. : des amorces qui incitent à un autoportrait qui doit se faire rapidement, sans trop réfléchir, sans aucune exigence de vérité. Ainsi la première phrase, celle qui commence par « Je suis », doit être complétée par un alias symbolique, mais il n’est pas question de chercher longtemps ce qui correspond le mieux à sa personnalité : on se saisit de la première idée venue, quitte à prendre ce qui s’offre à nos yeux à ce moment-là, tel : « Je suis le cordon électrique qui pend du plafond ». Après une dizaine de minutes, chacun·e lit son texte à tour de rôle. Puis, par groupes, iels reprennent leurs productions écrites, dont iels sélectionnent quelques extraits pour constituer un seul manifeste par groupe de huit phrases. Enfin, iels s’égaillent dans le bâtiment pour en faire, smartphone en main, un petit film qu’iels monteront avec un logiciel de présentation de type Ppt : une prise de vue par phrase, huit diapositives successives. On visionne le tout immédiatement.
Un deuxième atelier est lancé, il est à réaliser individuellement pour la rencontre suivante. Il s’agit de rédiger en quelques lignes ce qu’on n’avouera à personne, de rendre le texte quasiment illisible en le masquant d’une façon ou d’une autre (usage du ruban correcteur, taches d’encre, brûlures du support, objets posés sur les mots, effets photographiques divers, etc.) et d’en faire une image. Seule la première phrase reste franchement lisible : elle captera la curiosité des lecteur·rice·s. Les étudiant·e·s font alors très simplement, sans subir aucun discours théorique, l’expérience de cette tension, qu’il s’agit de leur faire éprouver, entre intime et extime d’une part, et celle de la responsabilité interprétative laissée aux lecteur·rice·s.
- Exploration multimodale d’un lieu usité quotidiennement
Après une présentation théorique et des exercices sur les concepts de série en art, de post-photographie et de GIF animé, les étudiant·e·s sont réparti·e·s en groupes et invité·e·s à se rendre dans un lieu de la HEP Vaud pour en réaliser un inventaire sensible. Chaque groupe doit visiter le lieu en silence avant de partager leur ressenti. Par la suite, iels décident de plusieurs contraintes pour créer diverses séries, qu’elles soient visuelles (images fixes et animées), sonores ou littéraires. Iels devront également concevoir une courte performance vidéo liée au lieu exploré.
Dans un deuxième temps, les étudiant·e·s sélectionneront les différents éléments capturés pour scénographier la première page d’un site web. Pour ce faire, iels utiliseront des outils tels que la plateforme Wix, le logiciel Imgplay, les fonctions vidéo, photo, et dictaphone de leur smartphone.
Enfin, dans la semaine qui suit, il leur sera demandé d’explorer un autre lieu significatif de leur quotidien en combinant les différentes modalités abordées au préalable.
- Mise en page sur la plateforme en ligne, pratiques de remix et approche sonore
Utilisation de la plateforme WIX, présentation des différentes possibilités de combinaison à travers le travail d’artistes (Philippe de Jonckeere) et d’exemples de la formatrice. Mise en avant de la possibilité de faire du remix entre éléments (images, texte et objets interactifs) proposés par la plateforme gratuitement ou glanés sur le Web et de leurs propres données. Iels sont invité·e·s à pratiquer une esthétique du collage en mettant en commun, sur la plateforme de partage du concepteur de site, les différentes données récoltées par chaque membre du groupe. Peu à peu, une collection d’images, de sons, de notes textuelles se forme et les étudiant·e·s du même groupe peuvent y piocher pour scénariser certaines pages communes. Dans une même perspective, travailler sur une plate-forme dédiée à la création de sites web a permis d’explorer les éléments mis à disposition des utilisateur·rice·s, qui sont souvent conçus à des fins commerciales ou de communication, et non pour des finalités artistiques. Il leur était donc proposé de réfléchir à la manière de s’approprier ces éléments visuels afin de les détourner et de leur donner un autre sens dans leur démarche artistique. Chaque année, un artiste sonore, Jean-Bruno Meier en 2022 et Peter Wehkamp en 2023, sont intervenus pour des ateliers d’environ 1 h 30. Bien que ces interventions aient été trop courtes pour approfondir les aspects sonores avec les étudiant·e·s, elles leur permettaient néanmoins de prendre en compte cette dimension dans la création de leur site personnel en enregistrant diverses données sonores de leur environnement et d’en faire un montage en loop par la suite. Utilisation du logiciel Loopy, GarageBand, de PowerPoint et de Imovie.
- Atelier d’écriture
Cet atelier vise à engager les étudiant·e·s dans une écriture de plus grande ampleur pour leur permettre de découvrir, d’une part, une technique d’écriture qui les incite à les rendre plus percutant·e par la vertu de l’ellipse, d’autre part, la force de l’extrait (tiré de leur texte). Enfin, il s’agit de leur faire travailler la mise en voix afin qu’iels puissent affronter leurs éventuelles réticences à l’enregistrer et les surmonter avec brio. Sur le modèle de l’excipit du roman Fusil, d’Odile Cornuz (D’en bas, 2022), les étudiant·e·s écrivent librement un texte dans lequel iels racontent (au « je ») comment iels imaginent se débarrasser d’un objet ou d’une pensée qui les encombrent depuis longtemps sans avoir eu le courage de le faire. Temps de rédaction : 30 minutes. Ceux·lles qui veulent lire leur production à haute voix le font, d’autres les jugent trop personnelles. Les étudiant·e·s reprennent leur texte, les recopient en y ajoutant de nombreux retours à la ligne. À eux de couper leurs phrases où bon leur semble, mais on les encourage à tenter diverses solutions, à ne pas forcément respecter l’unité des syntagmes, à s’emparer des possibilités qu’offre cette pratique sauvage de la ponctuation blanche. Iels sont invité·e·s ensuite à biffer une ligne sur deux de ce qui a pris l’apparence d’un poème en vers libres. Quelques modifications sont autorisées pour éventuellement redonner du sens à ces textes tronqués parfois au point de ne plus rien évoquer d’appréhendable. On lit à haute voix le résultat. Chacun·e est invité·e à isoler un très court extrait de son texte, l’équivalent libre d’une phrase, et à l’apprendre par cœur. On se met en cercle, on dit sa phrase à tour de rôle. On réitère l’exercice pour l’entrainer et améliorer les performances. À nouveau, les étudiant·e·s expérimentent le jeu de ce qui se dit sans se dire grâce à la fragmentation et à l’allusion plus ou moins hermétique. On demande aux étudiant·es de réaliser hors cours trois versions audio différentes, avec des tons et des intentions différents.
Un dossier est distribué avec diverses propositions d’écriture brèves à réaliser hors des heures de cours – à chacun·e de s’emparer de celles qui leur parlent. Iels auront l’occasion de choisir entre écritures à contraintes, schémas heuristiques, zooms sur des bribes de souvenirs d’enfance, séries d’observations rédigées en une seule phrase, inventaires plus ou moins commentés des lieux les plus banals, notations de phrases entendues dans divers lieux publics et à la radio, légendes rajoutées aux éléments de titres de transport ou de billets de spectacles, haïkus suggérés par les titres de livres empilés sur une table, etc.
- Atelier d’écriture
Lors de cette séance, on commence par suivre une proposition d’écriture inspirée (mais revisitée) par une idée de l’écrivain Eugène (Dans un livre, j’ai lu que… Autrement, 2011). Celle-ci consiste à se rendre à la bibliothèque pour y saisir un ouvrage le plus éloigné possible de ses centres d’intérêt, de le feuilleter rapidement, d’en retenir un extrait d’une ou deux phrases, de le recopier en le faisant précéder de « Dans un livre j’ai lu que… » et de le faire suivre d’un bref commentaire rendant compte de leur impression à la lecture de ces phrases du hasard.
Le second atelier est inspiré par un texte de Georges Perec, « Quelques-unes des choses qu’il faudrait tout de même que je fasse avant de mourir » (Je suis né, Seuil, 1990). On donne à lire le texte original, en en faisant remarquer la construction, les astuces, l’humour, le sérieux et la poésie. Iels dressent leur liste commentée, façon Perec.
- Pratique participative utilisant les technologies mobiles
Certaines démarches de collectifs, ou utilisant des technologies mobiles, intègrent la participation des internautes via des plateformes web. Ces derniers partagent avec les artistes diverses données (photographies, vidéos, textes…) qui alimentent la création de l’œuvre. Dans cette même perspective, l’atelier invite les étudiant·e·s à utiliser, comme matériaux de création, la communication et la propriété « ·reliante· » (Desjardins, 2017) offertes par ces dispositifs numériques. L’objectif principal est de travailler la relation elle-même comme forme esthétique.
L’atelier commence par une présentation de ce qu’est un protocole artistique, ainsi que de différentes démarches participatives à l’ère numérique, telles que celles de Sophie Lambert, Lili range le chat, Gillain Wearing et Irvin Anneix. Ensuite, l’ensemble du groupe élabore un protocole de création artistique demandant la participation de tiers dans le processus de création. Ce protocole doit permettre de récolter des données sonores, visuelles et littéraires (cette dernière modalité se base sur les exercices réalisés lors des ateliers d’écriture). Ces matériaux sont ensuite partagés sur une plateforme Drive. Dans un second temps, chaque étudiant·e peut puiser dans les productions déposées par les autres et scénarise une page web.
Après cette phase de création individuelle, les étudiant·e·s sont invité·e·s à créer, par groupe, un nouveau protocole artistique, qu’iels transmettent à un autre groupe. Ce dernier a alors le choix d’accepter ou de refuser de suivre ce protocole dans le cadre de la semaine suivante. Les données ainsi collectées servent à scénariser une page web, selon les choix et les interprétations de chaque groupe.
- Atelier d’écriture
Dans cet atelier, il s’agit d’inviter les étudiant·e·s à explorer les possibilités offertes par l’écriture de dialogues, qu’elles soient romanesques ou théâtrales. On évite les complications formelles et les souvenirs scolaires inhibants. Pour cela, on propose aux étudiant·e·s de travailler par deux et d’adopter le style lapidaire et à la mise en forme minimaliste dont l’écrivain américain Cormac MacCarthy fait usage dans son roman La Route (L’Olivier, 2008) – on leur en fait lire quelques extraits. On leur demande de choisir un thème relatif à celui de leur site à ce moment-là déjà en construction.
Toujours dans le souci de favoriser ce qui nourrira les sites, on invite les étudiant·e·s à rédiger un texte faisant le portrait de leur partenaire par une succession de phrases issues d’observations ou d’anecdotes le·a concernant, sur le modèle d’un poème de Charles Pennequin, tiré d’1 jour (Derrière la salle de bain, 2003). Chaque proposition commence par « Un jour » et est suivie de la mention d’un élément relatif à la vie de leur camarade de site. Elles sont toutes au présent. Il s’agit, là comme ailleurs, de disposer d’une réserve de texte dans laquelle puiser, ne serait-ce qu’un passage lors d’une page de leur site. Dans l’esprit de notre module, le moment de création véritable se fait à ce moment-là.
- Film d’animation et mise en page sur la plateforme en ligne
Les étudiant·e·s ont créé plusieurs petits films d’animation en papier découpé, en binômes. Dans un premier temps, chaque participant·e des groupes a choisi une photographie d’un détail de son corps, mettant en avant une particularité, qui servait de fond pour leur animation. Dans une deuxième phase, iels ont conçu plusieurs films d’animation en résonance avec les textes travaillés lors des ateliers d’écriture. Ces films devaient ensuite être intégrés à leur site web, en veillant à les harmoniser avec l’univers graphique et conceptuel du projet. Pour ce faire, iels ont utilisé le logiciel Stop Motion.
- Certain·e·s étudiant·e·s dit·e·s « généralistes » de la HEP Vaud accèdent à la formation pédagogique directement après l’école secondaire post-obligatoire. Iels se forment en didactique dans plusieurs disciplines, dont les arts visuels et le français, en vue de devenir des enseignant·e·s généralistes auprès d’élèves âgé·e·s de 4 à 12 ans. Pour bon nombre d’entre eux·lles, la dernière expérience significative en arts visuels remonte à la fin de la scolarité obligatoire, soit vers l’âge de quinze ans. ↩︎
- Entendu dans sa définition étymologique comme « mélange (d’éléments hétérogènes) » (Cnrtl). ↩︎
- Voir Annexe 1 pour la description plus détaillée des huit séminaires. ↩︎
- Manovich (2010) décrit le principe de variabilité dans les nouveaux médias comme la capacité de tout personnaliser, et transformer au cours du processus de création. Cette caractéristique se manifeste également dans l’interaction des spectateur·rice·s avec les objets des nouveaux médias (tels que les sites web et les livres numériques), où chaque navigation à travers les hyperliens crée une expérience personnelle. ↩︎
- Selon Paquin (2006), l’interaction fonctionnelle permet au spectateur de se dégager de « l’ordre stricte des contenus que prévoit l’auteur d’un scénario » (p. 201). Cette forme d’interaction devient proactive lorsqu’elle fait apparaitre un mode de réception non linéaire aux contenus « […] qui permet [à l’interacteur·rice] de les parcourir et de les assembler à sa façon » (p. 204). ↩︎
- La Bolex est une petite caméra 16 mm construite en Suisse de 1935 à 1975 destinée à l’origine aux amateur·rice·s. Mais, très vite, elle est plébiscitée par les professionnel·le·s et artistes pour sa simplicité d’utilisation et sa légèreté. ↩︎
Acerra, E. (2021, 22 avril). Interactivité. Lab-yrinthe. https://lab-yrinthe.ca/education/interactive
Acerra, E. et Lacelle, N. (2022). Compétences en #LMM. Lab-yrinthe. https://lab-yrinthe.ca/education/competences-lmm
Allard, L. (2014). Express yourself 3.0 ! Le mobile comme media de la voix intérieure. Entre double agir communicationnel et continuum disjonctif soma-technologique. Dans L. Allard, L. Creton, R. Odin (dir.), Téléphone Mobile et Création. Armand Colin.
Baldner, J.-M. et Vigouroux, Y. (2005). Les pratiques pauvres : du sténopé au téléphone mobile. Isthme Éditions.
Barthes, R. (1975). Roland Barthes par Roland Barthes. Seuil.
Cauquelin, A. (2003). L’exposition de soi. Du journal intime aux webcams. Éditions Eshel.
Chevillard, E. (n.d.). L’Autofictif. http://autofictif.blogspot.com [consulté le 2 décembre 2024].
Denzin, N. K. (2017). The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods. Routledge.
Desjardins, M.-L. (2017). De l’art mobile au Mobile art : ou comment la technologie mobile influence la nature des œuvres [Thèse inédite, Université Paris 1].
Doubrovsky, S. (1977). Fils. Galilée.
Dumouchel, R. (1991). Le Spectacteur et le contactile. Cinémas, 1(3), 38-60.
Gervereau, L. (2020). Voir, comprendre, analyser les images. La découverte.
Giacco, G. et Didier, J. (2017). Pourquoi une didactique de la création artistique ? Contexte et émergence. Dans G. Giacco, J. Didier et F. Spampinato (dir.), Didactique de la création artistique : approches et perspectives de recherche (pp. 7-15). EME.
Gosselin, P. (2013). Vivre son enseignement comme un travail de création/Interviewer : D. Charest. Vision, 76. AQESAP.
Gosselin, P., Murphy, S., St-Denis, E., Fortin, S., Trudelle, S. et Gagnon-Bourget, F. (2014). Référentiel pour le développement et l’évaluation de la compétence à créer en arts visuels au collège et à l’université. http://www.competenceacreer.uqam.ca
Hinzelin, C. (2005). La pratique du journal photographique comme questionnement des codes artistiques. Marges, 4,https://doi.org/10.4000/marges.728
Houdart-Merot, V. et Petitjean, A. (2015). La littérature faite par tous ? Dans V. Merot et A. Petitjean (éds.), Numérique et écriture littéraire : mutations des pratiques (pp. 5-12). Hermann.
Külling, C., Waller, G., Suter, L., Willemse, I., Bernath, J., Skirgaila, P., Streule, P. et Süss, D. (2022). JAMES – Jeunes, activités, médias – enquête Suisse. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Lacelle, N. et Lebrun, M. (2014). La littératie médiatique multimodale : réflexions sémiologiques et dispositifs concrets d’application. Forumlecture.ch, 2, 1-17.
Lacelle, N., Boutin, J. F. et Lebrun, M. (2017). La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique-LMM@ : outils conceptuels et didactiques. PUQ.
Lejeune, P. (2010). L’autobiographie en France. Armand Colin.
Lincoln, Y. S. (1995). Emerging Criteria for Quality in Qualitative and Interpretive Research. Qualitative Inquiry, 1, 275-289.
Harvey, S. et Loiselle, J. (2009). Proposition d’un modèle de recherche développement. Recherches qualitatives, 28(2), 95–117. https://doi.org/10.7202/1085274ar
Manovich, L. (2010). Le langage des nouveaux médias. Les Presses du réel.
Messager, M. (2019). Roland Barthes. Presses universitaires de France.
Michaud, Y. (2011). Critères esthétiques et jugement de goût. Fayard.
Paquin, L.-C. (2006). Comprendre les médias interactifs. Isabelle Quentin éditeur.
Paveau, M. A. (2015). Extimité. Dictionnaire de l’analyse du discours numérique.
Perec, G. (2011). Je me souviens. Fayard.
Périssé, C. (2024). De la posture de l’amateur à l’ère numérique : utilisations didactiques des nouveaux médias en arts visuels dans une démarche de création [Thèse inédite, Université de Strasbourg].
Petitjean, A. (2015). Quand l’atelier d’écriture devient numérique : des pratiques en secteur universitaire aux questions qu’elles génèrent. Dans V. Merot et A. Petitjean (éds.), Numérique et écriture littéraire : mutations des pratiques (pp. 13-28). Hermann.
Petitjean, A. (2018). La conversion numérique du littéraire dans les formations universitaires : témoignages croisés. Le Français aujourd’hui, 200(1), 127-142. https://doi.org/10.3917/lfa.200.0127
PISA (2018). Les élèves de Suisse en comparaison internationale. Consortium PISA.
Roux, C. (1999). L’enseignement de l’art : la formation d’une discipline. Éditions Jacqueline Chambon.
Sabolo, M. (2013). Tout cela n’a rien avoir avec moi. Éditions Jean-Claude Lattès.
Tisseron, S. (2002). L’Intimité surexposée. Flammarion.
Tisseron, S. (2011). Intimité et extimité. Communications, (88), 83-91. https://doi.org/10.3917/commu.088.0083.
Tournier, M. (2002). Journal extime. Gallimard (Folio).
Tremblay, J. (2013). L’art qui relie, un modèle de pratique artistique avec la communauté : Principes et actes [Thèse de doctorat, Université du Québec à Montréal]. http://www.archipel.uqam.ca/5713/
Veinstein, A. (2013). Cent quarante signes. Grasset.
Woolf, V. (1977). Une chambre à soi. Denoël.
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net