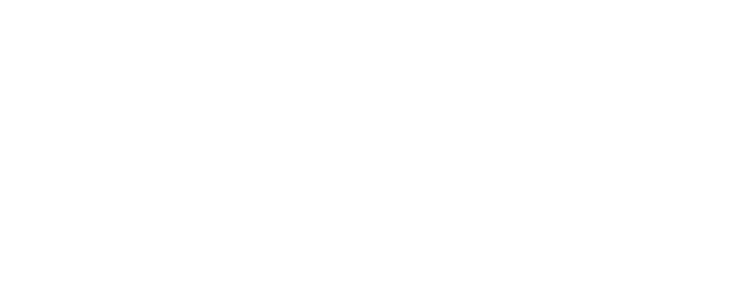Vers une littératie multimodale climatique : sens émergents du croisement de données d’expérience entre vivants et appareils
Comment contribuer à la grande problématique des changements climatiques par la recherche-création ? L’actuelle étude propose une réflexion et une action multimodales. De nouveaux sens climatiques proviennent ici de données d’expérience issues du relai entre cinq activités interdisciplinaires croisant sciences forestières, arts technologiques et savoirs citoyens. Les données d’expérience viennent d’arbres, de sols, de forêts, de la météo, ainsi que de personnes humaines, saisies par divers appareils et techniques de captation. Ces données associées sont traitées avec un logiciel d’analyse qualitative. Ce processus est jumelé à un protocole de questionnements déployé en « 5 comment », afin d’activer les données croisées avec des apports philosophique et textuel. Il en émerge les dimensions de multiples sens, créant une expression collective, dont le mouvement tend vers une puissance d’agir autrement, offrant une alternative à l’angoisse, au déni, au sentiment d’impuissance et de culpabilité qui règne devant le pessimisme, l’ampleur abstraite et la méconnaissance des climats qui changent. Ces opérations dynamiques sont un amalgame poreux – sylvestre, scientifique, technique, artistique, citoyenne, textuelle et philosophique. Les sens qu’elles font surgir sont discutés avec l’appui du concept du transindividuel (Simondon, [1964] 2005) et celui de « plus que qualitatif » (T Paris, en développement depuis 2021). Au travers de ces mouvements agissants en recherche-création, se développe et s’active une littératie multimodale climatique.
How to contribute to climate change issues with research-creation? Initiated through the meeting between forest sciences, technological arts, and citizen knowledges, the current study proposes multimodalities of climatic senses and orientations which emerge in open amalgams of experiential data, by bridging the relays between five interdisciplinary activities dedicated to reflection and action. Experiential data from trees, soil, forests and weather sensors and from interviews with humans are studied using qualitative analysis software and through a questioning related to the protocol of the “5 hows”. This collective expression in motion cultivates agencies along with philosophical and qualitative analysis, and creative writing. The approach brings about patterns by crossing multiple senses and orientations, offering an alternative to anxiety, denial, and feelings of powerlessness and guilt often associated with pessimism, the abstract scale, and unfamiliarity with changing climates. This dynamic framework of operations is a porous amalgam—sylvan, scientific, technical, artistic, citizen-driven, textual, and philosophical. Emergent senses and orientations are discussed with the concepts of transindividual (Simondon, [1964] 2005) and the “more-than-qualitative” (T Paris, in development since 2021). In movement with research-creation, a multimodal climate literacy is activated.
Impulsion introductive
Selon le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC, 2023), les cibles pour limiter le réchauffement à 1,5 – 2,0 degrés Celsius, établies par l’Accord de Paris en 2015, n’ont pas encore été atteintes. Les scientifiques et les médias rappellent l’urgence d’agir. Comment contribuer dès maintenant à cette problématique par la recherche-création, initiée dans le croisement entre arbres, sciences forestières, arts technologiques et savoirs citoyens ? Quels sens peuvent émerger de la relation produite par un croisement de données d’expérience entre vivants et appareils ?
Les activités, les agentivités et les expériences vécues – appuyées par l’expression de ce texte issu d’un processus d’écriture collaboratif – soutiennent l’élaboration de savoirs multimodaux dans une force d’agir entre arbres, arts, sciences, publics et machines. Il s’agit de faire autrement pour contrer les sentiments d’impuissance et de culpabilité ainsi que le déni des humain·e·s devant le déluge de pessimisme, l’ampleur abstraite du problème des changements climatiques et sa méconnaissance qui minent les actions (Stoknes et Randers, 2015; Jaspal et Nerlich, 2022).
La littératie médiatique multimodale devient ici « climatique », enjeu conçu dans cette étude par notre duo auteures+, formulation servant à nous nommer parmi les forces à l’œuvre et signalant qu’une subjectivité est multiple, par l’addition du symbole « + ». La diversité de données d’expérience croisées dont il s’agit dans cette étude est ainsi véhiculée en tant qu’amalgame poreux. Par celles-ci, il s’agit d’étendre l’usage courant des sens organiques du paradigme de la littératie médiatique multimodale (LMM) (Russbach, 2016), à un ensemble de vécus situant et conjuguant des expériences sensibles du vivant humain et plus qu’humain, appuyé par le concept philosophique du « transindividuel » de Gilbert Simondon ([1964] 2005). Le concept de « plus que qualitatif », que développe Chantal T Paris dans son projet doctoral depuis 2021, est aussi mis à contribution. Ce concept intègre les modalités du senti, du ressenti, du perçu et du conçu, au sein d’un res senti qui le caractérise. L’étymologie de res, signifiant réalité, est ici soutenu par un processus relationnel créatif faisant « sens » de la situation climatique, qui requiert l’action humaine de manière urgente, située et variée. Des dimensions de res senti émergent au fil du texte, sondées, exprimées et créées, offrant une expression collective en mouvement tendue vers une puissance d’agir autrement.
Terrains, captations et activités à l’étude
Cette étude entrelace cinq différentes activités qui se déroulent en parallèle, entre 2019 et 2022. Elle prend d’abord appui sur des recherches liées aux effets des changements de climat sur la forêt, procurant des données issues des arbres étudiés par le groupe scientifique SMARTFORESTS CANADA (smarforests.uqam.ca). Ces données quantitatives sont répertoriées par différents appareils depuis 2020, soit par une variété de capteurs et leurs logiciels de traitement. Ces données deviennent ensuite le terreau d’expérimentation en recherche-création dans deux installations artistiques présentées dans l’espace public, en 2021 et 2022, réalisées par MÉDIANE, la Chaire de recherche du Canada en arts, écotechnologies de pratique et changements climatiques (mediane.uqam.ca). De ces œuvres, des données qualitatives sont, par la suite, récoltées à partir des expériences qu’en font les publics, sous forme d’entretiens semi-dirigés. Ces expériences exprimées et recueillies verbalement sont combinées à celles provenant de publics ainsi que d’universitaires (artistes et scientifiques) lors de deux tables rondes thématiques de LASER (Leonardo ArtScience Evening RendezVous), organisées par MÉDIANE en 2019 et 2020, et portant aussi sur les changements climatiques. La série internationale LASER est chapeautée depuis 2014 à Montréal par Hexagram, le réseau de recherche-création en arts, cultures et technologies (hexagram.ca). Déjà, l’amalgame étudié s’ouvre par la relation de ces cinq activités qui partagent un même intérêt.
Les captations, les écoutes actives, les enregistrements et leurs transcriptions, qui sont les modes de cueillette des vécus liés aux cinq d’activités, sont ici appelés « données d’expérience ». Lesexpressions humaines, en relation ténue à celles des arbres et des œuvres, sont amenées dans le logiciel d’analyse qualitative NVivo, pour jauger le potentiel de contribution à un mouvement de sens et de savoirs croisés, humains et plus qu’humains, à la fois créatifs et pédagogiques, à la manière de Boutin (2019) qui affirme la nécessité de réfléchir en éducation avec le paradigme posthumaniste. De ce bassin hétérogène de données ressortent les motifs d’une littératie multimodale climatique qui s’élaborent entre vivants, arts, sciences, action citoyenne, machines et processus.
Notre duo-auteures+ a choisi le terme « données d’expérience » pour récuser le paradigme constructiviste et le distinguer de celui, surutilisé et souvent galvaudé, de cocréation. Nous voulons mettre de l’avant le processus et ses mouvements, suivre le potentiel de changement qui peut s’opérer à partir de données expérientielles spécifiques associées. Ce qui nous amène aussi à concevoir l’amalgame en termes de croisement, dans une traversée transformative et non dualiste. Cette perspective sera éclairée plus loin par le concept de « transindividuel » (Simondon, [1964] 2005).
Le protocole des « 5 comment »
La présente étude est menée selon l’approche des 5 Whys, reformulée en « 5 comment ». Notre duo-auteures+ opère ainsi un détournement créatif du modèle industriel d’analyse de causes à un problème, développé par Toyoda (c.1930). La détermination habituelle des raisons qui sous-tendent la problématique des changements climatiques repose souvent sur une motivation du pourquoi. Fait connu, plusieurs effets des changements climatiques sont de source anthropogénique (GIEC, 2023); par conséquent, la question du pourquoi n’offre pas de nouvelle manière d’y penser. En retravaillant ce modèle avec le protocole de questionnement du comment s’active une proposition de changement foncièrement relationnelle et émergente, propulsée par un processus itératif interrogeant les données d’expérience issues de SMARTFORESTS CANADA, des deux installations de MÉDIANE, et des LASER 7 et 9.
Le protocole des « 5 comment » permet de réfléchir avec les deux questions de recherche suivantes :
- En contexte d’urgence climatique, comment les données d’expérience – provenant des arbres, des scientifiques, des œuvres,des publics et des tables rondes – peuvent-elles activer ensemble une puissance en res senti « plus que qualitatif » avec les climats qui changent ?
- Comment ce croisement – opérant et émergent de la relation entre vivants et appareils – permet-il de réfléchir et d’agir autrement ?
L’étude aborde la recherche-création en tant qu’agrégateur de ce qui traverse les données d’expérienceet leurs sens, à la fois sentis, ressentis, perçus, conçus, proposant uneorientation aux données. Elles deviennent ici « plus que » des qualités individuellement vécues. Elles viennent mettre en question les binarités de tous genres et le travail en vase clos des approches disciplinaires. De cette façon, la recherche-création peut contribuer à augmenter la portée d’action de la LMM en l’amenant vers le climatique, une réalité englobante qui mérite d’être pensée autrement, avec de nouveaux outils épistémologiques.
Dans cet article, prises de mesures et de paroles associées à des ensembles technologiques et artistiques, au sein d’un processus de recherche-création variant et continu, sont irriguées par le cadre théorique du « transindividuel » (Simondon, [1964] 2005). Ce concept fait, par ailleurs, écho à la critique posthumaniste préconisée par la littératie médiatique multimodale (Boutin, 2019). Ce dernier ne saurait être plus clair dans l’affirmation mise de l’avant dans son article, « comment l’éducation […] peut-elle se permettre de toujours se passer du paradigme épistémologique, encore en genèse, du posthumanisme, du moins dans le monde francophone ? »
L’injonction de Boutin est tranchante par rapport aux systèmes d’éducation encore foncièrement humanistes de l’école francophone, même en virage technonumérique. Pour appuyer ce besoin de changement d’ordre épistémologique, la philosophie processuelle de Rosi Braidotti (2012, passim) lui vient en appui, afin de résolument ouvrir les modalités de l’enseignement aux enjeux particuliers du XXIe siècle. Féministe du courant nouveau matérialiste, Braidotti place l’humain·e en relation avec une multitude d’autres actant·e·s, non pas en domination, mais en interdépendance, au sein d’une relation transversale et coextensive du milieu technologique, toujours dans leur contemporanéité.
De plus, le « plus que qualitatif », concept créé et développé par T Paris dans son projet doctoral depuis 2021, ce res senti, vient positionner la littératie multimodale climatique dans le paradigme postqualitatif. Ce dernier désigne un champ de recherche aux postures hétérogènes, privilégie une parole incarnée et sensible, la polyvocalité, une agentivité distribuée, la non-représentationnalité et des processus exploratoires (Paquin, 2020).
Ici, les vécus en agirs croisés bougent, se meuvent autrement. Une autre expérience climatique met à l’épreuve le constat défaitiste et fataliste habituel, sans toutefois occulter l’urgence de penser et d’agir concrètement, à laquelle participe la littératie multimodale climatique développée, en s’appuyant sur la rencontre entre arts, sciences, vivants et appareils.
Notre duo-auteures+ se penche d’abord sur des précisions à propos des cinq terrains d’activité et des captations à l’étude. Ensuite, nous abordons comment les données d’expérience sont explicitées, en portant une première attention sur le rôle du logiciel d’analyse qualitative. Finalement, les données d’expérience sont emportées dans le protocole des « 5 comment », opération innovante qui se constitue par ce texte et prolonge le projet de recherche-création. Le rôle de l’entretien en sciences sociales est interrogé, la fréquence de répétition du mot « sens » survenue dans le logiciel d’analyse qualitative est discutée, le concept du transindividuel (Simondon) est activé, la contribution de deux dimensions émergentes de sens au concept de res senti « plus que qualitatif » est avancée.
1. De SMARTFORESTS CANADA – à MÉDIANE – à LASER
Dans ce premier segment sont exposés les relais entre les pratiques sylvestres, scientifiques et artistiques qui agissent en tant que tremplin initial pour constituer un premier ensemble de données d’expérience de la présente étude.
1.1. SMARTFORESTS CANADA
Le groupe scientifique SMARTFORESTS CANADA étudie les effets des changements climatiques sur l’eau, le sol et la forêt au pays. Ces mesures proviennent de capteurs placés sur les arbres, sans les blesser, dans les parcelles forestières de recherche de diverses provinces (Figure 1, Figure 2 et Figure 3). Elles sont ensuite analysées par région et également mises en réseau pour produire un portrait national qui se module sur de nombreuses années. Ces mesures procurent des informations sur le vécu des arbres, qui deviennent dans la présente étude des données d’expérience plus qu’humaines.

Les arbres et forêts étudiés par le sous-groupe scientifique montréalais sont situés dans deux sites à proximité de Tiohtià:ke/Mooniyang/Montréal : le premier est une ancienne érablière à Sainte-Émélie-de-l’Énergie et le deuxième est la Station de biologie des Laurentides (SBL), lieu d’étude et d’expérimentation de pratiques forestières fondé en 1965 par l’Université de Montréal.



Les données saisies mesurent, entre autres, flux de la sève, croissance du tronc, humidité au sol, température, pluie, pression barométrique, potentiel hydrique, etc., et produisent des relevés de chiffres insérés dans des tableurs (Figure 4). Ces relevés répertorient et synchronisent les changements journaliers des données de l’arbre et de son entourage, sur une base horaire.
Les mesures des capteurs expriment ainsi les variations du « vécu sylvestre », qui seraient autrement inaccessibles aux personnes humaines. Les données sont répertoriées annuellement, du printemps à l’automne, en fonction de la dormance qu’entraine la saison hivernale dans la géographie et le climat nord-américains.
Selon notre duo-auteures+, une première dimension de la littératie multimodale climatique en cours de déploiement est ici effective. En effet, les procédés de captation permettent de mieux connaitre les modalités de travail des scientifiques avec les différents appareils et méthodes d’analyse, en lien avec les biorégions et les changements climatiques.
1.2. MÉDIANE
Les données chiffrées et photographiques issues des appareils scientifiques sont par la suite explorées dans les installations artistiques de MÉDIANE, à raison d’une par année, de 2021 à 2024. Les installations sont présentées dehors, dans l’espace public, afin d’ouvrir un dialogue entre scientifiques, artistes et publics à propos du phénomène des changements climatiques. MÉDIANE agence les données d’expérience des arbres et de la météo dans des expressions artistiques avec couleurs, lignes et points en mouvement. Ni vulgarisation scientifique ni médiation culturelle, les installations artistiques annuelles (Figure 6 et Figure 9) expriment les thèmes choisis en collaboration avec les scientifiques. À titre d’exemple, les deux premières œuvres de MÉDIANE, réalisées en 2021 et 2022 et discutées ici, traitent notamment de l’écophysiologie (étude des comportements physiologiques de l’organisme au milieu) et de la phénologie (étude des phases saisonnières).
Ce qui est habituellement présenté dans le milieu scientifique, dans des publications ou colloques, par des données quantitatives sous forme de graphiques bidimensionnels, acquiert alors une nouvelle spatiotemporalité et une qualité matérielle grâce aux machines audiovisuelles, aux structures d’échafaudages ainsi qu’au logiciel TouchDesigner (Figure 5 et Figure 10) – ce dernier permettant d’intégrer les données des divers capteurs et de les exprimer par l’image en mouvement, pratique inusitée en sciences forestières.


Les données de captation scientifique, relevées en microns, en degrés Celsius, en kilo pascal, en chronophotographies (Figure 7 et Figure 8) deviennent ainsi des visualisations artistiques, dont le processus est guidé par la relation entre disciplines. Les modulations internes et externes constituent les segments de vécu captés sur les diverses essences d’arbres étudiées : le sapin baumier, le peuplier faux-tremble, l’érable à sucre, le bouleau jaune. Ces visualisations sont diffusées sur des écrans DELS suspendus à des structures d’échafaudages modulaires à aires ouvertes, s’agençant ainsi aux rythmes ambiants du lieu d’intégration et de ses éléments — soleil, nuages, vent, pluie, chaleur, ombre, bâtis, sentiers, animaux humains et autres qu’humains, entre autres. Une correspondance s’établit de ce fait entre les arbres, les scientifiques, les artistes et les appareils utilisés, participant à une littératie médiatique multimodale augmentée, en l’occurrence climatique. Ce rapprochement interdisciplinaire est traversé par les mouvements entre vivants.




Outre la visualisation, trois autres modalités sont à l’œuvre dans les installations artistiques : le son, la météo et la mobilité. Elles viennent enrichir les données d’expérience de la recherche-création et des publics. Cette approche des installations est elle-même multisensorielle et multimodale, puisqu’elle s’ouvre à tous les sens, augmentée par l’in situ.
Les explorations sonores incluent la captation de sons concrets (field recordings) et la composition musicale par synthèse modulaire. La diffusion sonore immersive se fait via des haut-parleurs et un système audio tactile avec transducteurs, ce dernier générant une expérience corporelle vibratoire. L’ensemble se compose avec les sons de la ville, camions, ventilateurs, sirènes, bruissement des feuilles, machines, chants d’oiseaux, vents, entre autres, dans l’aire ouverte.
La météo locale associée aux deux premières installations artistiques est enregistrée par un kit électronique artisanal (Figure 11), dont les capteurs collectent des données relatives à la quantité de pluie, au taux d’humidité de l’air, au degré de température, au taux d’humidité au sol et à la pression barométrique — données qui s’accumulent et agissent dans le déroulement des œuvres (Figure 12). Le principe est de générer un rapprochement entre les instants météo captés sur les terrains scientifiques dans le passé, et ceux captés dans les installations in situ. La météo contribue au climat, tout en étant distincte de lui. La météo, localisée, est un aspect des changements climatiques qui, eux, résultent d’une combinaison d’une grande série de facteurs, notamment anthropogéniques, étendus dans l’espace et le temps, liés notamment à l’agriculture intensive, aux modes de transport et de consommation basés sur les énergies fossiles, au forage, à l’extraction minière et à la déforestation.


En ce qui a trait à la mobilité, la Station climatique mobile, conçue en 2022, est une microversion des installations artistiques annuelles de la chaire, pouvant être déplacée en divers lieux et périodes de l’année sur une remorque à vélo accompagnée d’une équipe de cyclistes (Figure 13 et Figure 14). Grâce à sa petite taille, elle permet d’aller plus directement à la rencontre de personnes dans divers quartiers, comme complément de l’installation annuelle.


Une autre dimension de la littératie multimodale climatique s’exprime par la cueillette des expériences des publics. Pour la présente étude, les entretiens semi-dirigés de 87 personnes ont été récoltés de juillet 2021 à octobre 2022 (Figure 14, Figure 15 et Figure 16). De fait, il s’agit de s’entretenir avec une personne ou deux à la fois, sur une base volontaire et de façon anonyme. Ce choix de l’anonymat importe, et il est lié à la certification éthique obtenue par le programme de recherche-création. Les entretiens contiennent sept questions préétablies permettant de recueillir des opinions, points de vue et signifiances à propos des arbres, de la production et de la présentation de l’installation artistique, des technologies à l’œuvre et des possibles actions et activités créatives pouvant en découler.
Selon le vocabulaire de la LMM, ces impressions peuvent ressembler à « l’expérience de la réception », telle que discutée par Bloch (2017), dont le travail a cherché à mettre en correspondance des œuvres de champs différents, souvent conçues comme étant opaques l’une à l’autre. Dans son cas, il s’agit d’œuvres en musique et en peinture mises en relation par le champ linguistique, afin de produire une nouvelle perception les réunissant. Dans la présente étude, les données d’expérience croisées – entre arbres, expérimentations scientifiques, œuvres, publics – créent un relai participatif itératif, s’échelonnant sur plusieurs années. Qui plus est, les perceptions de l’installation artistique de l’année suivante, véhiculées par les entretiens, ont le potentiel d’inspirer la conception des œuvres subséquentes, sans nécessairement adhérer à une relation de cause à effet directe entre réponses reçues et modalités de création.
Pour notre duo-auteures+, la contribution à une littératie multimodale climatique opère au travers d’une mutualisation entre individus et collectivités, pour éviter de porter une attention isolée sur une personne et son expérience, à l’instar du climat et de l’existence qui sont viscéralement relationnels. L’accent est donc ici porté sur le partage de sens découlant de la rencontre entre vivants et appareils.


Ainsi, dans ce texte, individu sera dorénavant écrit avec la première syllabe en italique, une inflexion servant à rehausser son caractère divisible et son potentiel de changement, en filiation avec le concept du transindividuel du philosophe des sciences Gilbert Simondon, discuté au point 3.3.
1.3. LASER (Leonardo ArtScience Evening RendezVous)
La série LASER a été initiée par Piero Scarufi à San Francisco, en 2008. D’abord actif exclusivement aux États-Unis, ce programme fait se rencontrer, depuis ses débuts, des actant·e·s des arts et des sciences à l’international, en conversation informelle avec les publics (https://leonardo.info/laser-talks). À ce jour, plus de cinquante lieux, universités et espaces culturels, sur quatre continents, accueillent ces rendez-vous dialogiques. Deux des éditions LASER menées à Hexagram – LASER 7 Changements différentiels de climats en 2019 et LASER 9 Forests Drawing Close en 2020 – traitant des changements climatiques, sont retenues pour la présente étude, car celles-ci sont également chapeautées par MÉDIANE. Depuis 2014, la commissaire indépendante Nina Czegledy et l’artiste-chercheure Gisèle Trudel sont les coresponsables des LASER à Hexagram (https://hexagram.ca/fr/categorie/activites/laser/).
Dans le LASER 7, il est question des nouveaux défis qu’apporte l’urgence climatique, à la fois localement et globalement, à partir de cette question : comment est-il possible de penser et de créer avec la montée du niveau des mers, les variations de température et la sècheresse des forêts ? Alexandre Castonguay (artiste et professeur), Liz Miller (activiste et professeure) et Daniel Kneeshaw (scientifique en écologie forestière), en compagnie des publics, discutent de leurs initiatives, respectivement liées à des modes d’activisme tranquille par l’action artistique environnementale; à un documentaire interactif interdisciplinaire impliquant des personnes étudiantes et réalisatrices à travers le globe; à un programme de recherche suivant l’impact des stress environnementaux sur les forêts canadiennes, qui diffèrent au sud et au nord.

Dans le LASER 9, les personnes conviées se penchent sur leurs recherches artistiques, anthropologiques, architecturales et scientifiques à propos d’écosystèmes forestiers, afin de contribuer à une discussion portant sur la biodiversité et la créativité. Les thèmes abordés sont les suivants : le respect et la mémoire des forêts anciennes, par la visualisation en vidéo haute définition et les technologies stéréoscopiques (professeure et artiste Leila Sujir, et étudiant Jorge Zavagno); l’imagerie microscopique 3D, montrant le réseau interne de la sève des arbres en période de sècheresse (chercheur postdoctoral Jehová Lourenço Jr), ainsi que la résurgence du bois dans les récentes tendances architecturales en Finlande, avec une exploration de l’habitat qualitatif pouvant susciter l’éveil des sens (anthropologue et professeur David Howes). Entre corps et technologies, Forests Drawing Close se veut une rencontre intimiste, réunissant le proche et le lointain d’un réseau de relations avec les arbres.
Les discussions de ces deux LASER – aussi expressions d’une relation aux arbres et aux changements de climat – sont enregistrées, avec l’autorisation des artistes, scientifiques et publics participants, puis transcrites.

2. Des données d’expérience
Les différentes données d’expérience collectées – chiffres et paroles – par les divers outils de captation et techniques d’écoute et de transcription de ces cinq activités sont maintenant situées et discutées par notre duo-auteures+. Le mot « expérience » réfère au fait d’éprouver quelque chose : cela peut être une pratique ou bien une routine, un essai, un savoir acquis ou une expérimentation (Dictionnaire Larousse). Dans cette étude, les données d’expérience constituent les segments de divers types de vécus captés, ceux des arbres et des personnes participantes aux activités. Leur instance est nécessairement de l’ordre du fragment, car elle ne réitère pas les vécus des individus arbres et humain·e·s comme unité à part entière — leur ampleur, dans ce contexte à tout le moins, demeurant insaisissable.
Toutefois, saisir les données de sens effectivement vécus et les resituer dans une collectivité élargie et diversifiée, associant humain·e·s, arbres, appareils – dans la rencontre et leur alliance –, permet de faire apparaitre de nouveaux rapports de vitalité. Ce parti pris créatif constitue une contribution concrète, l’un des apports à la littératie multimodale climatique, en plus d’associer des champs qui souvent sont clivés, de les faire travailler ensemble pour différemment penser l’agir en contexte de climat changeant.
2.1. Les vécus exprimés en chiffres
Les données d’expérience des arbres et de leur milieu de vie, relevées par les scientifiques de SMARTFORESTS CANADA œuvrant avec MÉDIANE, permettent d’analyser de manière quantitative une série de relations enchevêtrées. Les mesures participent à montrer les changements dans le temps. L’un des buts des scientifiques est de faire des projections ou des modélisations, afin d’identifier quelles essences d’arbres pourront mieux (sur)vivre aux changements climatiques en cours et à venir.
Ces données issues de capteurs montrent que l’arbre se module continuellement durant la journée. Les données quantitatives en rangée montrent l’interdépendance du jour, de l’heure, de la température, de la vitesse du flux de la sève ainsi que du gonflement et rétrécissement de la circonférence du tronc pendant l’évapotranspiration quotidienne de l’arbre (Figure 19).

2.2. Les vécus exprimés en paroles
La recherche qualitative donne priorité à l’expérience vécue des personnes interviewées en tant que principe opératoire de recherche. Un entretien permet d’accorder de l’importance aux expériences qu’ont divers individus à propos de sujets, problèmes et situations spécifiques. Les entretiens semi-dirigés font partie de la recherche qualitative en sciences sociales depuis de nombreuses décennies (Lazarsfeld, 1925, cité dans Bailey, 2014). Cette modalité figure de plus en plus en recherche-création, d’abord par le croisement de champs de recherche en art avec ceux des sciences sociales et progressivement avec les sciences dites naturelles.
Les entretiens conduits dans les installations artistiques de MÉDIANE permettent de recueillir les paroles de diverses personnes quant à leurs vécus des œuvres, qui, elles, sont liées à l’arbre. Il en va de même pour les discussions enregistrées et transcrites des LASER.
Il importe de rappeler que les paroles offertes dans les entretiens de MÉDIANE l’ont été avec consentement, sous l’égide d’une possible contribution créative liée au projet, puis anonymisées, avec l’obtention préalable d’une certification d’éthique. Les participant·e·s des deux LASER ont également consenti·e·s à la diffusion et à l’usage du contenu des enregistrements.
2.3. Le logiciel d’analyse qualitative
Le logiciel d’analyse qualitative NVivo permet de faire converger et d’organiser une masse qualitative hétérogène, et son outil de recherche de fréquence de mots, de déceler des tendances dans les réponses exprimées par et entre individus.
Notre duo-auteures+ a inséré dans ce logiciel le contenu des entretiens menés avec les publics dans les contextes de MÉDIANE. Nous les avons reliés aux enregistrements sonores des deux LASER, faisant entendre les paroles des scientifiques, artistes et publics exprimant différentes relations à propos des changements climatiques. Véhiculant divers domaines de verbalisation quant au contexte climatique, ces jumelages et croisements de données créent un climat de vécus différentiels associés, soutenant des alliances entre champs de recherche et d’expériences. Notre intention est ici de procéder à une collectivisation des différents types de paroles pour jauger une forme de solidarité entre données d’expérience.
Ce logiciel est couramment employé dans les méthodologies qualitatives qui accueillent l’incursion de la subjectivité de la personne analyste dans le tissu de sa recherche, et qui valorisent le savoir formel et aussi intuitif qui peut émerger au cours du processus. Cet apport subjectif permet de jeter d’autres éclairages sur les données objectives, dans la mesure où il y a transparence à cet égard dans la méthode de collecte et dans la reconnaissance des biais potentiels des personnes qui effectuent la recherche. Une fonctionnalité existe d’ailleurs dans ce logiciel pour noter les idées et impressions qui surgissent dans les flots de la recherche, et de les rattacher aux morceaux de textes ou d’images qui peuvent y être importés. Ce procédé se nomme « coder en émergence ». Celui-ci réfère aux motifs qui apparaissent au fil de l’analyse des données, patrons d’idées et de comportements qui amènent à les catégoriser, pour pouvoir construire du sens et éventuellement aboutir à des prescriptions, voire à une théorie.
Pour notre duo-auteures+, ce procédé de codage, bien que productif par sa mise en saillie des données, constitue toutefois une limite d’action, oblitérant leur mouvement en basant et arrêtant leur analyse sur un temps déjà passé, celui de leur saisie initiale, alors que l’expérience de perception et de conception, elle, continue d’avancer. Étant relationnelle, associée à plus qu’un individu, l’expérience continue de bouger et elle est toujours en potentiel de changement. C’est pourquoi il ne saurait ici s’agir de tirer des conclusions définitives, mais plutôt de prendre le pouls d’orientations pour soutenir un continuum d’action, en œuvrant « avec » le mouvement des données, à travers les opérations d’un protocole, d’une philosophie et d’un concept processuels.
3. Activation des données d’expérience selon le protocole des « 5 comment »
Dans cette troisième partie, les opérations de relation continuent entre données d’expérience, avec un schéma spécifiquement créé par notre duo-auteures+. Ce processus prend appui sur un détournement, celui du modèle conçu par l’industrialiste Sakichi Toyoda, appelé les « 5 pourquoi » (c.1930), servant initialement à déterminer la relation itérative entre causes et effets sous-jacents à des problèmes particuliers, dans le but de trouver des solutions.
La présente étude infléchit ce modèle productiviste par un procédé de corrélation créative, mettant en question dans la foulée les systèmes industriels producteurs de gaz à effet de serre, générateurs de déforestation et extractivistes comme les mines, entre autres, reconnus comme étant parmi les causes des changements climatiques (GIEC, 2023). Le pourquoi se voit ici transformé par l’opération du comment.
Ci-dessous, notre formulation du protocole des 5 comment, activant les données de cette étude (Figure 20).

Le protocole des 5 comment, en survol :
- Comment les données d’expérience sont-elles choisies ?
- Comment caractériser les deux expressions de sens qui en émergent ?
- Comment le concept du transindividuel permet-il d’ouvrir de nouvelles dimensions de sens ?
- Comment ces dimensions de sens contribuent-elles au concept du res senti « plus que qualitatif » ?
- Comment circule une nouvelle puissance d’agir ?
3.1. Premier comment
En recherche qualitative, « [l]’objectif est de saisir les sens d’un phénomène complexe tel qu’il est vécu et perçu par les participant·e·s et la personne chercheur·e dans une dynamique de co-construction du sens »(Poupart cité dans Imbert, 2010). Au regard du protocole des 5 comment retenu, il est convenu d’induire une orientation de recherche sur les expressions de sens, dans les paroles partagées par les publics, les scientifiques et les artistes lors des LASER et des entretiens semi-dirigés de MÉDIANE.
Pour ce faire, une recherche de mots par fréquence est effectuée avec le logiciel d’analyse qualitative NVivo (Figure 21), avec une investigation orientée sur les déclinaisons du mot sens, afin de sonder la prégnance de cette dimension sensible dans la diversité des expériences.

3.2. Second comment
Le logiciel d’analyse qualitative permet de coder des « arbres » conceptuels pour chaque concept ou thème qui apparaît pertinent, selon ce qui émerge de la recherche. Des « arbres » ont ainsi été créés pour quatorze types de sens, chaque itération étant accompagnée de son champ lexical, ce qui accentue sa tonalité et la situe dans l’expérience.
Les déclinaisons de sens apparaissant dans les LASER sont « ressentir, feeling, perception, sens, sensations, senses et sensing ». Pour les entretiens semi-dirigés de MÉDIANE, il s’agit de « perception, ressentir, sens, sensoriel, sensible, sensation et sensibilisation ». Sont retenues pour la présente étude sept expressions de sens, dont les récurrences sont les plus marquées, soit « perception, ressentir, sens, sensation, senses, sensing ».
Ces qualités en relation d’affinité proposent une orientation de sens. Cette opération met en saillie une dynamique ayant cours au sein même des entretiens conduits dans MÉDIANE et les deux tables rondes LASER, autrement inaperçue : les expressions de sens sont foisonnantes dans les premiers, moins exhaustives dans les secondes, bien que présentes. La sensibilité et la sensorialité s’y expriment autrement, de façon davantage étalée dans le temps, se déployant dans la traversée des paroles exprimées, et s’étoffant avec d’autres termes, au regard du parcours de l’ensemble du matériel sémantique effectué.
Quoi qu’il en soit de cette différence, les mots de sens répétés de part et d’autre créent une résonance, en eux et entre eux, par le milieu de leur rencontre.
Rappelons que ces sens n’appartiennent à aucun individu en propre. Ils sont liés par un ensemble de forces et de tensions qui les font émerger : les données orientent, dessinent et relancent les avenues de l’étude.
Les arbres de sens constitués dans le logiciel d’analyse de discours, à partir des données d’expérience des cinq activités, créent cette dynamique de vécus liés aux arbres et à leur climat dans une dimension sensible inouïe.
De ce deuxième comment commence à poindre un croisement poreux de sens émergents de ces données d’expérience, contribuant à une littératie médiatique multimodale climatique, qui ouvre une autre relation au climat.
3.3. Troisième comment
Le concept de « transindividuel » provient de la philosophie de l’individuation de Gilbert Simondon ([1964] 2005). Pour ce philosophe des sciences, aucun individu n’existe en soi – inspiration par laquelle individu est ainsi distinctement écrit dans ce texte – aucun noyau n’est indivisible. Il s’agit plutôt de processus d’individuation, donc en changement continu, et non pas essence ou substance, qui elles, viendraient déterminer une personne en amont de son existence.
L’approche de Simondon permet de réfléchir à la progression de l’individuation qui émerge dans et entre, ce qu’il nomme les trois « régimes », physique, biologique et psychosocial, dans et par lesquels des opérations de relation participent à constituer des réalités en mouvement. Les régimes sont ainsi moteurs de transformations. Dans le régime physique, matière et énergie se créent par l’action de forces « qu’il s’agisse de l’onde et du corpuscule, de l’électron, du photon ou même du cristal » (Duhem, 2008). L’astrophysicien Hubert Reeves (1994), avec son expression, « nous sommes tous des poussières d’étoiles », affirme que la planète bleue est enchevêtrement minéral, végétal et animal. Dans cette perspective, sans le réduire à un rôle servile, rappelons que l’arbre, en produisant de l’oxygène, permet aux animaux humains et autres de respirer. Il y a aussi l’animal qui, en produisant du dioxyde de carbone, permet à l’arbre de croitre (e360, 2022); l’arbre l’extrait de l’atmosphère et, par le fait même, en le consommant, il crée la réserve de carbone dans les sols. Cet échange soutient le relai sensible entre bronches et branches, une activité fertile jusqu’à un certain point de bascule où les processus s’inversent, pouvant entrainer la mort, et par conséquent menacer d’autres vivants. Facteur majeur contribuant aux bouleversements climatiques à l’échelle mondiale, la déforestation humaine accélère les phénomènes de sècheresse et de relâchement du carbone qui se répercutent dans le grand cycle d’échanges entre forêt, atmosphère et océan.
Dans le cas des mammifères, dont l’animal humain, la psyché et le collectif opèrent de nouvelles relations qui étendent les deux autres régimes, physique et biologique. Sans être une séquence, cet autre régime se conjugue avec ce qui est extérieur à sa corporalité, venant des deux autres régimes, ce qui entraine d’emblée l’individu dans des transformations continues. Autrement dit, chaque régime se conforme de façon interdépendante par leur rencontre, par les changements véhiculés à même chaque régime et aussi les uns sur les autres.
C’est ainsi qu’il est possible d’affirmer que l’intériorité d’un individu n’existe pas de façon autonome, bien que celui-ci soit une configuration particulière et ponctuelle. Car, les opérations, de ce qui peut être habituellement nommée la subjectivité ou l’individualité de la personne, sont intimement liées à ce qui se produit hors d’elle, de façon poreuse. Avec Simondon, l’individuation fait envisager autrement qu’en silo les concepts de subjectivité et d’objectivité souvent attachés au psychosocial, selon lesquels l’individu serait constitué séparément de la collectivité – et des autres qu’humain·e·s –, et vice versa.
En intégrant le relationnel qui opère en continu, le transindividuel va plus loin que la pensée de la littératie multimodale qui emploie la notion fondamentale d’interactivité. Russbach (2016) souligne que « [l]es individus interagissent avec divers modes et médias, souvent simultanément et rarement de manière isolée. De même, les modes et les médias eux-mêmes interagissent entre eux ». Toutefois, cette pensée considère les individus comme étant déjà constitués pour ensuite être en interaction. La pensée de Simondon amène à réfléchir à la relation continuelle de l’existence qui la transforme.
Les trois régimes de l’individuation pensés par ce philosophe des sciences permettent d’entrevoir un rapport autre que catastrophiste et fataliste aux changements climatiques trop souvent médiatisés sous le signe de la peur, de l’urgence ou du déni, et dans des visées de durabilité et d’équilibre stable. Activant cette philosophie, la présente étude met de l’avant un amalgame relationnel qui opère entre les régimes, générant une propagation nouvelle, ici par la rencontre entre données d’expérience issues de vécus divers, ceux des arbres et des humain·e·s. Ils s’expriment par les chiffres et les paroles, que font émerger les capteurs et les logiciels partenaires, et prolifèrent par les concepts et la textualité à l’œuvre, faisant jaillir une « plus qu’unité » subtile en situations climatiques.
La littératie multimodale climatique se conjugue aussi par ces sens provenant du croisement des données d’expériences réunies, alliant appareils et vivants, tendus vers une nouvelle forme d’action.
3.4. Quatrième comment
Dans l’approche de la recherche qualitative habituelle, les mots, les phrases, reflètent les expériences vécues telles que recensées, considérées comme entières, absolues, immuables en quelque sorte, qui sont ensuite analysées selon un mode instaurant un système de catégorisation. Les vécus se trouvent ainsi malgré eux figés dans le temps de leur expression, cadrés et limités par leur étude. Ce dispositif néglige la possibilité que les vécus continuent d’être en mouvement à la suite de leur saisie. De cette méthode habituelle advient, par ailleurs, un diagnostic, des patrons d’idées et de comportements liés à ces vécus-là, à ces moments-là, sur lequel repose ensuite le développement d’une théorie qui souvent advient beaucoup plus tard dans le temps et devient une règle déterminante.
À l’instar de Simondon, la présente étude met de l’avant que le transindividuel abonde et diffère perpétuellement par l’opération de la relation. Par celle à l’œuvre entre chiffres et paroles – ces données d’expérience issues des régimes physique, biologique et psychosocial –, par cet amalgame perméable, un res senti « plus que qualitatif » se crée entre arbres, publics, scientifiques et artistes, avec l’apport des appareils et du processus de rédaction de ce texte. Cette traversée opératoire continue d’amplifierla littératie multimodale climatique, qui est plus que les sens organiques de la vue, de l’ouïe, du toucher, de l’odorat, du goût, attribués habituellement aux animaux, incluant ceux humains. Les données ne réfèrent plus à des mots, des phrases ou à des personnes spécifiques, mais à ce qui se produit par le partage et le relai des sens qui traversent le milieu de leur rencontre.
3.4.1. Deux dimensions émergentes
Les mots ou expressions suivants proviennent des verbatim des entretiens semi-dirigés menés par MÉDIANE et dans les deux tables rondes LASER. De cette approche nait une nouvelle collectivisation de sens. Le res senti « plus que qualitatif » commence maintenant à se profiler : il se manifeste ici dans une « épaisseur » – quantité de qualités variables associées à un même mot – et une « étendue » – le même mot participant à la composition de plusieurs vécus.
3.4.1.1. Une épaisseur : quantité de qualités variables d’un même mot

Les mots ou expressions se suivent ici selon les dates de leur cueillette et se relancent librement, avec l’espacement créé et le mouvement de lecture différentiel qu’il engendre. Ils restent ainsi distincts tout en étant inscrits dans un flux continu. Cette configuration permet la création de nouveaux agencements potentiels, entre eux et elles (Figure 22). Une mise en tableau ou un formatage en liste traditionnelle ne ferait que renforcer une hiérarchisation des qualités, qui irait à l’inverse de la présente approche en recherche-création.
3.4.1.2. Une étendue : la composition de plusieurs vécus avec un même mot
| Occurrences | Vécus |
| 32 | Sens (senses) |
| 23 | Ressentir |
| 12 | Perception |
| 8 | Sensation |
| 2 | Sensing |
Dans cette figure (Figure 23), la fréquence des mots est associée au nombre de personnes les ayant verbalisés, ce qui devient l’étendue des occurrences qui traverse les données d’expérience, de ce fait, ce tableau peut se lire de haut en bas ou inversement.
Le mot sens ressort du tiers des données issues des entretiens de MÉDIANE et des transcriptions des LASER. L’abondance de ce sens vécu fait surgir ce qui se produit au milieu même de la rencontre entre différences, ce qui émerge de la relation entre hétérogénéités. S’y déploie un mouvement sensible. L’ampleur des expressions qui le caractérise pointe vers une forme d’agir par mutualisation de sens.
3.5. Cinquième comment
Les mots ainsi tirés de leur continuum antérieur – contextes de vécus et de cueillettes des données d’expérience –, resitués dans un plus grand ensemble où ils agissent autrement, prennent d’autres et diverses orientations. La quantité de qualités associée au mot sens crée un amalgame perméable de données d’expériences, riches et variées, quant aux climats changeants, contribuant à cette littératie multimodale climatique, en ouvrant et donnant de nouveaux sens à l’action.
Les recherches de SMARTFORESTS CANADA traitent des variations des effets des changements climatiques sur les essences d’arbres étudiées, de façon ponctuelle et progressive. Des captations réparties sur trois ans sont répertoriées au moment de la rédaction de ce texte. Leur étude démontre que les arbres vivent des changements continus dans l’étendue quotidienne, en lien avec la météo et l’écosystème, ce dont témoignent les mesures prises par les instruments et les variations qu’elles expriment. Deux des installations présentées dans l’espace public de MÉDIANE contribuent au présent texte au moment de son écriture – les entretiens semi-dirigés menés lors des deux itérations ayant eu lieu en 2023 et 2024, n’ayant pas encore fait l’objet d’analyse qualitative.
La situation de partage de vécus ici expérimentée, opérant dans la rencontre entre recherche scientifique et recherche-création, donne une ampleur « plus que » à la relation entre arbres, instruments et humain·e·s, entre champs de savoirs et d’expériences.
Selon Simondon, l’individu est mouvement et collectivité. Les émotions vécues par les humain·e·s sont perceptions du collectif, au sein d’une relation qui est une opération de différenciation entre régimes physique, biologique et psychosocial – un mouvement signalant ce qui bouge entre les individus et en eux-mêmes, ce qui les fait bouger, transitionner, dans le temps, par le processus d’individuation. L’existence est ainsi une opération transindividuelle qui actualise le potentiel des forces en présence, avec et dans l’individu, en situation, simultanément avec le collectif. L’individu est ainsi conçu comme relatif, changeant, plus qu’un, plus qu’unité.
Sans évacuer le rôle et la responsabilité de l’humain·e, il ne saurait donc s’agir de réduire la complexité et l’ampleur des changements climatiques – bien qu’accentués par l’action anthropogénique – à de simples changements d’ordre cognitif ou comportemental : les influences et agirs humains et plus qu’humains sont mutuels et se profilent en de multiples dimensions, micro, méso et macroscopiques. Cette littératie multimodale climatiqueest ainsi elle-même appelée à se transformer, par les mouvements amplifiés d’un amalgame relationnel d’expériences entre appareils et vivants continués.
3.5.1. Le res senti « plus que qualitatif »
Les relais agissant dans cette étude créent un milieu de rencontres d’où émerge une teneur « plus que qualitative » relativement aux climats changeants.
Cette étude est un acte de recherche et de création qui poursuit les actions initiées en amont, dans les contextes de SMARTFORESTS CANADA, MÉDIANE et des LASER. Elle pratique une ouverture pour la recherche-création comme moyen et moyeu permettant à une puissance d’agirs de faire bouger l’alliance entre savoirs, expertises et sens, composant ensemble un changement de climat, toujours à l’œuvre.
Par ses processus situés et émergents, cette recherche-création – qui ne constitue pas une méthode – opère une rencontre multimodale entre pratiques, savoirs et sens. Le détournement du modèle des « 5 pourquoi » amené vers le protocole des « 5 comment » y contribue. L’approche des sens, développée sur mesure et par émergence, au cours de ce projet, forme un res senti – physique, affectif, émotif, intuitif, réflexif – pulsant dans les données, retentissant dans le milieu ici créé, orientant leurs expériences différemment.
Ainsi, plus qu’une construction de sens, c’est du sens même dont il est ici question, de ses divers régimes, modes et moments d’existence, de ses expressions, de sa traversée, de sa migration, de ses transitions, en phases d’émergence. Cette recherche-création agit ainsi sur un mode « plus que qualitatif » qui récuse le paradigme constructiviste.
Le mouvement qui se compose ainsi importe et transporte autrement : dans la recherche qualitative traditionnelle, la collecte et l’analyse des informations sont issues de données de terrain, en relation avec les vécus de personnes, accordant une primauté d’entièreté, exclusive et définitive à ces vécus qui, de ce fait, demeurent figés. D’un autre côté, la recherche postqualitative, dans son ultime conception, est, quant à elle, considérée comme n’ayant « aucune substance, aucune essence, aucune existence, aucune présence, aucune stabilité, aucune structure » (St. Pierre, 2018).
Ces deux modes omettent de situer les vécus dans la part implicite de leur expérience, dans le mouvement et dans le changement qui les animent potentiellement, ou de les faire advenir, tout court.
4. Pointe d’arrivée
Par les processus de l’actuelle recherche-création, s’opère une analyse critique des procédés habituels de la recherche qualitative en sciences sociales et ouvre la LMM vers le climatique. La critique portée par Boutin (2019) quant au besoin d’adoption de modalités d’enseignement posthumanistes en milieux technonumériques est renforcée par notre approche. En contexte de changements climatiques, les systèmes éducatifs sont appelés à s’engager avec l’entrelacement des savoirs entre disciplines, entre humain·e·s et plus-qu’humain·e·s. Il s’agit de s’ouvrir à leur agentivité, dans le respect et l’interdépendance entre vivants. Dans cet esprit, notre article a permis d’investiguer une diversité de vécus, eux-mêmes constitués d’une multitude d’expériences. En les associant, notre duo-auteures+ travaille avec la récurrence du mot sens, en gardant vives les différences.
Cette étude s’engage donc avec l’émergence, dans un climat de pensées et d’agirssoutenant le potentiel d’effectivité d’un changement, en amenant le qualitatif et le quantitatif dans une dimension créative, concrète, critique, plus que qualitative. Par son processus transindividuel, elleest pulsion pleinement activante.
Par cette perspective et dans cet ensemble, les données d’expérience s’agencent et agissent dans un mouvement qui s’étend et s’amplifie à partir du milieu de leur rencontre, donnant une autre consistance à l’expérience climatique par l’épaisseur et l’étendue explorée des vécus de sens.
Dans et par ces agirs-sentirs, ces avancées de proche en proche, de milieu en milieu, s’actualisent une puissance de relation, en mouvement et en changement. Les associations inattendues d’individus, de mesures, de paroles et d’avenues, de capteurs, de logiciels, de champs d’expertise, leur sens, sont parties prenantes de modulations créant un nouvel amalgame sensible.
L’action climatique et sa littératie passent ainsi, pour notre duo-auteures+, par une sensibilité accrue à la diversité des agentivités plus qu’humaines à l’œuvre dans un climat, opérant à travers un res senti « plus que qualitatif ».
Il importe enfin de noter que les savoirs, les processus, les idées, les concepts explorés ici ne sauraient se tenir dans l’absolu d’une pensée ni d’un écrit. L’enjeu est leur activation dans la vie courante. Dans la traversée des situations, il y a une mise en question, une vigilance, une éthique de réciprocité à constamment cultiver, en prise, en attention et en partage avec les tensions actives et surgissantes des climats qui changent.
(2022, 28 septembre). Carbon Dioxide and Climate Change Could Lead to Bigger Trees, Study Finds. Yale Environment 360. https://e360.yale.edu/digest/carbon-dioxide-climate-change-bigger-trees
Bailey, L. F. (2014). The Origin and Success of Qualitative Research. International Journal of Market Research, 56(2), 167-184. https://doi.org/10.2501/IJMR-2014-013
Boutin, J.-F. (2019). Posthumanisme, éducation et littératie multimodale et médiatique : une injonction. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 10. https://doi.org/10.7202/1065533ar
Bloch, B. (2017). Ténus liens tenus entre les arts. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 6.
Braidotti, R. (2012). Afterword: Complexity, Materialism, Difference. Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, 17(2). https://doi.org/10.1080/0969725X.2012.701056
Duhem, L. (2008, 16 septembre). L’idée d’« individu pur » dans la pensée de Simondon. Appareil. https://doi.org/10.4000/appareil.583
Imbert, G. (2010). L’entretien semi-directif : à la frontière de la santé publique et de l’anthropologie. Recherche en soins infirmiers, 102, 23-34. https://doi.org/10.3917/rsi.102.0023
IPCC. (2023). Summary for Policymakers. Dans Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland (pp. 1-34). doi: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001
Jaspal, R. et Nerlich, B. (2022, 18 février). Human Reactions to Climate Change: A Social Psychological Perspective. Climanosco Research Articles, 3. https://doi.org/10.37207/CRA.3.2
Paquin, L. (2020). Les paradigmes du POST. Autres écritures, 14-30. http://lcpaquin.com/Ecriture/paradigmes_du_POST.pdf
Reeves, H. (1994). Poussières d’étoiles. Seuil.
Russbach, L. (2016). Littératie, littératie médiatique multimodale et paradigme multimodal : approches de l’éducation pour le 21e siècle. Canadian Journal for New Scholars in Education, 7(2), 97.
St. Pierre, E. A. (2018). Writing Post Qualitative Inquiry. Qualitative Inquiry, 24(9), 603-608. https://doi.org/10.1177/1077800417734567
Simondon, G. (2005). L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information. Jérôme Millon.
Stoknes, P. E. et Randers, J. (2015). What We Think about when We Try Not to Think about Global Warming: Toward a New Psychology of Climate Action. Chelsea Green Publishing.
Toyoda, S. (c. 1930). The 5 Whys of Root Cause Analysis. https://total-manufacturing.com/quality/problem-solving-techniques/five-whys/
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net