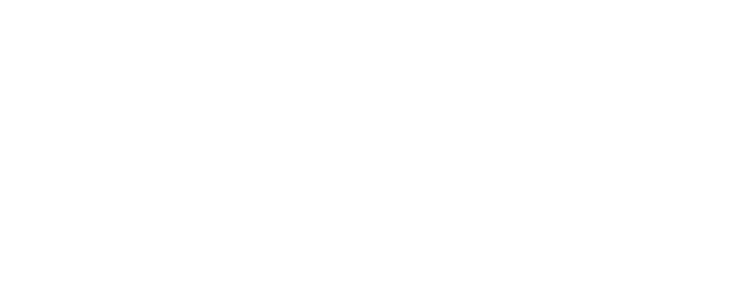Genèse et première analyse critique d’une innovation sociale en matière de littératie en milieu rural : le Limier Voyageur
Cet article présente la genèse, la description et l’analyse d’une innovation sociale en matière de promotion de la littératie dans les milieux ruraux : le Limier (Littératie Illustrée : Médiathèque, Interventions en Éducation et Recherche) Voyageur. Il y est principalement question des défis en matière de littératie et d’accès aux livres que vivent certains milieux ruraux et du désir de participer aux actions mises en œuvre au Québec pour réduire ces défis et favoriser l’égalité des chances. Plus particulièrement, cet article met en lumière les initiatives mobiles en matière de promotion de la lecture permettant, par exemple, par le recours à une bibliomobile ou des espaces éphémères de lecture, d’aller à la rencontre des communautés rurales éloignées. Les enjeux de littératie – entre autres dans la région de Chaudière-Appalaches – qui fondent la réflexion entreprise ainsi que les concepts de référence qui balisent l’initiative spécifique du Limier Voyageur y sont présentés, tout comme la démarche méthodologique employée pour la documenter. Ce qui caractérise le Limier Voyageur est par la suite décrit et des observations préliminaires quant à l’accueil qui lui est réservé dans les milieux ciblés et les limites ou obstacles rencontrés sont mises en lumière.
This article presents the genesis, description and a social innovation’s analysis in the promotion of literacy in rural areas: the Limier (Illustrated Literacy: Media Library, Interventions in Education and Research) Voyageur. It mainly discusses the literacy and access to books challenges experienced by certain rural areas and the desire to participate in the actions implemented in Quebec to reduce them and promote equal opportunities. More specifically, this article dive in mobile initiatives for the promotion of reading allowing through the use of a bookmobile or ephemeral reading spaces, to reach out to remote rural communities. The literacy issues – Chaudière-Appalaches region – which underpin the reflection undertaken, the reference concepts which mark the specific initiative of the Limier Voyageur, are presented, as well as the methodological approach used to document it. What characterizes the Limier Voyageur is then described and preliminary observations regarding the reception given to it in the targeted environments and the limits or obstacles encountered are discussed.
Introduction
Cet article présente la genèse, la description et une première mise en perspective critique d’une innovation sociale en matière de promotion de la littératie et plus spécifiquement de la lecture dans les milieux ruraux : le Limier (Littératie Illustrée : Médiathèque, Interventions en Éducation et Recherche) Voyageur. Cette innovation sociale, qui s’inspire d’initiatives comparables soucieuses, elles aussi, de s’engager dans le soutien à la littératie, est née d’un désir en tant qu’universitaire de contribuer concrètement aux actions menées au Québec pour réduire les inégalités d’accès à la lecture et plus largement à la littératie, notamment auprès des populations plus isolées géographiquement. Elle s’ancre aussi dans un désir de multiplier les situations de contact avec l’écrit hors de l’école pour agir comme potentielle actrice de changement en matière de littératie (Dezutter, Babin et Lépine, 2018).
Dans ce qui suit, la problématique qui fonde la réflexion entreprise pour déployer une initiative inédite de promotion de la littératie est présentée. Il y est principalement question des défis en matière de littératie, de culture et de développement social que vivent certains milieux ruraux et du besoin de poursuivre les actions et les initiatives susceptibles de réduire ces défis et de favoriser l’égalité des chances. Puisque le projet du Limier Voyageur concerne plus spécifiquement la région de Chaudière-Appalaches (le territoire naturel de l’UQAR, campus de Lévis, université d’attache de son initiatrice), un portrait plus précis de cette région et de ses enjeux de littératie est aussi réalisé dans cette première partie. La seconde section de l’article présente les concepts de référence et les appuis réflexifs ayant permis de baliser la démarche entreprise. Les concepts de ruralité, de littératie communautaire, de mobilité dans une perspective de promotion de la lecture et d’éducation informelle et non formelle y sont abordés. Dans la troisième partie, la démarche méthodologique employée pour cet article, soit l’étude de cas, est présentée ainsi que le contexte de recherche dans lequel se situe plus largement l’initiative du Limier Voyageur. Dans la dernière section de l’article consacrée aux résultats et à la discussion de ceux-ci, l’aboutissement de la réflexion entreprise, soit le Limier Voyageur et ce qui le caractérise, sont, dans un premier temps, détaillés. L’initiative du Limier Voyageur est en effet présentée dans cet article comme le résultat principal de la réflexion menée et de la problématique soulevée en matière de littératie dans les milieux ruraux. À la suite de cette partie plus descriptive, des observations préliminaires, au regard des actions jusqu’à présent réalisées par le Limier Voyageur, sont mises en lumière et discutées, entre autres pour mieux circonscrire les modifications ou bonifications à apporter au projet et les objectifs à poursuivre pour l’avenir.
1. Contexte et problématique
Le terme littératie est apparu au tournant des années 1990 pour élargir le champ conceptuel de l’enseignement de la lecture et de l’écriture et pour recadrer le rapport à l’écrit en tant que phénomène social et contextualisé (Cormier, 2017 ; Dezutter et Lépine, 2020). Il a dès lors été admis que les pratiques de littératie s’ancrent dans la manière dont les individus et les groupes se positionnent au sujet du lire-écrire (Mercier et Martel, 2021). Il a aussi été admis que les pratiques de littératie individuelles ou collectives se situent invariablement dans un contexte de rapport de force qui entraine la valorisation de certaines pratiques et la marginalisation d’autres (Dagenais, 2012).
Aujourd’hui, l’acquisition et le maintien de solides compétences de base en littératie, par les individus qui composent une société, sont considérés comme un gage majeur de vitalité des sociétés (OCDE, 2021) et un déterminant fort pour la qualité de vie (santé et bien-être) des adultes (Desrosiers et al., 2015). Ces compétences multidimensionnelles concernent l’ensemble des activités humaines qui impliquent l’usage de l’écrit, en réception et en production, donc l’aptitude à comprendre et à utiliser l’information par le langage sur supports analogiques et numériques en vue d’atteindre des buts personnels et sociétaux (Desrosiers et al., 2015 ; Lacelle, Lafontaine, Moreau et Laroui, 2016). Au-delà de la lecture, qui constitue une compétence clé de la littératie, d’autres capacités, comme celles d’écrire, de communiquer oralement, de calculer et de résoudre des problèmes sont aussi concernées. Il est aussi reconnu que la littératie se déploie aujourd’hui dans des contextes médiatiques variés dans lesquels les modes de communication – multimodaux – sont multiples, ce qui exige de nouvelles compétences, dont les compétences de littératie médiatique multimodale / LMM (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2017 ; Lebrun, Lacelle et Boutin, 2012 ; Lacelle et al., 2015) et celles liées spécifiquement à la littératie numérique qui implique une utilisation confiante et critique d’une gamme complète de technologies numériques pour l’information, la communication et la résolution de problèmes de base (Gouvernement du Québec, 2019 ; UNESCO, 2024).
Face à cette diversification, voire cette complexité accrue des compétences de littératie nécessaires pour atteindre des buts personnels et sociétaux, les enjeux en matière de littératie sont nombreux, au Québec comme ailleurs. Entre autres, d’importants enjeux concernent la difficulté pour un nombre important d’adultes à maitriser les compétences en lecture qui sont dorénavant comprises dans un continuum de compétences à cinq niveaux (Conseil supérieur de l’éducation du Québec, 2013) ; les niveaux les plus faibles (0 et 1) traduisant de grandes difficultés de lecture, les niveaux 2 et 3 traduisant respectivement une capacité à traiter un texte avec deux informations ou plus et de lire des textes denses ou plus longs nécessitant de l’interprétation, et les niveaux plus élevés (4 et 5) témoignant d’une capacité à effectuer des lectures complexes exigeant de comprendre, d’évaluer et de synthétiser plusieurs informations (Desrosiers et al., 2015).
Au Québec, les dernières données établies par le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PIECA), de même que les études réalisées pour la Fondation pour l’alphabétisation par l’économiste Pierre Langlois (2022 ; 2021), permettent d’observer que le niveau de littératie des Québécois·es s’est amélioré partout au Québec entre 2016 et 2021, ce qui est heureux. Toutefois, il demeure que le pourcentage des Québécois·es âgé·es de 16 à 65 ans qui ont un niveau de littératie inférieur à 3 est à 46 %. De manière préoccupante, l’écart s’agrandit entre les niveaux de littératie de la population de l’agglomération de Montréal et ceux, moins élevés, des autres régions ; certaines municipalités régionales de comté (MRC) ayant plus de 60 % de leur population avec des taux de littératie de niveau 3 et moins. Selon Langlois (2022 ; 2021), la cadence de rattrapage de plusieurs régions serait nettement insuffisante pour suivre le rythme de la progression montréalaise et de ses périphéries.
1.1. Les enjeux de littératie en milieu rural
Dans ses écrits sur la littératie en milieu rural au Québec, Ouellet (2023 ; 2021a ; 2021b) expose comment plusieurs régions – précisément les régions rurales éloignées des grands centres urbains – vivent des défis en matière de littératie et de culture.
Ces défis touchent particulièrement des petites communautés affectées par plusieurs facteurs de dévitalisation (Ouellet, 2021a ; 2021b), dont une vitalité économique fragile due, entre autres, au fort vieillissement de la population et à un faible taux de scolarisation1, une défavorisation matérielle et sociale et une absence ou une rareté des institutions et activités à caractère culturel (Ouellet et Martel, 2025). Dans ces communautés dévitalisées, les taux de littératie sont généralement très faibles, le rapport à l’écrit est souvent difficile (voire conflictuel), l’accès aux livres problématique et les pratiques culturelles liées à la littératie plus limitées (Ouellet, 2021a).
Dans un tel contexte, l’éducation et l’accès à la culture jouent assurément un rôle fondamental pour réduire les inégalités (De Varennes, 2017 ; UNESCO, 2021). C’est pourquoi le Conseil supérieur de l’éducation au Québec a émis un avis dès 2013 plaidant pour un engagement collectif en faveur du maintien et du rehaussement des compétences en littératie des adultes présent·es sur tout le territoire québécois (Mercier et Martel, 2021). À cet effet, plusieurs organismes locaux implantés en région et en milieu rural, dont, par exemple, les organismes en matière d’alphabétisation, jouent des rôles centraux, bien que souvent méconnus (Mercier et Martel, 2021). Toutefois, puisque les besoins sont nombreux, il importe de multiplier les actions susceptibles d’agir sur le développement et le maintien des compétences de littératie, dont les compétences de lecture, qui affectent directement la vitalité des sociétés et la qualité de vie des populations (OCDE, 2021).
Des pistes d’action en ce sens ont été identifiées par Ouellet (2021a ; 2023), dont celles-ci qui paraissent particulièrement intéressantes et prometteuses :
- stimuler l’offre éducative et culturelle en milieu rural au moyen de nouvelles ressources adaptées aux besoins, considérant que l’uniformité territoriale n’existe pas ;
- développer des projets dédiés exclusivement au développement de la littératie communautaire et de la culture plutôt que strictement aux compétences individuelles associées à la scolarité.
1.2. Le besoin de penser des innovations sociales porteuses et mobiles
Au regard de ces pistes, et dans le prolongement d’une approche de type écosystémique (Larose et al., 2004 ; Pithon, Asdih et Larivée, 2008) visant l’éducation pour tous·tes préconisée par l’UNESCO (Ouellet, 2021a), il parait pertinent de penser des initiatives d’éducation non formelles et informelles susceptibles de contribuer en région à la consolidation du développement des compétences de littératie hors des murs de l’école (Desrosiers et al., 2015).
Pour ce faire, « la mise en œuvre de ressources innovantes semble nécessaire pour briser le cercle qui maintient des collectivités rurales en constante dévitalisation » (Ouellet, 2023, p. 5), en souhaitant que ces innovations instaurent des changements significatifs dans les collectivités (Mayne, 2017).
Considérant que la littératie en milieu rural dévitalisé comporte une forte dimension géographique, entre autres parce que l’isolement et l’éloignement territorial agissent comme facteurs d’inégalités et d’accès à la lecture (Ouellet, 2021a), penser des innovations à caractère mobile, c’est-à-dire des initiatives itinérantes ou ambulantes tablant sur des interventions de proximité dans plus d’une communauté ou MRC, parait une avenue intéressante. Sachant que les pratiques culturelles des populations sont étroitement liées à la proximité des espaces ou des ressources (Dick, Jeanotte et Hill, 2019), une telle approche offrirait l’avantage de toucher plusieurs communautés à la fois au cœur même des lieux qu’elles habitent.
Comment et sur la base de quelles initiatives comparables penser un tel projet « mobile » de promotion de la littératie/lecture en milieu rural ? Pour répondre à quels besoins spécifiques ? En prenant appui sur quel·le(s) partenaire(s) régionaux·les ou locaux·les ? En misant sur quelles activités de promotion de la littératie/lecture et sur quels types d’interventions hors des murs de l’école ? Ce sont ces questions, et leurs réponses, qui ont conduit au développement du projet du @limier_voyageur.
1.3. Les besoins spécifiques de la région de Chaudière-Appalaches
Dans ce qui suit, un portrait de la région de Chaudière-Appalaches en matière de littératie est dressé afin de mieux circonscrire les enjeux et les besoins à prendre en compte. C’est dans cette région qu’il a été rapidement décidé de déployer nos efforts, puisque celle-ci est composée de nombreuses communautés rurales, en plus d’être le territoire attitré du campus de Lévis de l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) où travaille l’initiatrice du projet.
1.3.1. Description générale de la région de Chaudière-Appalaches
La région de Chaudière-Appalaches est l’une des 17 régions administratives du Québec. Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent, elle est composée de dix municipalités régionales de comté (MRC), 136 municipalités ; quatre centres de services scolaires (CSS) la desservent (Figure 1).

Sa superficie couvre 1 % du territoire québécois. Elle est bordée au nord-est par la région du Bas-Saint-Laurent, au sud-est par la frontière américaine et la chaine de montagne des Appalaches, au sud par la région de l’Estrie, à l’ouest par la région du Centre-du-Québec et au nord (de l’autre côté du fleuve Saint-Laurent) par la région de la Capitale-Nationale. La ville de Lévis, voisine de la ville de Québec, est la ville la plus importante de la région en termes d’activités économiques et de population (plus du tiers de l’ensemble de la région), mais d’autres villes, dont Saint-Georges de Beauce et Thetford Mines, sont aussi des villes importantes. Bien que certaines MRC de la région affichent une décroissance de population (ce qui constitue un enjeu important pour ces MRC), la population globale de Chaudière-Appalaches augmente grâce à la forte vitalité démographique des territoires de Lévis et de la Beauce. Notons toutefois que, malgré l’attractivité de la ville de Lévis, près de la moitié de la population (43,9 %) de Chaudière-Appalaches vivait en 2021 dans une zone rurale, comparativement à 18,8 % pour l’ensemble du Québec. Conséquemment, les réalités et enjeux liés à la ruralité y sont nombreux (Gouvernement du Québec, 2024 ; Institut de la statistique du Québec, 2023 ; PRÉCA, 2023a ; 2024a).
Comme partout au Québec, la population y est vieillissante. De sorte, en 2021, l’âge moyen de la population en Chaudière-Appalaches était de 44 ans, alors qu’il était de 42 ans pour l’ensemble du Québec. Majoritairement homogène et francophone, la population immigrante n’y représentait en 2021 que 2,2 % de la population totale (comparativement à 14,6 % pour le Québec), ce qui tend toutefois à changer. Au total, la population de la région représente environ 5 % de la population de l’ensemble du Québec (Gouvernement du Québec, 2024 ; Institut de la statistique du Québec, 2023 ; PRÉCA, 2023a).
1.3.2. Quelques données concernant l’éducation, la culture et les enjeux de littératie
Dans ses portraits de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Chaudière-Appalaches, l’organisme Partenaires pour la Réussite Éducative en Chaudière-Appalaches (PRÉCA) offre un panorama riche de l’environnement dans lequel évoluent les jeunes de la région et des caractéristiques de ceux-ci (enfants, adolescent·es et jeunes adultes). On y apprend (PRÉCA, 2024b ; 2023b) que 24 des 136 municipalités qui composent Chaudière-Appalaches (soit 17,6 %) sont dites dévitalisées, selon l’indice de vitalité économique2 des territoires. Selon les données établies en 2019, 3,8 % des familles formées d’un couple avec enfants et 16,5 % des familles monoparentales sont considérées comme étant à faible revenu après impôts. Or, les enfants qui proviennent de familles à faible revenu sont moins susceptibles de fréquenter l’enseignement supérieur (PRÉCA, 2023b, p. 10), d’autant, lorsque le marché de l’emploi est dynamique et avantageux, comme c’est le cas dans Chaudière-Appalaches. De même, 36 des 136 municipalités que compte la région n’ont pas d’écoles primaires et 31 sont situées à plus de 40 km d’un cégep. « Pour l’année scolaire 2021-2022, 18 écoles primaires et 2 écoles secondaires de Chaudière-Appalaches se situaient aux déciles 8, 9 ou 10 de l’indice de milieu socio-économique3. Ce sont ainsi 10,5 % des élèves du primaire et 8,1 % des élèves du secondaire qui fréquentent une école considérée comme défavorisée » – c’est le tiers pour l’ensemble du Québec (PRÉCA, 2023b, p. 6). Pour les jeunes cependant, on retrouve dans la région de Chaudière-Appalaches plus de 40 maisons des jeunes, une dizaine de maisons de la famille et une dizaine d’organismes en employabilité, sans compter plusieurs autres initiatives leur étant dédiées.
En matière d’accès à la culture pour tous·tes, 90,5 % de la population de la région (contre 96,4 % pour l’ensemble du Québec) était en 2023 desservie par une bibliothèque publique ou par un protocole d’entente permettant l’utilisation d’une bibliothèque adjacente à la municipalité d’appartenance ; 40,3 % de cette population (contre 32 % pour l’ensemble du Québec) était inscrite à ce service public (PRÉCA, 2023b). Plusieurs autres lieux de culture sont aussi présents sur le territoire (salles de spectacles, lieux d’interprétation, librairies, etc.), bien que plusieurs soient éloignés des lieux de résidence de la population. Selon les données de 2018, les municipalités de Chaudière-Appalaches auraient dépensé en moyenne 41,87 $ par habitant dans le domaine de la culture ; ce montant par habitant étant le plus faible parmi l’ensemble des régions (PRÉCA, 2023b ; 2024b)4.
Toujours selon les portraits réalisés par PRÉCA (2023b), sur la base des données officielles disponibles en 2016, plus de la moitié (56 %) de la population de 15 ans et plus était alors considérée comme ayant un faible niveau de compétence en littératie, certaines MRC étant particulièrement touchées par des enjeux de littératie. Les données produites pour 2021, et analysées par la Fondation pour l’alphabétisation (Langlois, 2023), permettent de constater une progression de 1,1 %, puisque 54,6 % de la population présente alors un indice de littératie sous le niveau trois. L’écart avec la moyenne québécoise se poursuit toutefois. Deux MRC se démarquent par une progression de leur indice de littératie et de leur taux de diplomation (L’Islet et Bellechasse). Cependant, une MRC (celle des Etchemins) présente encore des défis majeurs en littératie alors que 61,1 % de la population n’atteint pas le niveau 3 en 2021 et que les personnes sans diplôme y constituent plus de 30 % de la population de 15 ans et plus (Figure 2).

Le Conseil régional des partenaires du marché du travail (2022) précise de son côté que 1/5 des Québécois·es de 15 à 64 ans (dont 53 000 en Chaudière-Appalaches) a une capacité très limitée à traiter l’information. De même, le groupe des 45-65 ans (89 000 en Chaudière-Appalaches) présente le plus faible niveau de littératie et de numératie.
Le développement des compétences de littératie étant fortement (mais pas exclusivement) lié à la scolarité, notons enfin qu’en 2021, 12,2 % de la population de 25 à 64 ans est sans diplôme, 16,7 % possède un diplôme de niveau secondaire (acquis dans plus de 7 % des cas dans les centres d’éducation aux adultes) et 26,3 % détient un diplôme de niveau professionnel (Figure 3). De sorte, au cours de la dernière décennie, d’importantes avancées ont été faites dans la région en matière de persévérance scolaire (Cyr et Martel, 2024), notamment au regard du nombre d’adultes (77 % en 2009 et 89 % en 2022) étant titulaires d’un diplôme, toutes catégories confondues.
À cet égard, la région de Chaudière-Appalaches présente des taux de scolarité comparables à ceux obtenus pour l’ensemble du Québec, avec toutefois une différence plus importante quant au pourcentage de la population ayant un diplôme de niveau professionnel (plus élevé) et celui ayant un diplôme universitaire (moins élevé). Ultimement toutefois, des enjeux de littératie y sont importants, notamment pour des communautés, des familles ou des personnes en situation de vulnérabilité dans les milieux ruraux de la région.

1.3.3. Quelques ressources et initiatives en matière de littératie
Dans un grand territoire comme celui de la région de Chaudière-Appalaches, de nombreuses ressources publiques et services divers en matière de littératie sont disponibles (de manière inégale toutefois selon les endroits). « Puisque développer la littératie, ce n’est pas (exclusivement) développer la scolarité » (Ouellet, 2021b), ces ressources et services qui nous intéressent s’inscrivent en dehors des actions du système scolaire.
Pour rappel, 90,5 % de la population de la région était en 2023 desservie par une bibliothèque publique ou un protocole d’entente (PRÉCA, 2023b). Plusieurs de ces bibliothèques sont de véritables milieux de vie dynamiques et accueillants (Faucher, 2022). Le Réseau BIBLIO du Québec qui a pour mission de favoriser le déploiement des bibliothèques dans les municipalités de 5 000 habitant·es et moins, y est particulièrement central par les actions de valorisation et de développement qu’il mène, tout comme le réseau des bibliothèques de la ville de Lévis, qui compte 10 points de service à travers l’ensemble de son territoire. Une variété de services et d’activités adaptés à tous les goûts et à tous les âges y sont présents. Toutefois, moins de la moitié de la population de Chaudière-Appalaches (40,3 %) est inscrite à une bibliothèque et donc bénéficie des services offerts (PRÉCA, 2023b). De surcroit, plusieurs familles vulnérables, comme l’ont constaté les intervenant es de PRÉCA (2024c), entretiennent avec les bibliothèques un rapport complexe : elles craignent d’abimer les livres ou de devoir payer des amendes de retard, elles craignent que leurs enfants dérangent, elles méconnaissent les activités qui y sont proposées, sans compter que plusieurs vivent des enjeux de transport pour se rendre à la bibliothèque ou elles sont confrontées à des enjeux d’horaire face au peu d’heures d’ouverture de leur bibliothèque de proximité.
C’est entre autres pour rejoindre les clientèles qui ne fréquentent pas les bibliothèques sur le territoire de Lévis que le BiblioCube (Figure 4) a été mis en circulation. Il s’agit d’un camion doté d’une identité visuelle colorée offrant des activités (animations et formations) développées selon les spécificités et les besoins des quartiers visités, en plus d’offrir un espace mobile de bibliothèque où l’inscription et le prêt de livres sont possibles. Véritable bibliothèque dans la communauté urbaine de Lévis, le BiblioCube visite les écoles, les camps de jour, différents parcs et espaces publics de la ville, tout comme il va à la rencontre d’organismes partenaires de façon ponctuelle.

Bien qu’une offre comparable n’existe pas en dehors du territoire urbain de Lévis, dans la région de Chaudière-Appalaches, des initiatives de littératie mobile qui s’en apparentent existent dans certaines MRC afin de multiplier les services de proximité. C’est le cas de la MRC de Lotbnière qui déploie depuis 2017 un service de Biblio Mobile afin de rejoindre les plus jeunes de son territoire (0-5 ans et 6-12 ans). Des animations littéraires gratuites sont offertes par ce service, entre autres grâce à la tente à contes, auprès entre autres des services de garde et des camps d’été. Cette initiative vise à donner un accès accru à la culture dans la région, en plus d’encourager les habitudes de lecture chez les jeunes. C’est aussi le cas de l’organisme ABC des hauts-plateaux qui offre depuis 2008 un service de bibliomobile dédié aux familles ayant des enfants de 0-5 ans. Les intervenant·es en éveil à la lecture, qui y sont associé·es, circulent dans 15 municipalités de l’Islet-Sud et de Montmagny-Sud, de maison en maison, pour offrir des prêts de livres et de jeux éducatifs, animer des lectures et proposer aux parents des outils favorables au développement de compétences en littératie.
Outre ces ressources axées spécifiquement sur des initiatives de littératie mobile, plusieurs organismes communautaires ou autres ressources dédiées à des clientèles variées (familles, adolescent·es, jeunes adultes, ainé·es, immigrant·es, personnes en situation de handicap, etc.) jouent un rôle important, notamment en milieu rural où il peut être difficile d’avoir accès à une variété d’activités en lien avec la littératie. Ces organismes ou ressources agissent de manière locale en alphabétisation, en soutien scolaire, en littératie familiale, en francisation, en consolidation ou maintien des compétences en littératie, dont la littératie numérique, etc. Les initiatives menées, généralement offertes dans un espace fixe, sont variées (club de lecture, de cinéma ou de jeux, formations sur mesure, concours d’écriture, productions artistiques, café philosophique, lectures animées, halte-garderie, sorties culturelles supervisées, etc.).
Plusieurs de ces initiatives visent plus spécifiquement les enfants, les adolescent·es et les jeunes adultes. Certaines sont appuyées par l’organisme PRÉCA qui, en tant qu’instance régionale de concertation, agit comme véritable carrefour pour les partenaires de différents milieux qui s’engagent et se mobilisent afin de favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes de Chaudière-Appalaches. Ces initiatives menées, par exemple, par les maisons de la famille ou les maisons des jeunes agissent sur les facteurs susceptibles d’intervenir sur le développement personnel des jeunes (facteurs familiaux, personnels, scolaires et sociaux). C’est, par exemple, le cas du projet Un pas hors de l’ombre mené par la maison des jeunes de Thetford Mines, qui a permis à des adolescent·es d’autoproduire un court métrage afin de réfléchir aux enjeux cruciaux touchant la jeunesse.
Certaines initiatives ou ressources visent plus spécifiquement les communautés rurales dites dévitalisées et l’ensemble de la population d’un territoire. Ces initiatives sont toutefois plus rares. C’est le cas de la mise en place de la médiathèque l’Héritage de l’Islet-Sud, un organisme à but non lucratif dédié à l’éducation, à la culture et au patrimoine initié par Sébastien Ouellet, professeur-chercheur en éducation à l’UQAR, natif de la région. Ayant comme objectif de doter la MRC de L’Islet d’une infrastructure culturelle durable, tout en préservant une église patrimoniale, cette médiathèque unique dans la région de Chaudière-Appalaches est un lieu de rassemblement pour la population de ce territoire, dont les familles et les personnes isolées. Diverses activités et ressources y sont mises en place. On y propose, par exemple, un coin lecture Mobi-Lire, une classe des générations (une salle d’apprentissage interactive qui propose des ilots de travail avec ordinateurs et tablettes numériques pour des formations offertes aux ainé·es), un club de loisirs et de culture pour les jeunes, une bouquinerie, des spectacles ponctuels, etc., donc des expériences organisées et structurées de culture et de littératie.
1.3.4. Synthèse et objectifs
Pour les communautés rurales plus éloignées des centres urbains (par exemple, de Lévis pour la région de Chaudière-Appalaches), l’enjeu d’accessibilité est fondamental, d’où l’intérêt de multiplier les initiatives de littératie mobile qui permettent d’approcher autrement des populations en situation de vulnérabilité ou d’éloignement.
L’intérêt de telles initiatives explique la mise en place du BiblioCube dans la région de Lévis et des projets de bibliomobile dans Lotbinière, L’Islet-Sud et Montmagny-Sud. Elle explique aussi que dans la grande région voisine du Bas-du-Fleuve, qui présente certaines caractéristiques socio-économiques similaires à celle de Chaudière-Appalaches, l’initiative de Livres en fête, ait vu le jour. Entièrement développée par le réseau BIBLIO du Bas-Saint-Laurent, cette initiative innovante a pour but de transmettre les bienfaits et le plaisir de la lecture à l’ensemble de la population du Bas-Saint-Laurent, peu importe leur lieu de résidence. Pour ce faire, et un peu comme le fait le BiblioCube de Lévis, deux véhicules (un camion et une remorque transformés en bibliothèques et ludothèques ambulantes) circulent sur le territoire afin de rejoindre les gens qui fréquentent peu ou pas les bibliothèques, faire la promotion des nombreux services qui y sont offerts et animer des activités variées de littératie.
C’est dans le prolongement de telles initiatives et face aux nombreux besoins toujours présents qu’il apparait porteur de penser de nouvelles innovations sociales en matière de littératie. À cet égard, l’objectif général que nous poursuivons est clair : participer aux actions « mobiles » mises en œuvre au Québec, plus particulièrement dans la région de Chaudière-Appalaches, pour réduire les enjeux de littératie des personnes en situation de vulnérabilité, favoriser l’accessibilité à la lecture et ultimement, favoriser l’égalité des chances.
De quelle(s) manière(s) et pour quels résultats préliminaires ? C’est à ces questions que se consacre cet article.
2. Concepts de référence et appuis réflexifs
Dans ce qui suit, certains des concepts de référence et des appuis réflexifs ayant permis de baliser la réflexion entreprise, pour penser une innovation sociale mobile en matière de littératie en milieu rural dans la région de Chaudière-Appalaches, sont présentés. Il est, entre autres, question de ruralité, de littératie communautaire, d’éducation informelle et non formelle, de mobilité dans une perspective de promotion de la lecture (plus particulièrement de bibliomobile) et d’innovation sociale.
2.1. La ruralité… et la néoruralité
La ruralité réfère à des significations différentes selon les contextes et les critères utilisés pour la définir. De sorte, les définitions sont multiples et permettent plusieurs interprétations, tout en rendant les comparaisons entre les pays parfois difficiles.
Elles se basent toutefois en général sur des critères tels que la densité populationnelle, la démographie ou l’accessibilité géographique en termes de temps de déplacement pour accéder aux services. D’autres caractéristiques réfèrent à une prépondérance des paysages à couverture végétale, des usages économiques à dominance agro-sylvopastorale, un mode de vie caractérisé par l’appartenance à des collectivités de taille limitée et un rapport particulier à l’espace […] (Simard, 2014, p. 2).
Pendant longtemps, la ruralité s’est définie en opposition à l’urbanité et en fonction d’une logique chiffrée liée au nombre d’habitant·es (Dugas, 2017). Toutefois, au cours des années, cette opposition classique est progressivement disparue, de même qu’une vision parfois trop stéréotypée de la vie en milieu rural ou de ce qu’on appelle communément la campagne (Guimond, Simard et Gilbert, 2020 ; Ouellet, 2023 ; 2021a ; 2021b). Il est à ce propos de plus en plus courant de parler de néoruralité (Jean, Dionne et Desrosiers, 2009). Désormais, le rural n’est pas systématiquement l’agricole (Rieutord, 2012 ; Simard, 2014) et des familles depuis des générations établies y côtoient des néo-ruraux·les, dont des citadin·es à la recherche d’un autre mode de vie, de même que des familles immigrantes nouvellement installées. Cette néo-ruralité et les caractéristiques qui y sont associées s’observent justement dans la région de Chaudière-Appalaches dans laquelle le projet dont il question dans cet article s’inscrit.
Il importe de préciser que des différences marquées existent, partout au Québec, entre les milieux ruraux à proximité de centres urbains, donc périurbains (plus favorisés économiquement et socialement), les milieux ruraux un peu plus loin des centres urbains où règnent des activités agricoles, manufacturières et récréotouristiques d’importance et les milieux ruraux périphériques (ou régions ressources) dans lesquels les bases traditionnelles de l’économie s’effritent, avec toutes les conséquences associées (Solidarité rurale du Québec, 2018 ; Vézina, Blais et Michaud, 2003). Dans les deux derniers milieux, encore davantage dans le troisième, le maintien des services de proximité est un enjeu d’importance, tout comme l’exode des jeunes et le vieillissement de la population (Simard, 2014). Pour caractériser les milieux qui font face à ces enjeux d’importance, et à plusieurs autres défis, le terme de milieu rural dévitalisé ou communautés dévitalisées est de plus en plus utilisé (Proulx, 2010). Il est entre autres utilisé et défini par Ouellet (2025 ; 2021a ; 2021b ; 2023) qui s’est intéressé aux besoins locaux de la MRC de L’Islet située dans la région de Chaudière-Appalaches (Ouellet et Martel, sous presse)5.
2.1.1. La ruralité québécoise
Depuis la publication de sa politique nationale de la ruralité en 2002, on définit au Québec le territoire rural comme étant formé des municipalités situées à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMC)6 et hors des agglomérations de recensement (AR)7 ; les RMC et les AR sont considérées comme des centres importants et densément peuplés constitués de municipalités adjacentes qui sont intégrées sur le plan socioéconomique (Statistiques Canada, 2022).
En utilisant cette définition, le territoire rural auquel nous nous intéressons comprend au Québec plus de 1 000 municipalités et plusieurs communautés autochtones réparties sur 190 000 km2, dont certaines sont de petites villes (moins de 7 000 habitant·es), des villages (100 à 2 000 habitant·es), voire des hameaux (Jean, Dionne et Desrosiers, 2009 ; Simard, 2014). La vaste majorité des 17 régions administratives qui recouvrent le Québec et qui regroupent 104 municipalités régionales de comté (MRC) et des municipalités indépendantes comprend des territoires dits ruraux. Au total, le Québec rural comprend plus de deux millions de résident·es, soit près du quart de l’ensemble de la population québécoise. Ce Québec rural se concentre dans le sud, en particulier dans les basses-terres de la vallée du Saint-Laurent, avec quelques ilots de peuplement dans les Appalaches et dans le bouclier laurentien. De sorte, il concerne très fortement la région de Chaudière-Appalaches. « Cette géographie de la population et du peuplement est essentielle à la compréhension de la ruralité du Québec » (Guimond et Jean, 2021).
2.2. La littératie… communautaire
S’intéresser à la littératie dans les milieux ruraux et au sein des communautés qui les composent interpelle directement la notion de littératie et celle plus spécifique de littératie communautaire.
Il est aujourd’hui bien admis que la littératie ne se limite plus à la capacité de lire et qu’elle englobe des habiletés nécessaires tout au long de la vie (Mercier et Martel, 2021). C’est ce qui explique pourquoi les compétences en littératie favorisent le développement et l’épanouissement des personnes (OCDE, 2021) et qu’elles concernent l’éducation tout au long de la vie (UNESCO, 1997). À cet effet, la littératie se définit aujourd’hui comme « la capacité d’une personne, d’un milieu et d’une collectivité à comprendre et à communiquer de l’information par le langage sur différents supports pour participer activement à la société dans différents contextes » (Lacelle et al., 2016). Elle concerne toutes les formes de langage et elle ne s’applique pas qu’aux individus, puisqu’elle convoque aussi les groupes et leur environnement, milieu ou communauté (Dezutter et Lépine, 2020). La littératie est conséquemment liée à des pratiques sociales inséparables des contextes sociaux et culturels d’usage de l’écrit ou plus largement de la communication. À cet égard, elle implique des interactions sociales et culturelles situées (ou contextualisées) entre les personnes ou entre les groupes, tout comme elle implique des interactions avec diverses instances et des attentes sociales, ce qui engage des questions d’identité, de relations de pouvoir, de rapports (à l’écrit, à l’école, etc.), d’accès aux ressources, etc. (Barton et Hamilton, 2010 ; Mercier et Martel, 2021).
Bien que la notion plus spécifique de littératie communautaire soit définie de manière multiple et pas toujours consensuelle (Beauregard, Carignan et Létourneau, 2011 ; Henry et Stahl, 2021), elle réfère au rôle que joue la communauté (groupes communautaires, organismes, associations, bibliothèques publiques, etc.) dans les réalités littéraciques chez les différents groupes de population (Dezutter et al., 2018). Il y est donc question de l’influence – réelle et documentée (Bélisle, 2006 ; Bélisle, Roy et Mottais, 2019) – de la communauté sur le développement des compétences de littératie et sur la capacité d’une collectivité à mobiliser une diversité d’intervenant·es dans une perspective collaborative autour des personnes apprenantes (Beauregard et al., 2011)8.
La recherche documentaire récente et très complète réalisée par Dufour et al. (2021) autour du concept de littératie communautaire est éclairante, notamment parce que nous cherchons à mieux saisir comment cette forme de littératie peut guider nos réflexions et actions. Considérant la diversité des communautés qui coexistent sur un territoire donné et leurs réalités et besoins différenciés, la recherche menée met en lumière la nécessité de repenser les approches traditionnelles en termes de développement ou de promotion de la littératie pour atteindre des populations socialement exclues, marginalisées ou plus vulnérables par rapport au groupe majoritaire (Dufour et al., 2021). À cet égard, la littératie communautaire apparait comme un « nouveau modèle d’action sociale associé à une diversité de lieux en dehors du milieu scolaire et de contextes reliés à la littératie familiale, à la littératie des jeunes et à l’éducation des adultes » (Moneyhun (1997) dans Dufour et al., 2021). Les acteur·rices en littératie qui travaillent dans cette perspective le font généralement avec les institutions en place, mais pour et avec la communauté (Farmer, 2020). Les tiers-lieux, par exemple, la bibliothèque, permettent au besoin de sortir des institutions formelles, dont l’école, pour entre autres diminuer les rapports de pouvoir ou de domination réels ou ressentis (Larson et Moses, 2018). Dufour et al. (2022), en cherchant à définir la littératie communautaire, concluent que celle-ci réfère donc, du moins dans les écrits adoptant une perspective socioculturelle, à un processus et à une pédagogie orientée sur l’action sociale reliant des contextes et des lieux diversifiés.
Une définition plus ethnoculturelle de la littératie communautaire, qui interpelle encore plus spécifiquement nos velléités initiales d’interventions en milieux ruraux, réfère quant à elle à
des apprentissages réalisés en participant à des activités sociales et en interagissant avec d’autres, en dehors de l’école, et situés dans des communautés de pratique […] Les communautés de pratiques peuvent être localisées dans des espaces physiques, comme la bibliothèque (club de lecture, heure du conte, espace maker), la maison (production de cartes de fête, organisation des menus), le lieu de travail (ébénisterie), la prison, divers contextes de loisirs (tricot, jardinage), ou numériques (jeux vidéo en ligne, communauté des adeptes des films de Tolkien) ; leurs activités peuvent être événementielles, occasionnelles, spontanées ou inscrites dans la durée. (Dufour et al., 2022)
2.3. L’éducation informelle et non formelle
L’aspect informel des pratiques de littératie dans les différentes communautés (de pratique) constitue une caractéristique déterminante des littératies dites communautaires qui les distinguent des littératies plus formelles liées à l’école (Dufour et al., 2022).
Bien que la scolarité soit un élément clé du développement des compétences en littératie (Institut de la statistique du Québec, 2006), il est aujourd’hui admis que la réussite scolaire des jeunes et plus largement le développement et la consolidation des compétences de littératie est une responsabilité partagée (Conseil supérieur de l’éducation, 2013 ; Lenhoff et al., 2020) qui dépasse largement le cadre de l’école. Pour favoriser l’égalité des chances, mais aussi intervenir auprès des nombreux adultes qui vivent d’importants défis en matière de littératie, c’est donc aussi en dehors des murs de l’école qu’il parait primordial d’agir.
Pour penser l’éducation, la formation et l’apprentissage tout au long de la vie, il est d’usage de recourir aux termes formel, non formel et informel, bien que ces notions soient loin de faire consensus (Brougère et Bézille, 2007 ; Colley, Hodkinson et Malcom, 2003). Malgré les nuances qui s’imposent, l’apprentissage formel réfère généralement à un apprentissage intentionnel réalisé dans un contexte organisé et structuré, par exemple à l’école, lieu par excellence d’éducation formelle9. L’apprentissage non formel, lui aussi intentionnel, est intégré dans des activités planifiées qui ne sont toutefois pas explicitement désignées comme activités d’apprentissage en termes d’objectifs ou de ressources. L’éducation dite non formelle recouvre donc des programmes ou des projets d’éducation sociale mis en place dans différents lieux et destinés à des populations diverses. Ceux-ci visent à améliorer un ensemble d’aptitudes et de compétences, en dehors du cursus éducatif officiel. Enfin, l’apprentissage informel n’est pas organisé et structuré ; il s’inscrit dans la pratique d’activités de la vie quotidienne liées au travail, à la famille et aux loisirs. L’éducation informelle correspond donc au processus d’apprentissage tout au long de la vie d’une personne (Brossard, 2001 ; Brougère et Bézille, 2007 ; Hart, 2013 ; ILMA, 2024).
Malgré l’importance des actions menées en éducation formelle, plusieurs études mettent en évidence l’intérêt des initiatives non formelles et informelles – les deux termes sont souvent utilisés sans distinction précise ou sont confondus – pour consolider hors des murs de l’école le développement de la littératie (Bélisle, 2004 ; Desrosiers et al., 2015 ; Moore et Sabatier, 2014). C’est, entre autres, pour cette raison qu’il nous parait souhaitable de penser une innovation sociale en matière de littératie en dehors de l’école (quoique complémentaire), mais au cœur des lieux de vie des communautés ciblées. Dès lors, la mobilité comme déterminant d’intervention informelle parait fondamentale, d’autant lorsque les communautés sont éloignées et réparties sur un vaste territoire, comme c’est le cas dans la région de Chaudière-Appalaches.
2.4. La mobilité comme déterminant d’intervention
Bien que les compétences en lecture ne soient pas les seules compétences liées à la littératie, elles demeurent essentielles, entre autres parce que la compétence à lire et plus largement à comprendre de l’information, peu importe sa forme – écrite ou visuelle, par exemple – permet d’apprendre tout au long de sa vie (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2017 ; OCDE, 2013).
Pour développer et consolider les compétences en lecture, l’accès au livre, véritable instrument culturel d’éducation, est un facteur déterminant. Le livre, comme le soutient entre autres l’UNESCO, contribue en effet à construire et à maintenir le tissu éducatif et culturel des sociétés. « Alphabétiser sans offrir ensuite de textes à lire est aussi cruel qu’éveiller la soif puis refuser un verre d’eau » (Dorance, 2009).
C’est en considérant justement l’importance du livre et de son accès pour tous que le gouvernement québécois a bonifié, en 2019, l’aide financière aux centres régionaux de services aux bibliothèques publiques afin que ces dernières, qui participent sans contredit à l’essor de la culture et des communications, maintiennent et développent des services de qualité permettant un meilleur accès au livre et à la lecture à la population québécoise des plus petites municipalités (Gouvernement du Québec, 2019). Malgré ce soutien et la forte fréquentation des bibliothèques là où celles-ci existent (Roussel, 2008)10, l’accès aux livres dans certaines régions du Québec (comme dans plusieurs autres régions du monde d’ailleurs) reste limité. Il est vrai qu’en 2019, 283 municipalités réparties dans toutes les régions du Québec n’offraient aucun service de bibliothèque, sans compter les municipalités qui offrent des services de bibliothèques partielles, entre autres parce que leurs heures d’ouverture et leurs ressources matérielles et humaines sont limitées (Association des bibliothèques publiques du Québec et des membres du Réseau BIBLIO, 2022).
2.4.1. Pour un accès « mobile » aux livres et à la lecture : les bibliothèques mobiles
C’est justement pour apporter des livres à des populations n’ayant pas ou peu d’accès à la lecture publique et aux livres, qu’ont été pensées, il y maintenant plus d’un siècle, les bibliothèques mobiles ou itinérantes (Dorance, 2009 ; Vuilleumier, 2015).
Appelées régulièrement « bibliobus » dans les pays francophones et « bookmobile » dans les pays anglophones11, ces bibliothèques mobiles sont des bibliothèques itinérantes qui englobent tous les moyens utilisés pour transporter des livres (et parfois d’autres objets de culture) à des populations ne disposant pas de bibliothèques de proximité ou de services comparables. Certaines ne transportent et ne déposent que des caisses de livres dans différents lieux de proximité (école ou maison de retraite, par exemple) ; d’autres sont de véritables bibliothèques circulantes reposant sur un véhicule (ou remorque) aménagé avec rayonnages, prêt direct et parfois l’offre d’activités de médiation autour du livre ou l’offre de formations dans et autour du véhicule12. La mise en service d’une bibliothèque mobile, son organisation et son offre de services reposent en fait sur les besoins à couvrir en matière de littératie, mais aussi en fonction des caractéristiques du territoire à desservir et des moyens financiers et humains disponibles (Dorance, 2009 ; Kowalczyk, 2015 ; Vuilleumier, 2015).
Dès leur création, comme d’ailleurs encore aujourd’hui, les bibliothèques mobiles desservent principalement (mais pas exclusivement) des populations vulnérables qui n’ont pas les moyens (ou l’habitude sociale) d’acheter des livres, ni l’accès (réel ou par contraintes) aux livres. Bien que cela soit moins vrai pour le Québec, elles visent généralement les populations éloignées des villes, entre autres les milieux ruraux, afin de ne pas priver de livres des populations sous prétexte de leur éloignement géographique. Elles sont donc une réponse aux enjeux de littératie et d’accès aux livres pour tous·tes, entre autres dans des endroits où entretenir un service de bibliothèque fixe est difficile, voire impensable. C’est de sorte une réelle solution « […] pour atteindre un très grand nombre de gens, adultes et enfants, de façon adaptée, en modulant l’offre par rapport à leurs goûts, leurs besoins, leur niveau, leurs attentes » (Dorance, 2009, p. 8).
Pour la région de Chaudière-Appalaches, mais aussi toutes les régions rurales du Québec marquées par des enjeux d’accès aux livres, c’est une solution à considérer.
2.4.1.2. Pour un accès mobile aux livres et à la lecture… les opportunités éphémères
Outre le recours aux bibliothèques mobiles (exigeant sur le plan matériel et financier), il est aussi possible de favoriser l’accès aux livres et à la lecture en misant sur des initiatives mobiles que l’on pourrait qualifier de plus éphémères. La création d’espaces éphémères d’opportunités de lecture, comme les tentes à lire où les enfants sont invité·es à lire ou à se faire raconter des histoires dans un parc, permettent aussi de démocratiser l’accès aux livres et à la culture là où vivent des populations plus vulnérables ou à risque. C’est aussi ce que font dans une certaine mesure les boites à livres ou croque-livres qui se multiplient en territoire principalement urbain (mais pas seulement), qui sont susceptibles de favoriser la découverte de livres et l’échange autour des livres.
Cette idée de l’éphémère, peu importe la forme qu’elle prend, est liée à la mobilité, au passage, au mouvement dans l’espace. Elle interpelle aussi la notion du temps, puisqu’il s’agit de proposer un moment, un instant, possiblement unique et privilégié, qui ne sera pas nécessairement répété. Enfin, comme le soulignent avec justesse Dire, Gast et Paillet (2017), l’éphémère interroge la notion du lecteur traditionnel en bibliothèque. Toute bibliothèque éphémère ou initiative éphémère et ponctuelle d’accès aux livres attirera un·e lecteur·rice éphémère, « de passage […] qui ne vient qu’une fois […] dont on n’attend pas forcément le retour […] Ce sera un lecteur qu’on va accepter de ne pas connaitre et de voir partir » (p. 8).
Ultimement, la création d’espaces éphémères d’opportunités de lecture permet de toucher – parfois grâce à un heureux hasard – des personnes ou des groupes qui ne fréquentent pas les bibliothèques (ou les autres lieux de culture du livre) parce qu’ils sont « empêché·es » au sens physique (éloignement, absence de services à proximité) ou au sens moral et social, par exemple parce que ce n’est pas dans leurs pratiques et habitudes personnelles ou familiales (Dire et al., 2017). Pour multiplier les possibles, le déploiement de tels espaces en milieu rural parait particulièrement intéressant, entre autres parce qu’il est moins exigeant sur le plan matériel que le recours à une bibliomobile, tout en étant aussi une solution innovante pour atteindre de façon adaptée un grand nombre de personnes, même ceux·lles vivant en territoire éloigné et isolé.
2.5. L’innovation sociale pour transformer le réel
Comme le soulève avec justesse Ouellet (2023), au regard des enjeux de littératie en milieu rural, des interventions sont assurément nécessaires, notamment pour produire un « changement des attitudes et des comportements individuels » (Dolbec et Prud’homme (2009) dans Duchesne et Leurebourg, 2012, p. 3), mais aussi pour instaurer un changement significatif dans les collectivités (Mayne, 2017).
L’innovation sociale dans cette perspective présente l’intérêt de proposer une solution inédite à un problème social (Bourbousson et Richez-Battesti, 2023 ; Phills, Deiglmeier et Miller, 2008). Elle est définie par le Réseau québécois en innovation sociale (2011) comme :
une nouvelle idée, approche ou intervention, un nouveau service, un nouveau produit ou une nouvelle loi, un nouveau type d’organisation qui répond plus adéquatement et plus durablement que les solutions existantes à un besoin social bien défini, une solution qui a trouvé preneur au sein d’une institution, d’une organisation ou d’une communauté et qui produit un bénéfice mesurable pour la collectivité et non seulement pour certains individus. La portée d’une innovation sociale est transformatrice et systémique. Elle constitue, dans sa créativité inhérente, une rupture avec l’existant.
Lorsqu’elle est implantée en milieu rural où les institutions publiques sont moins présentes, l’innovation sociale est susceptible d’être le pivot d’un changement social transformateur (Brandsen et al., 2016 ; Ouellet, 2023). À cet effet, plusieurs types de transformations sont associés à l’innovation sociale, dont celui-ci, qui concerne davantage l’intervention en matière de littératie : une « transformation sociale, porteuse des valeurs de vivre-ensemble, d’accès à la culture, d’apprentissage » (Grison et Pradels, 2022, p. 373).
Ultimement, la mise en place d’une innovation sociale s’appuie généralement sur trois phases importantes (Réseau pour l’innovation sociale au Québec, 2011) qui sont très bien résumées par Ouellet (2023, p. 13). Ces phases ont guidé et guident encore le déploiement du Limier Voyageur :
D’abord, une première étape, dite de l’émergence, est associée à l’analyse des besoins, à la fixation d’objectifs et des moyens pour les atteindre, à la conceptualisation du projet et à sa planification. Cette première étape est donc consacrée à tout ce qui fait partie de l’élaboration. Puis, une seconde étape est constituée de l’implantation formelle et constitue une expérimentation qui se veut cruciale puisqu’elle implique de mettre en œuvre ce qui a été planifié, incluant les essais et les erreurs, et se réalise toujours en lien avec les acteurs du milieu et de l’extérieur de la communauté. La 2e étape est toujours la plus longue et au cours de laquelle a lieu l’utilisation de multiples ressources humaines, matérielles, financières, etc. La 3e phase est celle de l’appropriation, notamment par la communauté locale, mais aussi par des activités de communication à plus grande échelle afin d’atteindre une forme d’appropriation étendue aux partenaires territoriaux et régionaux.
3. La démarche méthodologique
En soi, la création et le déploiement du Limier Voyageur comme initiative universitaire et citoyenne innovante en matière de littératie mobile en milieu rural est analysé ici comme une étude de cas (Gagnon, 2011 ; Stake, 2008) qui s’inscrit dans un contexte plus large de recherche intervention (Noguera et Plane, 2020).
L’élaboration et le déploiement de tout projet, notamment un projet d’innovation sociale, s’inscrit dans une longue démarche réflexive et méthodologique. À l’instar de la démarche entreprise par Jones (2004) et Ouellet (2021a ; 2021b ; 2023), qui ont tous deux implantés des projets d’innovation sociale axés sur la culture en milieu rural, il est en premier lieu central de brosser un portrait du milieu (population visée) pour lequel l’initiative se destine. La réalisation d’un tel portrait (présenté en première partie de cet article) permet entre autres de bien circonscrire les besoins du milieu ciblé, mais aussi les ressources et initiatives déjà existantes ayant comme objectifs de répondre à ces besoins. Pour réaliser ce portrait plus spécifique de la région du Québec auquel se destine l’initiative du Limier Voyageur, soit la région de Chaudière-Appalaches, une triangulation de plusieurs sources d’informations a été effectuée, dont plusieurs sources statistiques produites par des instances gouvernementales ou organismes locaux, dont PRÉCA. Une autre étape méthodologique importante consiste à documenter l’ensemble du processus d’élaboration et de déploiement de l’initiative mise en place, ici le Limier Voyageur, entre autres pour en identifier les principales étapes, le résultat final de celles-ci et les leviers et obstacles rencontrés. Pour documenter de la sorte le processus de conception, la tenue d’un journal de bord s’est avérée cruciale ; elle a permis de documenter l’ensemble des actions posées et les traces en découlant (essentiellement des notes descriptives ou réflexives et des photographies). De même, les premières phases de déploiement dans le milieu de l’initiative du Limier Voyageur ont elles-aussi été documentées afin d’entreprendre une première analyse exploratoire des forces et limites des actions qui y sont liées en matière de promotion de la lecture. En plus d’un journal de bord grâce auquel il est possible de noter des observations de terrain et des réflexions en découlant, de très nombreuses photographies et vidéos comme sources d’observations ethnographiques (Montesinot-Gelet et al., 2015) ont été produites pendant les premières interventions réalisées dans les milieux ciblés, au cours des années 2022, 2023 et 2024. De même, des entretiens semi-dirigés à la fin des étés 2023 et 2024 ont aussi été menés avec les étudiant·es engagé·es comme intervenant·es du Limier Voyageur. Ces entretiens visaient principalement à connaitre leurs perceptions de l’accueil réservé à l’initiative par les publics visés et leurs observations quant aux limites ou obstacles rencontrés.
L’ensemble de ces traces et leur analyse qualitative de contenu (Paillé et Mucchielli, 2021) constituent les données sur lesquelles s’appuient la documentation du cas du Limier Voyageur et les premières analyses exploratoires en termes de résultats.
4. Résultats et discussion
Cette dernière section de l’article est consacrée aux résultats et à une première mise en perspective de ceux-ci.
Dans la première partie, ce qui caractérise le Limier Voyageur comme initiative de promotion de la littératie est détaillé, puisqu’il s’agit en soi du résultat de la réflexion menée. Décrire ainsi l’initiative mise en place assure l’intelligibilité au plus grand nombre. Pour ce faire, une description objective axée sur des caractéristiques centrales du projet (Karsenti et Demers, 2011) est proposée.
À la suite de cette partie plus descriptive, des observations préliminaires au regard des actions jusqu’à présent menées par le Limier Voyageur sont mises en lumière et discutées, entre autres pour circonscrire les bonifications à apporter au projet et les objectifs à poursuivre pour l’avenir, au regard de l’accueil jusqu’à présent réservé à l’initiative, des bienfaits qui lui sont reconnus et des limites ou obstacles observés de manière exploratoire.
Les données récoltées à propos du processus de création de l’initiative du Limier Voyageur, qui prend appui sur un engagement à la fois citoyen (donc plus personnel) mais aussi universitaire (puisque l’initiatrice est une professeure-chercheure) seront présentées et discutées dans un article à venir, notamment pour mettre en lumière les leviers (ou facilitateurs) de l’innovation sociale en matière de littératie et les freins ou obstacles à sa mise en œuvre et à son déploiement au Québec.
4.1. Le Limier Voyageur : une initiative citoyenne et universitaire de promotion de la littératie en milieu rural
L’initiative du Limier Voyageur, née en 2022, est un prolongement mobile et citoyen du regroupement universitaire du LIMIER, un acronyme à la signification suivant : Littératie Illustrée : Médiathèque, Interventions en Éducation et Recherche. Ce regroupement de recherche a été cofondé il y a maintenant plus de 15 ans par deux professeur·es chercheur·es en sciences de l’éducation de l’UQAR (Jean-François Boutin et Virginie Martel) préoccupé·es de l’apport éducatif et social des œuvres illustrées (albums de fiction ou documentaires, bandes dessinées, romans illustrés, etc.). Il regroupe aujourd’hui des chercheur·es et des intervenant·es divers·es, œuvrant dans le monde de l’éducation, sensibles aux enjeux éducatifs et citoyens liés à la littératie, plus particulièrement à l’acquisition et à la consolidation de compétences nécessaires à l’interprétation et à la production de messages visuels (Lebrun, 2015). Une large diffusion scientifique et professionnelle est issue des nombreux projets de recherche menés par les différent·es chercheur·es et collaborateur·rices du LIMIER. Ceux·lles-ci sont aussi activement impliqué·es en formation initiale et continue.
Plus spécifiquement, l’initiative du Limier Voyageur est née de l’idée de partager hors des murs de l’université et des écoles la vaste collection de livres de la médiathèque du LIMIER et l’expertise acquise au fil des années en matière de promotion de la lecture. Elle incarne le rêve d’un engagement citoyen permettant d’explorer les possibles en dehors du cadre scolaire, avec et pour des populations en situation de vulnérabilité ou à risque établies sur le territoire desservi par l’UQAR. À cet effet, tous les publics présentant des besoins sont visés, dont les enfants en bas âge, les enfants et les adolescent·es pendant l’année scolaire et les vacances scolaires, les adultes, les personnes immigrantes nouvellement installées dans la région de Chaudière-Appalaches et les personnes âgées.
Au centre de cette initiative, une vision : des livres qui voyagent d’un espace éphémère à l’autre pour favoriser et promouvoir la lecture et l’échange. À cet égard, le Limier Voyageur s’inscrit dans le courant des bibliothèques mobiles et des espaces éphémères de lecture grâce auxquels les livres vont à la rencontre de publics variés, au cœur des lieux que ceux-ci occupent (Dorance, 2009). En concertation avec des partenaires locaux, le Limier Voyageur souhaite multiplier sur le territoire de Chaudière-Appalaches des occasions de médiation et de découverte des livres, plus particulièrement les œuvres illustrées dans lesquelles l’image (illustrations, photographies, graphiques, figures, etc.) occupe une place centrale et contribue à la compréhension de l’information écrite. En tant qu’initiative affiliée à une institution universitaire (UQAR), le Limier Voyageur souhaite aussi contribuer à l’avancement du savoir en matière notamment d’interventions favorables au développement de la littératie en milieu rural.
4.1.1. Les formules et volets d’intervention du Limier Voyageur
Les interventions et les activités du Limier Voyageur sont organisées autour de trois formules (Figure 5), chacune de ces formules pouvant atteindre des publics divers selon les volets d’intervention ciblés qui couvrent des besoins variés en matière de littératie : volet jeunesse/famille ; volet adolescent·es/jeunes adultes ; volet adultes ; volet ainé·es ; volet population immigrante.

La formule tout inclus repose sur une bibliomobile, soit un Vanagon du nom de Jack qui a été acheté (avec l’argent personnel de l’initiatrice du projet – Virginie Martel) et aménagé pour les besoins du projet (lettrage et espaces de rangement pour les livres). La biblimobile du Limier Voyageur circule depuis le printemps 2023 d’une municipalité à l’autre selon la demande et les besoins ciblés, afin de faire lire et découvrir des œuvres illustrées à petit·es et grand·es, en dedans et autour de Jack (Figures 6, 7, 8 et 9).




La formule campement, mise en place dès l’été 2022, repose sur la création, sans la bibliomobile, d’espaces éphémères de lecture (extérieurs ou intérieurs) dans lesquels il est possible de venir lire sous une tente, dans un hamac, sur un tapis, etc., seul·e ou en groupe, avec ou sans animations littéraires (Figures 10, 11 et 12). Ces espaces éphémères de lecture peuvent être organisés autour de thématiques précises (par exemple, l’éducation par les livres aux perspectives autochtones ou aux réalités de l’immigration et de l’intégration) ou viser l’objectif plus général de présenter la diversité des thèmes couverts par les œuvres illustrées.



Enfin, la formule randonnée repose sur des personnes (voyageur·ses) bénévoles – généralement des étudiant·es de l’UQAR – qui, un sac à dos rempli d’œuvres illustrées, voyagent en toute saison et selon les occasions à la rencontre de publics variés pour promouvoir la lecture et la découverte des livres illustrés ; par exemple, lors d’une visite familiale en région ou lors d’une visite dans une maison de retraite.
4.1.2. Les actions menées par le Limier Voyageur
Plusieurs activités de diffusion (communications professionnelles ou scientifiques et publications) ainsi que la présence du Limier Voyageur sur les réseaux sociaux (@limier_voyageur) et parfois les médias (Le Devoir, 2023 ; UQAR info, 2023 ; Communication Jeunesse, 2023 ; Initiatives Médias, 2024 ; Images et mots, 2024) offrent une visibilité aux différentes actions menées par le Limier Voyageur.
Dès sa mise en œuvre progressive à l’été 2022, en collaboration entre autres avec une initiative citoyenne comparable de promotion de la lecture (caravane littéraire), grâce aussi à un soutien financier de démarrage offert par la Fondation de l’UQAR, le Limier Voyageur a mis en place des dizaines d’activités de promotion de la lecture basées principalement sur la création d’espaces éphémères de lecture et l’exploration par des publics variés (principalement des familles et des enfants) de centaines d’œuvres illustrées. Depuis l’été 2022, de tels espaces doublés généralement d’animations littéraires ont été proposés dans différents lieux de la région de Chaudière-Appalaches (parcs, centres des loisirs, stationnements à proximité d’un lieu public, terrains scolaires et maisons de retraite). À partir de l’été 2023, les interventions du Limier Voyageur se sont multipliées avec entre autres la mise en service de la bibliomobile (Jack) et l’embauche d’étudiant·es permettant d’accroitre le nombre d’interventions. L’initiative étant progressivement connue dans la région de Chaudière-Appalaches, les demandes de partenaires locaux se sont aussi multipliées, d’autant que toutes les interventions réalisées par le Limier Voyageur sont gratuites. À l’été 2023, par exemple, la bibliomobile a ainsi participé, sous invitation, à l’offre d’activités en lecture pour l’événement annuel Lévis interculturelle et les Journées de la culture dans la MRC L’Islet-Sud. De telles participations se sont poursuivies en 2024, avec l’ajout d’interventions en milieux scolaires isolés ou à risque (principalement auprès d’élèves en adaptation scolaire et sociale, en éducation aux adultes et en francisation)13.
Depuis l’été 2023, c’est toutefois la responsabilité du programme de promotion de la lecture pendant les vacances scolaires (le programme Lit de camp) dans des MRC de Chaudière-Appalaches qui est centrale au regard des actions menées (Figures 13, 14 et 15). Ce programme déployé à la grandeur du Québec vise à favoriser l’accès aux livres pendant l’été et la mise en place d’animations et d’activités de lecture dans les camps d’été afin de réduire chez les 6-12 ans la perte des acquis scolaires en littératie pendant la saison estivale. À l’été 2023, en collaboration et avec le soutien de PRÉCA, l’équipe du Limier Voyageur (composée de l’initiatrice du projet et de trois étudiant·es salarié·es en éducation) a dans ce contexte mis en place plus de 50 espaces éphémères de lecture dans les camps participants (avec ou sans la bibliomobile), en plus de réaliser près de 300 animations littéraires auprès de 135 groupes d’enfants de 29 camps différents. Ces interventions ont été documentées et discutées dans deux articles déjà parus (Martel et al., 2024 ; Martel, Garceau-Bolduc et Lessard, 2023). Pour l’été 2024, l’expérience s’est poursuivie avec une prise en charge complète du programme Lit de camp pour quatre MRC de la région de Chaudière-Appalaches n’ayant aucun autre organisme local disposé à en prendre la responsabilité. De nouveau, des dizaines d’activités de promotion de la lecture ont été proposées aux 42 camps sous la responsabilité de l’équipe du Limier Voyageur (l’équipe 2024 étant composée de l’initiatrice du projet et de 4 étudiant·es). En plus des espaces éphémères offerts à tous·tes, 21 camps (pour un total de 93 groupes d’enfants) ont reçu la visite de la bibliomobile du Limier Voyageur au cours de l’été 2024. Pour chaque groupe, une période de lecture interactive a été proposée suivie d’un moment d’exploration et de lecture dans et autour de la bibliomobile. En complément, l’équipe du Limier Voyageur a aussi soutenu les camps participants au programme dans la mise en place de coins-lecture permanents et la préparation de défis ludiques de lecture estivale.



4.2. Observations préliminaires
Bien que l’initiative du Limier Voyageur en soit à ses premiers pas et qu’il demeure difficile de prendre à ce stade-ci une distance critique, quelques observations préliminaires tirées des données liées à la démarche de documentation réalisée jusqu’à aujourd’hui sont, dans ce qui suit, présentées. Ces observations permettent de poser une première réflexion quant à l’accueil réservé à l’initiative et aux bienfaits qui semblent lui être associés ; elles permettent aussi de mettre en lumière les limites ou obstacles jusqu’à présent rencontrés au regard des objectifs poursuivis, que nous rappelons ici : participer aux actions mises en œuvre au Québec, plus particulièrement dans la région de Chaudière-Appalaches, pour réduire les enjeux de littératie des personnes en situation de vulnérabilité, favoriser l’accessibilité à la lecture et, ultimement, favoriser l’égalité des chances.
4.2.1. Un accueil chaleureux prometteur
Il faudra, dans les années à venir, formaliser l’étude des différentes actions menées par le Limier Voyageur pour vraiment en saisir toutes les retombées et limites. La voix de ceux·lles à qui se destinent les actions réalisées par le Limier Voyageur devra, pour ce faire, être absolument davantage prises en compte et documentées rigoureusement. De même, il serait opportun de déployer des dispositifs méthodologiques permettant d’évaluer rigoureusement les retombées des interventions du Limier Voyageur sur les compétences de littératie chez les publics visés et leur rapport à la lecture. Déjà, des démarches de recherche en ce sens s’organisent. Dans l’état actuel toutefois, ce sont les observations préliminaires de terrain réalisées par l’équipe du Limier Voyageur (notées dans nos journaux de bord ou explicitées lors d’entretiens-bilans) qui permettent de poser un premier regard interprétatif et critique quant à la réception perçue du projet par les publics visés et ses possibles bienfaits.
D’entrée de jeu, les indices, nous permettant de croire à l’intérêt soulevé par l’initiative, sont nombreux. La participation engagée des publics visés ou rencontrés, leur appréciation visible des activités offertes ou leur appréciation justifiée lors des discussions informelles qui se tiennent pendant les interventions du Limier Voyageur ou après-coup sur les réseaux sociaux ou courriels laissent croire à un réel intérêt. Les demandes de plus en plus nombreuses d’interventions du Limier Voyageur dans plusieurs milieux qui ont eu écho de ses activités témoignent aussi de cet accueil positif. Sourires et rires, moments forts d’émotions, rencontres humaines inspirantes, échanges authentiques autour des livres mis à disposition sont autant d’indicateurs de cet accueil positif, voire des bienfaits qu’on peut y associer. Des enfants demandent que la bibliomobile revienne plus souvent les voir ou reste plus longtemps ; des parents se disent surpris·es de voir leurs enfants lire sans obligation scolaire ; des adolescent·es de milieux isolés se disent touché·es que l’équipe du Limier Voyageur se soit déplacée juste pour eux ; de jeunes adultes immigrant·es récemment arrivé·es au Québec sont reconnaissant·es d’avoir pu découvrir des livres avec des images destinés à des adultes, ce qui augmente, nous ont dit certain·es, leur confiance pour se lancer dans la lecture de livres francophones ; des élèves à l’éducation aux adultes se disent heureux de pouvoir découvrir autant de bandes dessinées et d’albums illustrés sur des sujets qui les intéressent vraiment ; des adultes et des ainé·es s’engagent dans la lecture d’albums illustrés qu’ils croyaient à tort réservés aux enfants et il·elles en sortent profondément ému·es, voire bouleversé·es (extraits des journaux de bord 2023 et 2024).
Lors des entretiens-bilans réalisés à la fin des deux dernières années, les étudiant·es qui composent en grande partie l’équipe du Limier Voyageur témoignent aussi de cet accueil « vraiment positif » (extrait entretien 2023 – Karine), « de l’effet wow que provoque l’arrivée de la bibliomobile auprès particulièrement des enfants » (extrait entretien-bilan 2024 – Flavie). Ils témoignent aussi des situations uniques vécues pendant les interventions du Limier Voyageur comme « ces nombreuses fois où des enfants décident spontanément de lire à haute voix aux plus petits ou aux ami·es moins compétent·es en lecture » (extrait entretien 2023 – Flavie), cette autre fois « où une petite fille qui venait tout juste d’arriver d’Ukraine a lu pour la première fois avec nous, grâce à la portée de sens des images, un livre produit au Québec », et cette fois où des « enfants lisant dans le coffre de la bibliomobile ont dit que c’était le plus beau jour de leur vie et qu’ils n’avaient jamais vu d’aussi beaux livres » (extraits entretien-bilan 2024 – Alex). Les étudiant·es de l’équipe du Limier Voyageur témoignent aussi de leurs observations personnelles quant à l’appréciation des publics adultes qui « malgré leur gêne initiale à approcher nos espaces de découverte et de lecture restent finalement longtemps avec nous, posent des questions, évoquent leur rapport à la lecture souvent difficile, explorent les livres avec notre aide et finissent parfois par s’installer pour lire un livre de leur choix » (extrait entretien 2023 – Andréa). « Certains aussi ne s’approchent de nous que pour poser des questions sur le vieux Vanagon et demandent s’ils peuvent s’asseoir à l’intérieur de Jack et c’est o.k. C’est un premier contact avec le Limier Voyageur et cela permet des rencontres humaines essentielles à tous » (extrait entretien 2024 – Flavie).
4.2.2. Des obstacles et des limites
Bien que l’accueil réservé à l’initiative du Limier Voyageur par les publics visés soit positif et que déjà des bienfaits se dessinent (notamment en ce qui a trait au sentiment de compétence en lecture et au rapport à la lecture et aux livres), des obstacles ou limites s’observent.
En premier lieu, l’importance des besoins en matière de littératie sur le territoire couvert, la grandeur dudit territoire et le nombre de communautés isolées qui le composent constituent des enjeux de taille. Malgré les nombreuses interventions menées, une large part des besoins et des publics ciblés ne sont pas pris en compte. À certains moments de l’année, pour couvrir seulement toutes les demandes actuellement formulées auprès du Limier Voyageur, il faudrait plus d’une bibliomobile sur les routes et une équipe d’intervention composée d’un plus grand nombre de personnes. Considérant toutefois que le projet depuis ses débuts rencontre des enjeux de financement (une limite importante), un tel déploiement parait difficile14.
Malgré l’intérêt reconnu aux actions jusqu’à présent réalisées par le Limier Voyageur, celles-ci, étant donné leur dimension « éphémère », restent de surcroit limitées dans le temps (un moment dans la vie des publics visés) et l’espace (un lieu à la fois, avec l’impossibilité de couvrir tous les lieux). Dans les journaux de bord où sont archivés des extraits de discussions informelles ou des résumés de celles-ci, on trouve des indicateurs de cette limite temporelle et spatiale : « c’est plate que vous passiez seulement une fois au village » (extrait journal 2024) ; « une femme nous a mentionné qu’il était dommage que nous ne venions pas au village d’où vient son chum où les gens se sentent abandonnés. Il faudrait y aller » (extrait journal 2023) ; « un groupe d’ados nous a dit qu’il faudrait revenir au moins à chaque semaine pour créer une habitude d’activités dans et autour de Jack » (extrait journal 2024).
Il a aussi été observé qu’il était préférable de mener les interventions du Limier Voyageur dans le cadre d’activités plus larges mobilisant d’entrée de jeu les populations locales visées. Il est, par exemple, plus efficace en termes d’attrait de déployer la bibliomobile lors de la tenue d’un événement public (festival, fête communautaire ou de village, tournoi, etc.), qui favorise la présence de personnes susceptibles de s’intéresser à l’offre d’activités. Il est aussi préférable de cibler des lieux précis (maisons de retraite, maisons de jeunes, écoles, carrefours emploi jeunesse, etc.) dans lesquels la venue du Limier Voyageur est annoncée, voire médiatisée par des partenaires locaux, ce qui contribue à une plus forte participation. Au contraire, les expériences spontanées de déploiement de la bibliomobile ou d’espaces éphémères de lecture dans des endroits plus anonymes (dans un parc ou dans le stationnement d’une église, par exemple) restent beaucoup plus limitées en termes d’attractivité. Lors de telles expériences, surtout celles réalisées dans les communautés rurales dites dévitalisées (Ouellet, 2021a ; 2021b), il est arrivé que personne ne se présente, ou très peu. Les personnes qui l’ont fait ont exprimé leur gêne initiale (« un homme a affirmé qu’il ne savait pas trop s’il avait le droit de venir nous voir » – extrait journal de bord 2023), certaines restent très peu longtemps (« deux femmes se sont présentées, elles pensaient qu’elles pouvaient acheter des livres ; elles n’étaient pas intéressées à les lire sur place » – extrait journal de bord 2024) et d’autres ne comprennent pas les motifs de la présence de la bibliomobile dans leur communauté (« un couple nous a dit que nous perdions notre temps au village, que personne ne savait lire ou n’aimait lire dans le coin » – extrait journal de bord 2024).
Une autre limite observée concerne les livres en eux-mêmes. Malgré tous les efforts réalisés pour offrir la plus grande variété possible d’œuvres illustrées de qualité susceptibles de couvrir les goûts de publics variés, malgré aussi le soin apporté à la sélection des œuvres à mettre de l’avant selon les occasions et les groupes visés, toutes les interventions du Limier Voyageur sont confrontées à au moins une déception : « des enfants étaient déçus aujourd’hui de ne pouvoir consulter des albums sur les fées, d’autres cherchaient des mangas qu’ils connaissaient » (extrait journal de bord 2023) ; « les élèves d’aujourd’hui en adaptation scolaire et sociale auraient voulu que nos documentaires jeunesse soient composés de plus de photographies ; ils ont dit ne pas aimer les documentaires avec des illustrations » (extrait journal de bord 2024) ; « un homme nous a demandé Le guide de l’auto de l’année ou des revues sur la chasse et pêche » (extrait journal de bord 2024). Certain·es, moins nombreux·ses toutefois, expriment aussi leur désappointement de ne pouvoir explorer des livres sur des outils numériques, par exemple des livres audio (« c’est mieux pour moi parce que j’ai des problèmes de vision » – extrait journal de bord 2023), des livres en format PDF pouvant être lus sur un écran ou des livres augmentés, voire interactifs (« ceux-là, j’aime les lire » – extrait journal de bord 2024).
Enfin, un dernier obstacle à mettre en lumière concerne la peur exprimée par certains organismes que le Limier Voyageur agisse en compétition avec des initiatives déjà présentes au sein des milieux ciblés.
4.3. Pour la suite des choses
Afin de consolider l’accueil positif que reçoit jusqu’à présent l’initiative du Limier Voyageur et tabler sur les premiers bienfaits qui paraissent y être associés, selon les observations préliminaires, il semble opportun de poursuivre, voire de multiplier, les actions menées pour favoriser l’accès aux livres en milieu rural et la promotion de la lecture. Pour ce faire toutefois, les limites ou obstacles observés et mis en lumière doivent être pris en compte pour en réduire les effets.
À cet égard, il serait souhaitable pour la suite des choses d’élargir le travail de concertation et de collaboration pour assurer un déploiement encore plus complet et signifiant des trois formules d’intervention du Limier Voyageur, et cela au regard des besoins précis de publics variés et des initiatives locales déjà en place. Dans une société où le numérique occupe une place de plus en plus importante, il serait aussi pertinent d’intégrer à l’offre d’activités la littératie numérique et les œuvres illustrées proposées sur écran. En tant qu’initiative affiliée à un regroupement universitaire (le LIMIER), il importe également de poursuivre la documentation des actions menées et leur étude dans une perspective de recherche, voire de penser un programme complet de recherche. Ultimement, il est aussi impératif d’assurer la pérennité de l’initiative en poursuivant la recherche de financement et de partenaires. Dans ce qui suit, les trois premiers objectifs ciblés sont détaillés.
4.3.1. Poursuivre le développement des actions menées en concertation avec les milieux
Les premières années de la mise en œuvre du Limier Voyageur ont surtout permis de contribuer à l’offre d’activités en littératie destinées aux enfants (principalement dans les camps d’été) et aux familles de passage dans les différents espaces éphémères proposés dans les lieux publics. Très récemment, depuis le printemps 2024, des interventions auprès d’adolescent·es et de jeunes adultes dans les milieux scolaires ruraux isolés ou dans les centres d’éducation aux adultes de la région de Chaudière-Appalaches se sont ajoutées aux actions mises en œuvre. Cet ajout récent, qui est à poursuivre, est essentiel, car les besoins sont très nombreux en matière de littératie chez les adolescent·es et les jeunes adultes (PRÉCA, 2023b), de même que chez les adultes en situation de vulnérabilité (pauvreté économique et sociale). Si l’on se fie aux différentes demandes d’aide qui nous ont été récemment faites, les besoins en soutien au développement et à la promotion de la littératie sont aussi criants en contexte de francisation.
Ayant à cœur de mener des actions permettant de toucher à l’ensemble de la population de la région de Chaudière-Appalaches en besoin, il est primordial de multiplier les interventions ciblées en fondant cette multiplication sur un partenariat plus étroit avec des organismes ou ressources de proximité. Il semble aussi essentiel de travailler davantage pour et surtout avec les individus des communautés ou groupes ciblés, notamment pour repenser, comme l’exposent Dufour et al. (2021), les approches traditionnelles et atteindre davantage des populations socialement exclues ou marginalisées par rapport au groupe majoritaire. En travaillant davantage en concertation avec des partenaires locaux (municipalités, organismes ou citoyen·nes engagé·es) et les personnes auxquelles se destinent les actions du Limier Voyageur, nous serons plus à même d’identifier les enjeux et besoins prioritaires de milieux donnés sur lesquels agir. Une telle concertation enrichie permettrait aussi de rechercher, ensemble, les meilleures stratégies de déploiement des actions à privilégier pour couvrir les besoins qui ne sont pas pris en compte, agir là où des initiatives complémentaires sont nécessaires et assurer la meilleure participation possible des publics visés. Ultimement, une telle approche collaborative pourrait en plus contribuer à la capacité de collectivités à mobiliser à propos de la littératie communautaire une diversité d’intervenant·es autour de personnes en besoin (Beauregard et al., 2011).
Pour ce faire, les actions et travaux du Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural, qui accorde une place centrale aux personnes aux prises avec les réalités sociales étudiées et qui s’intéressent aux expertises des personnes en situation de pauvreté en milieu rural (AVEC), sont inspirants, d’où l’adhésion récente de l’initiatrice du Limier voyageur au sein dudit collectif.
4.3.2. Intégrer à l’offre du Limier Voyageur le numérique
Alors que le numérique et le recours aux technologiques ne cessent de se développer et d’occuper toutes les sphères ou presque de la vie, il est impératif de se préoccuper du développement des compétences en littératie numérique, qui concerne entre autres la communication et le traitement critique de l’information en contexte numérique et la compréhension de l’impact des technologies dans le monde (Lacelle, Lebrun et Boutin, 2017).
Bien que le Limier Voyageur ne poursuive pas une mission spécifique au développement des compétences numériques (d’autres initiatives le font), il semble opportun dans les activités (ou du moins, certaines activités) de promotion de la lecture d’intégrer des œuvres littéraires ou documentaires numériques (donc, consultables sur un outil technologique). Plusieurs œuvres littéraires numériques québécoises destinées à un lectorat adulte sont répertoriées dans le catalogue des œuvres littéraires numériques (COLIN), alors que des œuvres de fiction ou documentaires destinées à la jeunesse sont répertoriées par le Laboratoire virtuel québécois de l’édition et de l’éducation aux œuvres numériques pour la jeunesse (LAB-YRINTHE) dans lequel d’ailleurs l’initiatrice du Limier Voyageur est investie comme co-chercheure. En parallèle, les œuvres en format audio, comme celles disponibles sur la plateforme québécoise NARRA ou les balados pour enfants produits ou diffusés par l’organisme LA PUCE À L’OREILLE pourraient aussi être mobilisés dans des activités du Limier Voyageur visant spécifiquement la découverte et la promotion des œuvres numériques.
Pour développer de telles activités, des collaborations avec Lab-yrinthe, Narra et La puce à l’oreille par exemple, sont à envisager, tout comme l’acquisition des outils et supports technologiques nécessaires. Il pourrait aussi être intéressant de mobiliser des étudiant·es au deuxième ou au troisième cycle pour s’engager dans le cadre de leurs études supérieures dans la réflexion à mener. Un projet de postdoctorat est à cet égard en cours de planification.
4.3.3. Déployer un programme de recherche
En tant qu’initiative affiliée au milieu universitaire, il convient que le projet du Limier Voyageur contribue à la production de savoirs en ce qui a trait entre autres aux enjeux liés à l’élaboration d’une innovation sociale en matière de littératie, aux enjeux de littératie dans les milieux ruraux et aux interventions favorables au maintien, au développement et à la consolidation des compétences de littératie auprès de divers publics de ces milieux. Puisque l’accès à la culture et, plus particulièrement, l’accès aux livres sont reconnus par l’UNESCO (2021) comme une condition de réduction des inégalités en matière de littératie, il importe aussi de documenter les retombées des dispositifs éphémères d’accès aux livres et à la lecture offerts par le Limier Voyageur. Pour ce faire, il serait notamment pertinent de s’intéresser aux apports et aux limites de ce caractère éphémère d’intervention qui sous-tend, en partie du moins, une position de lecteur·rice éphémère (Dire, Gast et Paillet, 2017). Dans quelle mesure et à quelles conditions de tels dispositifs peuvent-ils produire un changement d’attitudes et de comportements individuels, agir sur les compétences en littératie et le rapport aux livres, participer à l’instauration d’un changement significatif dans les collectivités et, ultimement, contribuer à la réduction des inégalités ?
Déjà, pour contribuer au développement du savoir et répondre à ces questions, l’équipe du Limier Voyageur s’est engagée dans une démarche rigoureuse de documentation de son déploiement et de ses actions. Elle s’engage aussi actuellement dans une démarche de recherche intervention dans laquelle les chercheur·es sont appelé·es à s’impliquer dans une amélioration transformatrice documentée (Richard, à paraitre). La recherche participative, en collaboration entre autres avec le Collectif de recherche participative sur la pauvreté en milieu rural, est aussi une avenue actuellement explorée, entre autres parce qu’elle permettrait de favoriser la collaboration directe avec les personnes concernées par les enjeux de littératie (communautaire). Des projets intersectoriels de recherche sont aussi en cours de réflexion, notamment parce qu’ils permettent de travailler dans la perspective d’une approche de type écosystémique (Larose et al., 2004 ; Pithon, Asdih et Larivée, 2008) visant l’éducation pour tous·tes, mais aussi parce que la pratique intersectorielle peut apporter une contribution significative pour solutionner des enjeux complexes en milieu rural (Richard et al., 2021). À cet égard, un projet de collaboration avec la professeure-chercheure Julie Richard du département de psychosociologie et travail social de l’UQAR est en cours de réflexion. En alliant le studio itinérant aménagé dans un Westfalia de la professeure Richard (à paraitre) et la bibliomobile du Limier Voyageur, il est envisagé d’intervenir auprès des jeunes adultes marginalisé·es de milieux ruraux ou éloignés afin qu’il·elles puissent témoigner de leur vécu dans le studio mobile et vivre dans et autour de la bibliomobile des activités positives autour de livres illustrés trouvant écho à leurs préoccupations. D’autres projets intersectoriels à venir, qui s’intéressent entre autres au développement des compétences de littératie numérique, impliquent des membres de l’équipe en littératie médiatique multimodale (Équipe LMM). Enfin, un autre projet collaboratif concerne une nouvelle équipe multidisciplinaire en émergence dirigée par la psychologue et professeure-chercheure Catherine Malboeuf-Hurtibise ; cette équipe dont fait partie l’initiatrice du Limier Voyageur s’intéresse au recours aux arts et à la culture en éducation pour, entre autres, préparer à la vie citoyenne.
Conclusion
L’initiative du Limier Voyageur, en tant qu’innovation sociale en matière de littératie en milieu rural, place l’accès aux livres et la promotion de la lecture au cœur de ses missions afin de participer à la multiplication des situations de contact avec l’écrit hors de l’école (Dezutter, Babin et Lépine, 2018).
Ses actions s’inscrivent dans la reconnaissance que la lecture a un pouvoir transformateur ; elle est un acte fondamentalement humain, elle peut être un rempart contre l’isolement et l’exclusion, en plus d’être vecteur de développement et consolidation des compétences de littératie (Barguidjian, 2024 ; Larochelle, 2024). Les livres, dans la variété de leurs formes et de leurs contenus, peuvent et doivent être mobilisés dans des contextes variés et auprès de publics aux besoins multiples.
Le Limier Voyageur s’appuie sur cette mobilisation des livres et leur accès (grâce à des dispositifs de mobilité) au cœur des territoires où vivent les populations, même celles qui sont plus isolées, comme plusieurs communautés rurales en milieux dévitalisés (Ouellet, 2023). L’initiative met ainsi de l’avant des actions itinérantes ou ambulantes qui tablent sur des interventions de proximité, en se souvenant que les pratiques culturelles des populations sont étroitement liées à la proximité des espaces ou des ressources (Dick, Jeanotte et Hill, 2019). Les actions menées (et à venir) se veulent une forme de réponse aux enjeux de littératie et d’accès aux livres pour tous·tes dans des endroits où il est parfois impossible d’entretenir un service de bibliothèque fixe ou d’autres services de promotion de la lecture et, plus largement, de la culture ; elles permettent de moduler l’offre par rapport aux goûts et aux besoins de groupes ou communautés donnés (Dorance, 2015).
Dans cet article, la genèse de cette initiative prenant appui sur des besoins, sur un désir d’engagement et des fondements théoriques a été explicitée. Une première démarche d’analyse critique a aussi été réalisée sur la base d’observations préliminaires mises en saillie. Les actions à mener, tant dans les milieux visés qu’en recherche, demeurent cependant nombreuses. Fort heureusement, cet article et d’autres réflexions à venir en posent les bases.
- Dans certaines MRC, plus de 30 % des résidant·es âgé·es de 15 ans et plus sont sans diplôme supérieur, alors que la moyenne québécoise est établie à 18,2 % (Langlois, 2021). ↩︎
- Cet indice s’appuie sur trois indicateurs, qui représentent chacun une dimension essentielle de la vitalité économique d’un territoire, soit : le marché du travail (taux de travailleur·ses de 25 à 64 ans) ; le niveau de vie (revenu médian de la population de 18 ans et plus) et le dynamisme démographique (taux d’accroissement annuel moyen de la population sur une période de 5 ans). ↩︎
- Soit des indices de défavorisation forts, selon le ministère de l’Éducation. ↩︎
- La moyenne québécoise était de 93,71 $ par habitant·e la même année. ↩︎
- Le phénomène de la dévitalisation des communautés rurales a été défini par le géographe Clermont Dugas en 1991. Il en donne la définition suivante : la dévitalisation peut être définie comme un processus qui entraine une diminution progressive et quelquefois rapide de l’activité socioéconomique d’une entité spatiale donnée et dont les effets se font sentir au niveau de la démographie, de l’occupation du sol, de l’habitat, de l’infrastructure des services, de la qualité de vie et des perspectives d’avenir. (p. 3) Au Québec, plus de 150 municipalités – réparties dans plus de 45 MRC et 14 régions (Proulx, 2010) – seraient reconnues comme dévitalisées. D’autres municipalités ne faisant pas partie de la liste ont également perdu la quasi-totalité de leurs services de proximité (Boily, 2020). ↩︎
- Les régions métropolitaines de recensement (RME) sont considérées comme les zones les plus urbanisées de la province de Québec. Elles sont au nombre de six : Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Gatineau et Saguenay. ↩︎
- L’agglomération de recensement (AR) doit avoir un noyau d’au moins 10 000 habitants·e. Le Québec en contient 25. ↩︎
- Le rôle de la communauté est aussi reconnu dans la plus récente Politique sur la réussite éducative du Québec et la stratégie qui lui est rattachée (MEES, 2017, 2018) qui « interpelle les acteurs communautaires dans l’accompagnement des parents et des milieux éducatifs à la mise en œuvre d’une véritable communauté éducative » (Dufour et al., 2022). ↩︎
- L’éducation dite formelle est souvent assortie d’une évaluation de l’apprentissage et des compétences acquises ; elle aboutit en général à une reconnaissance des acquis ou à l’obtention d’un diplôme ou d’une certification. ↩︎
- Selon le plus récent portrait national des bibliothèques publiques québécoises, un Québécois sur trois fréquente une bibliothèque, ce qui fait des bibliothèques un service public prisé (Association des bibliothèques publiques du Québec et des membres du Réseau BIBLIO, 2022). ↩︎
- Sans compter ses dérivés : bibliocaisses, les bibliomotos, bibliobateaux, bibliochameaux, etc. (Dorance, 2009 ; Vuilleumier, 2015) ↩︎
- Comme le met en lumière Vuilleumier (2015), dans plusieurs pays, dont le Canada, les véhicules qui servent de bibliothèques mobiles disposent à cet effet d’espaces dédiés aux échanges et animations, en plus d’intégrer les nouvelles technologies. C’est le cas, par exemple, au Québec du BiblioCube de Lévis et des bibliomobiles de l’initiative Livres en fête dans le Bas-Laurent, dont nous avons déjà parlé dans la problématique. ↩︎
- En parallèle, et au-delà de la région de Chaudière-Appalaches, le Limier Voyageur participe aussi depuis l’été 2021 à une école d’été de l’UQAM offerte sur le territoire autochtone d’Odanak visant l’éducation aux perspectives autochtones. À cette occasion, comme lors de formations plus ponctuelles, aussi offertes par l’équipe du Limier Voyageur sur d’autres thématiques dont l’immigration, un espace éphémère de lecture avec médiation composé d’un corpus d’œuvres touchant une thématique donnée est proposé. ↩︎
- À ce jour, le projet du Limier Voyageur a reçu, en 2022, un soutien financier de démarrage de la Fondation de l’UQAR (25 000$) et un soutien de fonctionnement annuel (achats, déplacements, salaires) pour les années 2024 et 2025 de 12 000$, offert par le Pôle de l’enseignement supérieur – Chaudière-Appalaches. Les dépenses liées au programme Lit de camp, dont les salaires des étudiant·es, sont couvertes par PRÉCA, dans le cadre d’une entente de collaboration avec le Limer Voyageur. Toutes les autres dépenses liées au projet, dont la bibliomobile et son entretien, sont actuellement prises en charge de manière personnelle par l’initiatrice du projet, qui offre aussi son temps d’intervention et de coordination (en intégrant une partie de ce temps dans le service aux collectivités de sa fonction de professeure-chercheure). ↩︎
Association des bibliothèques publiques du Québec et des membres du Réseau BIBLIO. Portrait national 2022 des bibliothèques publiques québécoises. https://biblioqualite.ca/telechargement/portrait_national_biblio-qualite_2022_web.pdf
Barguirdjian, M. (2024). On a tous besoin d’histoires. Manifeste.https://www.communication-jeunesse.qc.ca/wp-content/uploads/2019/10/edito_manifestemarie_web3.pdf
Barton, D. et Hamilton, M. (2010). La littératie : une pratique sociale. Langage et société, 3(133), 45-62.
Beauregard, F. Carignan, I. et Létourneau, M.-D. (2011). Recension des écrits scientifiques sur la littératie familiale et communautaire (rapport de recherche). https://depot.erudit.org/dspace/bitstream/003789dd/1/Beauregard_Carignan_MELS_litteratie_familiale.pdf
Bélisle, R. (2006). Socialisation à l’écrit et pluralité du rapport à l’écrit d’acteurs communautaires. Dans R. Bélisle et S. Bourdon (dir.), Pratiques et apprentissage de l’écrit dans les sociétés éducatives (p. 145-172). Presses de l’Université Laval.
Bélisle, R. (2004). Éducation non-formelle et contribution à l’alphabétisme. Ethnologies, 26(1), p. 165–183.
Bélisle, R., Roy, S. et Mottais, É. (2019). Créer et animer des environnements écrits dans la communauté [rapport de recherche]. Université de Sherbrooke, Centre d’études et de recherches sur les transitions et l’apprentissage. http://erta.ca/fr/node/100000400
Boily, E. (2020). Dévitalisation des zones rurales périphériques : l’apport des plateformes collaboratives de sociofinancement. Revue Organisations & territoires, 29(3). https://www.erudit.org/fr/revues/rot/2020-v29-n3-rot07113/1090544ar.pdf
Bourbousson, C. et Richez-Battesti, N. (2023). Caractériser les rôles de l’innovation sociale et de l’innovation responsable dans les initiatives locales de transition : Le cas d’un réseau de tierslieux. Innovations, 72, 35-64. https://doi-org.ezproxy.uqar.ca/10.3917/inno.pr2.015
Brandsen, T., Evers, A., Cattacin, S. et Zimmer, A. (2016), Social Innovation: A Sympathetic and Critical Interpretation. Dans T. Brandsen, S. Cattacin, A. Evers, A. Zimmer (dir.), Social Innovations in the Urban Context (pp. 3-18), International Publishing.
Brossard, M. (2001). Situations et formes d’apprentissage. Revue suisse des sciences de l’éducation, 23(3), p. 423-438.
Brougère, B. et Bézille, H. (2007). De l’usage de la notion d’informel dans le champ de l’éducation. Revue française de pédagogie, (158), 117-160. https://journals.openedition.org/rfp/516
Colley, H., Hodkinson, P. et Malcom, J. (2003). Informality and Formality in Learning: A Report for the Learning and Skills Research Centre. Learning and Skills Research Centre, London.
Conseil régional des partenaires du marché du travail. (2022). Les essentiels du marché du travail : la littératie, la numératie et le numérique. https://www.formonsladifference.com/wp-content/uploads/2022/02/guide-multilitte%CC%81ratie-VF.pdf
Conseil supérieur de l’éducation – CSÉ (2013). Un engagement collectif pour maintenir et rehausser les compétences en littératie des adultes. Avis à la ministre de l’éducation, du loisir et du sport et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche, de la science et de la technologie. Gouvernement du Québec. https://www.cse.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2019/11/2013-09-un-engagement-collectif-pourmaintenir-et-rehausser-les-competences-en-litteratie-des-adultes.pdf
Cormier, M. (2017). La littératie, tout au long de la vie. Éducation et Francophonie, 45(2), 1–4. https://doi.org/10.7202/1043525ar
Cyr, A. et Martel, V. (2024). Favoriser la persévérance scolaire par la littératie, un livre à la fois. Journal de Montréal, Mardi, 30 janvier 2024. https://www.journaldemontreal.com/2024/01/30/favoriser-la-perseverance-scolaire-par-la-litteratie-un-livre-a-la-fois
Dagenais, D. (2012). Littératies multimodales et perspectives critiques. Recherches en didactique des langues et des cultures. Les Cahiers de l’Acedle, 9(2), 15-46
Desrosiers, H., Nanhou, V., Ducharme, A., Cloutier-Villeneuve, L., Gauthier, M.-A. et Labrie, M.-P. (2015). Les compétences en littératie, en numératie et en résolution de problèmes dans des environnements technologiques : des clefs pour relever les défis du XXIe siècle. Rapport québécois du Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA).
De Varennes, H. (2017). Réussite en littératie et capital culturel. Éducation et francophonie, 45(2), 214–233. https://doi.org/10.7202/1043536ar
Dezutter, O., Babin, J. et Lépine, M. (2018). Des communautés engagées pour la littératie. Sherbrooke : Collectif CLÉ. https://tinyurl.com/vr7dhjc
Dezutter, O. et Lépine, M. (2020). La littératie, une vision élargie du savoir lire-écrire. Quelles conséquences pour l’enseignement du français ? 33–46. https://doi.org/10.4000/dse.4278
Dick, B, Jeanotte, S. et Hill, K. (2019). Positioning Culture Within Canadian Municipalities. Culture and Local Governance / Culture et gouvernance locale, 6(1), University of Ottawa.
Dire, C., Gast, G. et Paillet, J. (2017). La bibliothèque éphémère : la bibliothèque municipale de Lyon. Rapport de stage collectif. https://inet.cnfpt.fr/sites/default/files/2020-09/Bibliotheque_ephemere_Lyon.pdf
Dorance, S. (2009). Livres en mouvement : mettre en place une bibliothèque mobile. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000182136
Duchesne, C. et Leurebourg, R. (2012). La recherche-intervention en formation des adultes : une démarche favorisant l’apprentissage transformateur. Recherches Qualitatives, 31(2), 3-24.
Dufour, C., Martel, M. D., Lacelle, N., Klamé, S., Garneau-Gaudreault, L.-A. et Poulin., T. (2021). Littératie communautaire : analyse de la production documentaire et revue de la littérature. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 14. https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2021-v14-rechercheslmm06811/1086911ar/
Dugas, C. (2017). Population et structure du peuplement. Dans A. Leblanc et A. Ependa, La ruralité au Québec depuis les états généraux du monde rural (1991) : entre l’action et la recherche, bilan et perspectives. Chaire Desjardins en développement des petites collectivités de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.
Farmer, L. S. J. (2020). Impactful Community-Based Literacy Projects. ALA Editions.
Faucher, A. (2022). Tour guidé des bibliothèques en Chaudière-Appalaches. Mon Thetford, 28 avril 2022. https://monthetford.com/tour-guide-des-bibliotheques-en-chaudiere-appalaches/
Gagnon, Y. C. (2011). L’étude cas comme méthode de recherche. PUQ.
Gouvernement du Québec (2019). Accès au livre et à la lecture partout au Québec – Québec bonifie l’aide financière aux centres régionaux de services aux bibliothèques publiques. Avis publié par le Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse. https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/acces-au-livre-et-a-la-lecture-partout-au-quebec-quebec-bonifie-laide-financiere-aux-centres-regionaux-de-services-aux-bibliotheques-publiques
Gouvernement du Québec (2024). Portrait général Chaudière-Appalaches (région 12). https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/geographie-territoire/regions-administratives/chaudiere-appalaches
Grison, J.-B. et Pradels, N. M. (2022). Les processus d’innovation sociale dans quatre territoires de moyenne montagne non métropolitains : culture territoriale et capacités transformatrices. [Social Innovation Processes in Four Non-Metropolitan Mid-Mountain Areas: Local Culture and Transformative Capacities]. Géographie, Economie, Société, 24(3-4), 363-379. https://doi.org/10.3166/ges.2022.0013
Guimond, L., Simard, M. et Gilbert, A. (2020). Cohabitation et espace de rencontre comme moteurs de la nouvelle ruralité au Québec. Revue Organisations et Territoires, 29(2), 41-53. https://doi.org/10.1522/revueot.v29n2.1149
Guimond, L. et Jean, B. (2021). State of Rural Canada. https://sorc.crrf.ca/quebec/
Gouvernement du Québec (2019). Cadre de référence de la compétence numérique. Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.
Hart, S. A. (2013). Apprentissage formel, informel, non-formel, des notions difficiles à utiliser… pourquoi ? Bulletin de l’OCE : Juin 2013, 4(2). https://oce.uqam.ca/apprentissage-formel-informel-non-formel-des-notions-difficiles-a-utiliser-pourquoi/
Henry, L. A. et Stahl, N. A. (2021). Literacy Across the Community. Routledge.
Institut de la statistique du Québec (2023). Principaux indicateurs sur le Québec et ses régions : Chaudière-Appalaches. https://statistique.quebec.ca/fr/vitrine/region/12
Institut de la statistique du Québec (2015). https://statistique.quebec.ca/en/fichier/no-54-sante-et-competences-en-traitement-de-linformation-des-liens-revelateurs.pdf
Institut de la statistique du Québec (2006). Développer nos compétences en littératie. Un défi porteur d’avenir. https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/developper-competences-litteratie-defi-porteur-avenir.pdf
Intégration Linguistique des Migrants Adultes (ILMA). (2024). Apprentissage formel, non formel et informel : notions clés. https://www.coe.int/fr/web/lang-migrants/formal-non-formal-and-informal-learning
Jean, B., Dionne, S. et Desrosiers, L. (2009). Comprendre le Québec rural. Rimouski, Chaire de recherche du Canada en développement rural. https://revues.uqac.ca/index.php/revueot/article/view/377
Jones, N. (2004). Cream of the Crop: Case Studies of Good Practice in Arts Development in Rural Areas of the North West of England. Arts Council England
Karsenti, T. et Demers, S. (2011). L’étude de cas. Dans B. Gauthier (dir.), La recherche en éducation, ERPI.
Kowalczyk, P. (2015). 10 Most Extraordinary Mobile Libraries. Ebook Friendly. 18 mai 2015. http://ebookfriendly.com/extraordinary-mobile-libraries/
Lacelle, N., Lafontaine, L., Moreau, A. C. et Laroui, R. (2016). Définition de la littératie. Réseau québécois de recherche et de transfert en littératie. https://www.ctreq.qc.ca/realisation/reseau-quebecois-sur-la-litteratie/
Lacelle, N., Boutin, J.-F. et Lebrun, M. (2017). La littératie médiatique multimodale appliquée en contexte numérique. Outils conceptuels et didactiques. PUQ.
Lacelle, N., Lebrun, M., Boutin, J.-F., Richard, M. et Martel, V. (2015). Les compétences en littératie médiatique multimodale au primaire et au secondaire : une grille d’analyse transdisciplinaire. Dans L. Lafontaine (dir.), La littératie : vers une maîtrise des compétences dans divers environnements (163-184). PUQ.
Langlois, P. (2021). La littératie au Québec : un regard local sur les enjeux. Estimation d’un indice de littératie par MRC, Fondation pour l’alphabétisation du Québec. https://fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2023/01/FPAL36_Etude-litteratie-au-Quebec_20230118-2.pdf
Langlois, P. (2022). Projection de l’indice de littératie au Québec en 2022 : un progrès qui met en lumière un enjeu important. Fondation de l’alphabétisation du Québec. https://fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2022/09/FPAL33_AlphaReussite5_Etude_20220907.pdf
Langlois, P. (2023). Estimation d’un indice de littératie par MRC. Fondation de l’alphabétisation du Québec. https://fondationalphabetisation.org/wp-content/uploads/2023/01/FPAL36_Etude-litteratie-au-Quebec_20230118-2.pdf
Larochelle, C. (2024). Lire pour vivre – documentaire. https://www.youtube.com/watch?v=UkIdMPdpTME
Larose, F., Terrisse, B., Lenoir, Y. et Bédard, J. (2004). Approche écosystémique et fondements de l’intervention éducative précoce en milieux socioéconomiques faibles. Les conditions de la résilience scolaire. Brock Education, 13(2), 56-80.
Larson, J., Hanny, C., Duckles, J., Greenwich, J. G., Moses, R., Moses, G., Jones, K. et Smith, J. (2018). Constructing Our Interdependance Model. Dans J. Larson et G. H. Moses (dir.), Community Literacies as Shared Resources for Transformation (p. 20-34). Routledge.
Lebrun, M., Lacelle, N. et Boutin, J.-F. (dir.) (2012). La littératie médiatique multimodale. De nouvelles approches en lecture-écriture à l’école et hors de l’école. PUQ.
Lebrun, M. (2015). La littératie visuelle : genèse, défense et illustration. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 2. https://revuemultimodalites.com/articles/la-litteratie-visuelle-genese-defense-et-illustration
Lenhoff, S. W., Somers, C., Tenelshof, B. et Bender, T. (2020). The Potential for Multi-Site Literacy Interventions to Reduce Summer Slide Among Low-Performing Students. Children and Youth Services Review, 110, 1-8.
Martel, V., Deslaurier-Danjou, G., Lessard, K. et Garceau-Bolduc, F. (2024). Portrait de deux initiatives inédites pour contrer le phénomène de la glissade de l’été ou lire au camp de mille et une façons. Dans R. Roy-Ringuette et I. Montesinos-Gelet, Les livres jeunesse à l’école ou hors les murs : pourquoi, comment et quoi ? Centre de diffusion et de formation en didactique du français de l’Université de Montréal.
Martel, V., Garceau-Bolduc, F. et Lessard, K. (2023). Le Limier Voyageur : des livres sur les routes. Le Pollen, (41), 315-330.
Mayne, J. (2017). Théories du changement : comment élaborer des modèles utiles. Canadian Journal of Program Evaluation / La Revue canadienne d’évaluation de programme, 32(2), 174– 201.
Mercier, J.-P. et Martel, M. D. (2021). La littératie communautaire : explorer les pratiques des acteurs institutionnels au sein des communautés éducatives. Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 14. https://doi.org/10.7202/1086910ar
Montésinos-Gelet, I., Dupin de Saint-André, M. et Bourdeau, R. (2015). Accompagner des élèves en difficulté dans leur appropriation de l’écrit à l’aide de la littérature de jeunesse. Multimodalité(s), 2.
Moreau, C., Hébert, M., Lépine, M. et Ruel, J. (2013). Le concept de littératie en francophonie : que disent les définitions ? Revue Consortium national de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS), 4(2), 14-18. http://www.cnris.org/revue
Moore, D. et Sabatier, C. (2014). Lire et écrire : les liens école-familles-communautés en contextes pluriels. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 17(2), 32-65.
Noguera, F. et Plane, J.-M. (2020). La recherche-intervention : éléments d’épistémologie, de méthode et principes d’action. Dans S. Frimousse et J.-M. Peretti (dir), Produire du savoir et de l’action. Le vade-mecum du dirigeant-chercheur. EMS Éditions, 53-61.
Organisation de coopération et de développement économique – OCDE (2021). Perspective de l’OCDE sur les compétences 2021 : se former pour la vie. Éditions OCDE. https://doi.org/10.1787/fc97e6d3-fr
Ouellet, S. (2023). Littératie, ruralité et développement : mise en œuvre du projet médiathèque. Rapport de recherche – Université du Québec à Rimouski CÉR-122-988. Coll. le LIMIER – La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud. https://www.uqar.ca/app/uploads/2024/06/rapport_litteratie_mise_en_oeuvre_complet.pdf
Ouellet, S. (2021a). Littératie, ruralité et développement : analyse des besoins. Rapport de recherche – Université du Québec à Rimouski CÉR-113-868. Coll. LE LIMIER – La Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud. https://www.mediathequeheritage.com/_files/ugd/574378_42bae8cfd49a462287f9f75345f799c4. pdf
Ouellet, S. (2021b). La littératie en milieu rural dévitalisé. Multimodalité(s), 14. https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2021-v14-rechercheslmm06811/1086914ar.pdf
Ouellet, S. et Martel, V. (soumis). Néoruralité, éducation et culture : une analyse qualitative et intersectorielle des déterminants de la littératie dans une communauté rurale. Multimodalité(s).
Paillé, P. et Mucchielli, A. (2021). L’analyse qualitative en sciences humaines et sociales (5e édition). Armand Colin.
Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches – PRÉCA (2024a). Portrait régional – villes et municipalités. https://www.preca.ca/portrait-regional/ville-municipalites.html
Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches – PRÉCA (2024b). Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Chaudière-Appalaches. https://www.preca.ca/images/Upload/Outils/223/portrait-regional-v_finale.pdf
Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches – PRÉCA (2023a). Portrait de la région de Chaudière-Appalaches. https://www.preca.ca/portrait-regional.html
Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches – PRÉCA (2023b). Fiche portrait des jeunes adultes –Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative en Chaudière-Appalaches 2023. https://www.preca.ca/images/Upload/Outils/478/2023-01-portraits-age-18-29ans-fin.pdf
Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches – PRÉCA (2024c). Pratiques littéraires chez les familles vulnérables en Chaudière-Appalaches. https://www.preca.ca/images/Upload/Outils/616/pratiques_litteraires_chez_les_familles_vulnerables_en_chaudiere-appalaches_-_vf.pdf
Phills, J. A, Deiglmeier, K. et Miller D. T. (2008). Rediscovering Social Innovation. Stanford Social Innovation Review, 6(4), 35-43
Pithon, G., Asdih, C. et Larivée, S. (dir.) (2008). Construire une communauté éducative. De Boeck Supérieur. http://www.cairn.info/construire-une-communaute-educative-un-partenariat– 9782804156992.ht
Proulx, J. (2010). Des communautés à revitaliser : Un défi collectif pour le Québec. Rapport du groupe de travail sur les communautés dévitalisées. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/affaires-municipales/publications/developpement_territorial/municipalites_devitalisees/rapport_communautes_devitalisees.pdf
Réseau québécois en innovation sociale (2011). Déclaration québécoise pour l’innovation sociale. https://www.rqis.org/innovation-sociale/
Rieutort, L. (2012). Du rural aux nouvelles ruralités. Revue Internationale d’Education de Sèvres, Centre international d’études pédagogiques (CIEP), 59, 43-52.
Roussel, H. (2008). Les bibliothèques publiques québécoises. Documentation et bibliothèques, 54(2), p. 59–64. https://www.erudit.org/fr/revues/documentation/2008-v54-n2-documentation01777/1029310ar/
Simard, P. (2014). Les effets de la politique nationale de la ruralité du Québec sur la santé des ruraux et des communautés. Rapport de recherche Programme Actions concertées. https://frq.gouv.qc.ca/app/uploads/2021/08/annexes_effets_politique_nationale_ruralite_du_quebec.pdf
Stake, R. E. (2008). Qualitative Case Studies. Dans N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (éds), Strategies of Qualitative Inquiry(3e éd., pp. 119-149). Sage Publications.
Statistiques Canada (2022). Région métropolitaine de recensement (RMR) et agglomération de recensement (AR) : définition. https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/92-195-x/2021001/geo/cma-rmr/cma-rmr-fra.htm
Solidarité rurale du Québec. (2018). Les milieux ruraux du Québec : portraits régionaux. Coop Carbone. https://tousruraux.quebec/wp-content/uploads/2018/05/portrait-milieuxruraux-coopcarbone-2018.pdf
UNESCO (2021). Diversité des expressions culturelles. CDIS | Viet Nam’s Indicators https://fr.unesco.org/creativity/cdis/profiles/viet-nam#dimension-878
UNESCO (1997). Éducation des adultes : la déclaration de Hambourg, l’agenda pour l’avenir. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000116114_fre
Vézina, G., Blais, P. et Michaud, P. (2003). Les collectivités viables en milieu rural : bref regard sur les enjeux et sur certaines pistes d’action. Québec, Ministère des Affaires municipales et des Régions.
Vuilleumier, E. (2015). Mise en place d’un bibliobus dans le Val de Bagnes : étude de faisabilité. Rapport de travail dans le cadre d’étude de la Haute École de Gestion de Genève.
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net