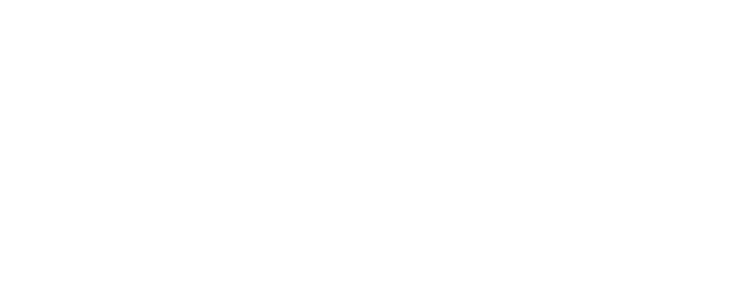Amalgame(s) de genres, modes et pratiques de la création et de la recherche en art et en éducation
Au-delà des dimensions sémiotiques ou sensorielles des modes de réception/production de sens qui prévalent depuis quelques décennies, principalement dans le domaine de la communication, l’équipe de la Revue Multimodalité(s) a fait le choix, en 2023, d’affirmer la pluralité des multimodalités dans les pratiques humaines. Cela permet d’embrasser d’autres approches hybrides, que ce soit dans leurs dimensions matérielles, spatiales, temporelles, dynamiques ou plus largement sociales, politiques, philosophiques, esthétiques, culturelles, etc., ou bien encore entre ces dimensions. Cela ouvre ainsi la voie, pour la revue, à de nouvelles avenues d’action et objets d’investigation. Pour marquer ce passage élargi, le volume 21 aborde autrement deux domaines, l’art et l’éducation, en insistant sur leur contribution à la recherche par la création et à la création par la recherche, et en les considérant à la fois comme des pratiques et des méta-pratiques qui englobent une pratique réflexive. Si, dans son sens commun, la pratique est vue comme une activité dont le but est d’appliquer une théorie, d’accomplir une démarche en suivant ou en transformant des règles, principes ou techniques pour obtenir des résultats concrets (CNRTL, 2025), d’autres définitions réfutent ce dualisme platonicien qui oppose théorie et pratique. Pour Weil (2025), il s’agit d’une activité où les deux pratiques sont « indissolublement unies ». Quant à la méta-pratique, elle englobe les diverses dimensions d’une réalité complexe et en examine les interconnexions à partir d’un cadre de référence, pour mieux comprendre un tel écosystème (Grise-Owens et al., 2014).
En mettant en œuvre des processus d’expérimentation selon une intention, en suivant ou en transformant des règles, des procédures ou des techniques, en exerçant une agentivité individuelle ou collective, avec une distanciation critique, la création et la recherche comme pratiques s’accomplissent dans une démarche vers la connaissance. La première pratique met surtout l’emphase sur « l’agencement d’éléments sensoriels et sémiotiques pour évoquer une certaine sensibilité au monde (Rancière, 2000; Richard, 2016; Veron, 1985); la seconde insiste sur la « production de connaissances transmissibles et transférables » (Bouhedi, 2017). Cependant, les deux peuvent aussi donner lieu à une « formalisation de l’expérience » sans intention de production précise et même sans résultat probant (Cursan, 2018) ou sans œuvre (Brugère, 2009). En favorisant la « rupture » comme acte créateur (Khun, 1962/2008; Beacco, 2017; Molinet, 2006; Morillon, 2021) ou la « résistance aux idées reçues » (Richard et al., 2022), elles vont bien au-delà de simples applications de processus, d’obtention de résultats ou de conservation du statu quo.
Porté par des membres du regroupement de recherche AmalGAME – Genres artistiques et médiatiques en enseignement, de la Faculté des arts de l’Université du Québec à Montréal, le volume 21 aborde spécifiquement le thème des amalgames en s’inscrivant à la jonction des domaines de l’art, de l’éducation et de la science. À partir de croisements de genres, de modes et de pratiques en création et en recherche, les membres du regroupement ainsi que les autrices et les auteurs de ce volume investiguent autant de façons d’associer, de combiner, de remixer des éléments variés. L’amalgame a ceci de particulier qu’il mélange ou fusionne des éléments de nature hétérogène pour produire un effet par une rencontre imprévue et inédite. Cette combinaison d’éléments divers (code, signe, mot, image, matière, objet, personne, etc.), qu’on pourrait qualifier d’intentionnellement improvisée, permet de créer un effet de surprise, de contraste, de confusion, de déconsidération même. Ainsi, l’amalgame favoriserait « la circulation de l’imaginaire en dehors d’un cadre trop souvent dominé par des préoccupations disciplinaires » (Richard, 2015).
En s’intéressant aux multimodalités qui résultent de la mise en œuvre de ces pratiques et méta-pratiques, de leur conception à leur diffusion sous divers genres (par ex. : carte conceptuelle, inventaire, étiquette, entretien, journal de bord, etc.), ce volume s’inscrit ainsi dans la lignée de quelques volumes récents de la revue. Bien qu’il privilégie la création à la créativité (vol. 16), il s’insère dans la « continuité parmi les modes d’action et de pensée » (Brunel et Lemieux, 2023). Qu’elles soient sémiotiques ou méthodologiques, il retient, d’une sémiotique de terrain (vol. 17), « la nécessité d’hybrider les approches » (Saemmer et Tréhondart, 2023). Sur le thème de l’éclatement générique (vol. 18), il aborde la diversité de « combinaisons inédites » (Béhar, 2010, p. 49) qui « décloisonnent, ébranlent, reconfigurent ou réaffirment les horizons génériques » (Acerra et Boutin, 2023). Sur la méthodologie, il poursuit les investigations hybrides du volume 20 (Vallières, Gladu et Mercure, 2024).
Toutefois, les articles sélectionnés se distinguent en se penchant plus particulièrement sur les pratiques de création et leur impact sur les pratiques éducatives et de recherche. Ces pratiques présentent entre autres des perspectives inédites pour étudier comment des moyens techniques émergents transforment ces domaines dans une optique interdisciplinaire. De plus, les amalgames créés par les artistes, les pédagogues ou les scientifiques dans leurs pratiques ne vont pas sans soulever des questions pragmatiques, esthétiques et éthiques. Ils peuvent confronter les contextes réel et virtuel, naturel ou artificiel, la surconsommation et l’improductivité, l’authenticité et l’emprunt, alterner rapidité et lenteur, individualisme et collectivité. À partir d’approches méthodologiques mixtes et innovantes, du point de vue des traditions disciplinaires et du point de vue de la posture épistémologique, les autrices et auteurs relèveront les processus combinatoires en action dans leur création ou leur recherche tout en abordant les enjeux sociaux, éducatifs ou culturels qui se dégagent de leur pratique. Ces approches ont été choisies pour leur capacité à s’adapter aux besoins des pratiques de la création et de la recherche en art et en éducation, ainsi qu’à ceux exprimés par les partenaires ou autres personnes participantes.
Diversité d’amalgames
La thématique retenue pour ce volume se déploie autour de trois axes qui combinent recherche et création tout en décrivant des amalgames spécifiques : 1) génériques et culturels; 2) méthodologiques; et 3) contextuels et technologiques. Les articles qui composent ce volume s’arriment à un ou à plusieurs de ces axes. Ils prennent une forme scientifique plus classique (problématique, cadre théorique, méthodologie, résultats, etc.), celle d’une documentation de pratique mobilisant la méthode des 4P (portrait du milieu, processus de cocréation, projet et productions en découlant) ou bien s’adaptent à la méthodologie hybride choisie.
1) Amalgames génériques et culturels
La théorie des genres comme catégories et comme système de classification a un long et chaotique historique réparti entre diverses disciplines (artistique, médiatique, scientifique, ludique, scolaire, vernaculaire, populaire, etc.), surtout depuis l’avènement des technologies numériques (Dowd et al., 2006). En études littéraires (Genette et al., 1986), le genre constitue traditionnellement une sorte de mise en forme d’un ensemble plus ou moins récurrent de caractéristiques, de procédés, de règles, de structures et d’agencement entre les éléments déterminants qui le composent. À la lumière des nouveaux déploiements du numérique s’opère aujourd’hui l’éclatement et la recombinaison de ces éléments constitutifs, la révision de l’histoire en récits multiples, la prise en compte des contextes de production littéraire, de même que la création de nouveaux genres composites (Acerra et Boutin, 2023; Bluijs, 2021; Hayles, 2008). En art, le genre répondrait aussi à un « besoin inscrit au plus profond de l’organisme enclin à utiliser des espaces symboliques comme ancrage d’un continuum interne » (Paquin, 1997). Ces éléments constitutifs peuvent varier selon le champ de référence (thème, modalité, forme, valeur, style, configuration, fonction…).
Pour Dowd et al., quelle que soit la discipline ou le domaine, le concept de genre importe toujours parce qu’il permet à la personne à l’origine de la création ou de la réception d’une pratique ou d’une production de s’inscrire dans une continuité historique et culturelle, mais aussi de s’en détacher, voire de la transgresser; il dépend aussi de son potentiel de reconnaissance et de signifiance selon les attentes et les désirs dans la création ou la réception; il se définit autant par sa conformité aux normes, par sa transformation en un autre genre que par son exclusion d’autres formes. Au-delà des complexités de nomenclature et de classement, cette notion fédératrice et transversale permet d’aborder les amalgames de genres comme générateurs de création, tout en tenant compte des tensions et des chocs que peuvent provoquer les croisements de genres dans les pratiques.
2) Amalgames d’approches méthodologiques
Depuis quelques années se développent des approches méthodologiques hybrides sortant des cadres traditionnels définissant les pratiques, qu’on pense à l’ARTographie, la cocréation, la recherche-action participative, la recherche-création, la recherche design, la slow recherche, etc. Dans le domaine de la création, le processus artistique est reconnu en soi comme une forme de recherche (Goessling et al., 2022). Ce processus contribue également à la recherche-création qui s’est implantée depuis les années 1990 au cœur de nombreux programmes de recherche et de formation universitaire, permettant d’étudier le processus de création à l’œuvre, surtout dans la création artistique (Pluta et Losco-Lena, 2015). On observe aussi de plus en plus de projets où les méthodes de la recherche-création s’immiscent dans la recherche en éducation, mais aussi dans les secteurs des sciences humaines et des sciences sociales (art-based research), et où les activités de diffusion des résultats et de transferts des connaissances s’appuient sur des pratiques créatives réalisées par et avec les personnes participant aux recherches. Aujourd’hui, des instances gouvernementales mettent en place des programmes de financement de la recherche et de la création qui valorisent et encouragent la créativité en invitant à sortir des structures traditionnelles de recherche et à faire preuve d’inventivité dans leur pratique, d’où la diversité des méthodologies.
Il reste que les statuts de certaines recherches hybrides, transdisciplinaires ou intersectorielles, en arts et en cultures numériques par exemple, restent « peu adaptés à une légitimation au sein d’administrations culturelles segmentées » (Besson et Gouteux, 2021). Toutefois, selon Fourmentraux (2014), la trilogie art, science et technologie (AST) demeure « un lieu stratégique pour repenser de façon plus générale les modes d’organisation du travail […] et les modes de production du savoir » (p. 113).
3) Amalgames contextuels et technologiques
Les contextes de pratiques et de production se transforment constamment depuis le début du XXIe siècle. Les contextes réels se sont vus démultipliés par les contextes numériques, et ces derniers sont nombreux (réalité augmentée, réalité virtuelle, intelligence artificielle, etc.). Ainsi, les technologies des réalités étendues (RÉ) nous font entrer dans la troisième phase de la révolution numérique, soit celle de la spatialisation du Web 3.0 (Ivanova et Watson, 2021). Quant aux arts immersifs, ils estompent encore davantage les frontières entre l’art et la vie en proposant des expériences où l’espace et la temporalité des œuvres englobent littéralement le corps (Bernard et Andrieu, 2015). Dans ce nouveau type d’expérience, la spect-actrice ou le spect-acteur n’est plus seulement la ou le témoin d’un évènement esthétique, mais habite un espace interactif qui peut être activé par sa présence corporelle, son mouvement et ses actions.
Dans de telles conditions s’ouvrent de nouveaux possibles, tant du côté de la création que du côté des dispositifs de recherche, de consultation et d’interaction avec des données et des contenus spatialisés. Les œuvres hybrides qui résultent de cette interpénétration des contextes, des spatialités, des frontières et des fonctions rendent irréversible le morcèlement des anciennes divisions opposant art et science (Fourmentraux, 2014).
Des recherches et des projets arrimés ou traversant les axes
Inscrit dans un contexte sociétal de plus en plus uniformisé, marchandisé et dans lequel résonne un bruit médiatique assourdissant, la thématique de l’amalgame se justifie par le besoin de « faire du sens », de décoder et de partager des fabrications créatives signifiantes, tout cela avec un certain recul face aux nombreux changements qui s’opèrent aujourd’hui à un rythme effréné. Les articles qui composent ce volume abordent les amalgames et les multimodalité(s) de diverses façons, tout en s’inscrivant dans une littératie médiatique multimodale (LMM), telle que développée par l’équipe de recherche du même nom.
Dans le premier article, intitulé Entre dispositifs matériels et dispositions incarnées : appréhender le caractère écologique et épistolaire du processus sémiotique, Céline Monvoisin aborde les pratiques pédagogiques du design intégrant l’expérience concrète du corps et de la matérialité dans une approche « lente » et écoresponsable. Elle recourt au genre du récit de voyage en documentant et caractérisant les espaces, matérialités et temporalités de divers milieux d’enseignement. Inspirée de la pensée archipélique de Glissant (1997), ce genre lui permet d’interpréter les données recueillies en s’imprégnant à chaque escale par « immersion incarnée », puis de transcrire l’expérience par une « émersion descriptive », tout en fabriquant carnet de notes, encres ou outils. Elle crée ensuite un dispositif multimodal qui archive paroles, gestes, images, textes et sons, une collection qui sert à la fois de preuve et de récit. L’approche épistolaire permet à la chercheure une mise en correspondance pour mieux saisir les points de vue et les vécus dans les pratiques investiguées.
Rédigé par le collectif Obèle, le deuxième article, Amalgamer la littérature et le jeu vidéo : les pratiques symbiotiques de recherche-création s’inscrit dans la mutation de la littérature vers des pratiques multimodales. Le collectif explore la cocréation littéraire et vidéoludique sous diverses formes, telles que capture d’écran amplifiée, GIF animé, performance ludique vidéographiée, en reconfigurant des dispositifs vidéoludiques existants. En alternant recherche et création dans des « cycles heuristiques » (Paquin, 2019), il cherche les « points de convergences entre les mécaniques d’action » d’un jeu et « des formes littéraires qui correspondent au discours du jeu et à l’espace d’insertion de texte ». L’écriture est partagée entre les membres du collectif par l’utilisation du journal de bord comme genre qui se décline en sous-genres pour appuyer le processus de recherche-création selon les phases d’exploration, de développement et d’exécution du projet en cours.
Dans Im-produire au moyen du dessin cartographique pour repenser les approches en éducation et en pratique artistiques, le troisième article, le duo d’artistes chercheures formé de Camille Courrier et Claude Majeau réagit aux injonctions à la productivité, à l’accélération et au cloisonnement des tâches dans notre société en examinant les « modalités de visibilité et d’invisibilité dans les milieux institués de l’art et de l’éducation ». C’est en expérimentant l’improductivité en cocréation dans divers milieux que les autrices incitent à prendre le temps d’explorer « les impasses du processus créateur et le terreau de la recherche », et d’en révéler les processus combinatoires. Inscrite dans une approche transpédagogique et écoféministe, cette démarche combine les pratiques en explorant l’incertitude, l’errance, l’échec et le risque, créant des « communs » et cultivant la dimension citoyenne en résonance avec soi et les autres. Le duo recourt à la cartographie radicale comme « méthode multimodale de recherche » et « répertoire de présentation des résultats », intégrant le dessin dans des dispositifs collaboratifs. En résultent quatre fabriques : critique, éducative, publique et duelle qui, au-delà de l’improductivité, amènent à « réfléchir-faire-défaire ».
Carole Brandon et Jordan Fraser Emery cosignent Jeux et enjeux des inégalités de genre sur les réseaux sociaux numériques : documentation de pratiques et retour réflexif sur un workshop ludopédagogique au quatrième article. C’est par la conception et le prototypage d’un jeu de société coopératif pour jeune public, lors d’un atelier offert dans un cursus universitaire, que le duo sensibilise les étudiantes et les étudiants à l’impact des médias numériques sur ces enjeux. Amalgamant art et communication, leur approche ludopédagogique mobilise modes et genres de la représentation pour aborder le système de conventions et de règles générées par les genres ludiques ainsi que par l’identité de genre. Cette approche s’insère dans une recherche-création qui permet d’explorer et de comprendre les phénomènes en jeu. L’atelier s’amorce par l’étude d’un fait d’actualité lié à la construction du genre. La création d’une cartographie numérique collective et multimodale incite ensuite les groupes à échanger des idées et à choisir des pistes pour l’élaboration de leur jeu. Puis, le bricolage d’une maquette analogique interactive représentant le problème étudié permet d’esquisser la forme et la mécanique du jeu avant que ce dernier soit construit sous forme de prototype en fixant ses règles. Ce dispositif permet d’« ancrer les apprentissages dans des contextes concrets […] tout en ouvrant des perspectives sur les usages critiques et créatifs des réseaux sociaux numériques » pour un public jeunesse.
Pour le cinquième article, Collaboration dans l’enseignement des arts plastiques, Stacey Cann propose une analyse originale des processus collaboratifs entre humains, matériaux de création et dispositifs technologiques en contexte de formation universitaire et de production artistique. Développant une méthodologie phénoménologique et s’appuyant sur les principes de la théorie de l’acteur réseau du sociologue Bruno Latour (2005), l’autrice présente une enquête qui identifie les compétences mobilisées et les perspectives de développement professionnel qui émanent des dynamiques entre acteurs humains et non humains. Il en résulte « [l]’amalgame de compétences, d’idées et de perspectives » qui pourra servir de « modèle d’ouverture aux autres » par la collaboration.
Le sixième article, Extime en ligne et expérience artistique, de Clara Périssé et Yves Renaud, fait le bilan d’un module de formation universitaire destiné à l’immersion d’enseignantes et d’enseignants généralistes dans des environnements en ligne où le vécu personnel, réel ou fictif est partagé par le biais de contenus multimodaux de nature artistique. Présentant un riche échantillon de données médiatiques issues des réalisations des personnes participantes, et allant de l’art sonore à l’animation, à l’écriture et à l’art web, le duo d’autrice et d’auteur démontre comment le croisement du parcours personnel, de la démarche de création et de la formation du personnel enseignant participent à l’acquisition de compétences en littératie médiatique multimodale.
Dans Vers une littératie multimodale climatique : sens émergents du croisement de données d’expérience entre vivants et appareils, la contribution des autrices Chantal T. Paris et Gisèle Trudel, présentée au septième et dernier article, témoignent d’une action multimodale de recherche-création visant à éveiller, dans la collectivité, une puissance d’agir autrement sur la grande problématique des changements climatiques. S’appuyant sur le concept de transindividualité de Simondon (1964/2005), ces artistes chercheures revisitent un vaste corpus de données climatiques par le biais d’activités interdisciplinaires mêlant sciences forestières, arts technologiques et savoirs citoyens. Ce processus mène à la formulation inédite et innovante d’une littératie multimodale climatique.
De sorte, ce volume témoigne de l’imbrication inévitable des trois axes de réflexion chez les autrices et auteurs, de même qu’entre les concepts présentés, les méthodologies employées, les contextes explorés, les nouvelles pratiques engagées. Presque tout se conjugue au pluriel. La question des genres comme catégories est abordée dans son double sens et devrait nous ramener à son étymologie, generis, puisqu’elle permet d’amorcer une réflexion sur ce que nous avons en « commun » avec les êtres, les choses et le monde qui nous entourent, sur leur situation dans des continuums génériques et sur les pratiques valables qu’elles peuvent générer. De même, les méthodologies utilisées sont hybrides et variées, l’amalgame des approches étant une constante à travers les écrits. D’ailleurs, plusieurs articles réfèrent à la recherche-création, elle-même hybride, dans un but de faire profiter à la démarche scientifique les attributs du caractère indiscipliné du processus de création artistique (Bianchini, 2010). Quant à la démultiplication des contextes, des technologies et des enjeux à l’ère du numérique, elle est présente sous diverses formes et nous rappelle la nécessité d’une méta-pratique réflexive.
Malgré leur récente reconnaissance, ces nouvelles pratiques, largement inspirées du domaine des arts tout en intégrant l’éducation, restent encore à légitimer auprès des institutions. Il reste aussi à développer une véritable approche transdisciplinaire des amalgames de genres, de méthodologies ou de technologies en œuvrant à l’identification, petit à petit, et appuyée de données empiriques, de ce qui constitue et anime les liens de ces assemblages complexes. Un projet pour lequel ce volume pose quelques jalons.
Acerra, E. et Boutin, J.-F. (2023). Éclatement des formes, des théories et des pratiques didactiques de la littérature sous l’impact du numérique. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 18. https://revuemultimodalites.com/volumes/18
Beacco, J.-C. (2017). De l’innovation en didactique du français et des langues. Méthodal 1, Réflexions sur la nature, le rôle et les origines de l’innovation (ou de ce qui est tenu pour tel) en didactique du FLE. http://methodal.net/spip.php?article6.
Bernard, A. et Andrieu, B. (2015). Les arts immersifs comme émersion spatiale du sensible. Corps, 13(1), 75–81. https://doi.org/10.3917/corp1.013.0075
Besson, R. et Gouteux, M. (2021). Révéler les externalités des écosystèmes des arts hybrides et cultures numériques. L’Observatoire, 58(2), 93-96. https://doi.org/10.3917/lobs.058.0093
Bianchini, S. (2010). Recherche et création. Dans S. Bianchini (dir.), R&C : recherche & création : Art, technologie, pédagogie, innovation (p. 18‑43). Burozoïque; Les éditions du parc, École nationale supérieure d’art de Nancy.
Bluijs, S. (2021, novembre). Electronic Literature. Online Encyclopedia of Literary Neo-Avant-Gardes.https://www.oeln.net/electronic-literature
Bouhedi, M. (2017). Les pratiques de partage des connaissances d’une unité de recherche pluridisciplinaire en interne et externe. Communication & management, 14, 71-88. https://doi.org/10.3917/comma.141.0071
Brugère, F. (2009). La disparition de l’œuvre. ESSE, 66. http://esse.ca/fr/la-disparition-de-l-oeuvre
Brunel, M. et Lemieux, A. (2023). Développer la créativité en didactique : pratiques multimodales et numériques. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 16. https://doi.org/10.7202/1096907ar
CNRTL (2025). Pratique. Centre national de ressources textuelles et lexicales. https://www.cnrtl.fr/definition/pratique
Cursan, A. (2018). Un chercheur sachant chercher : de l’importance scientifique des résultats « nuls » et négatifs en psychologie. Pratiques psychologiques, 24(3), 309-324. https://doi.org/10.1016/j.prps.2018.03.001
Dautrey, J. (2010). La recherche en art(s). MF.
Dowd, G., Stevenson, G. L. et Strong, J. (2006). Genre Matters: Essays in Theory and Criticism. Intellect Books.
Fourmentraux, J. P. (2011). Artistes de laboratoire. Recherche et création à l’ère numérique. Hermann.
Fourmentraux, J. P. (2014). Art, science, technologie. Création numérique et politiques de l’interdisciplinarité. Volume,10(2), 113-129. https://doi.org/10.4000/volume.3999
Genette, G., Jauss, H. R., Schaeffer, J.-M., Scholes, R., Stempel, W. D. et Viëtor, K. (1986). Théorie des genres. Seuil.
Glissant, E. (1997). Traité du tout-monde. Gallimard.
Goessling, K. P., Wright, D. E. et Dewhurst, K. M. (2022). Engaging Youth in Critical Arts Pedagogies and Creative Research for Social Justice. Opportunities and Challenges of Arts-Based Work and Research with Young People. Routledge.
Grise-Owens, E., Jay Miller, J. et Owens, L. W. (2014). Responding to Global Shifts: Meta-Practice as a Relevant Social Work Practice Paradigm. Journal of Teaching in Social Work, 34(1), 46-59.https://doi.org/10.1080/08841233.2013.866614
Hayles, N. K. (2008). Electronic Literature. New Horizons for the Literary. University of Notre Dame Press.
Ivanova, V. et Watson, K. (2020). Future Art Ecosystems: Art x Metaverse (Vol. 2). Serpentine. https://www.serpentinegalleries.org/whats-on/future-art-ecosystems/
Khun, K. (2008). La structure des révolutions scientifiques. Flammarion
Lacelle, N. et Boutin, J.-F. (2020). Multimodalité. Dans F. Brillant Rannou, N. Le Goff, M.-J. Fourtanier et J.-F. Massol (dir.), Un dictionnaire de didactique de la littérature. Honoré Champion.
Latour, B. (2005). Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. Oxford University Press.
Menger, P. M. (2002). Portrait de l’artiste en travailleur. Métamorphoses du capitalisme. Seuil.
Molinet, E. (2006). L’hybridation : un processus décisif dans le champ des arts plastiques. Le Portique. http://leportique.revues.org/document851.html
Morillon, L. (2021). Faire science avec les praticiens. Divergences épistémologiques et innovation de rupture. Études de communication, 56. https://doi.org/10.4000/edc.11404
Olmedo, E. (2021). À la croisée de l’art et de la science : la cartographie sensible comme dispositif de recherche-création. Mappemonde, 130. https://doi.org/10.4000/mappemonde.5346
Paquin, L.-C. (2019). Faire de la recherche-création par cycles heuristiques. Dans lcpaquin.com. http://lcpaquin.com/cycles_heuristiques_version_abregee.pdf (page consultée le 26 août 2022).
Paquin, N. (1997). Le corps juge. Sciences de la cognition et esthétique des arts visuels. XYZ éditeur/Presses Universitaires de Vincennes.
Pluta, I. et Losco-Lena, M. (2015). Pour une topographie de la recherche-création. Ligeia, (1), 39-46.
Rancière, J. (2000). Le partage du sensible : esthétique et politique. La Fabrique.
Richard, M. (2016). Risquer d’autres postures entre l’art et l’enseignement : création pédagogique et création informelle des jeunes. Dans A.-M. Ninacs (dir.). Interdire, susciter, combattre. La prise de risque en création. Éditions de l’École des arts visuels et médiatiques.
Richard, M. (2015). Le projet amalgame et son dispositif multimodal. Création et transposition de pratiques par de futurs enseignants en arts plastiques. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 1. https://doi.org/10.7202/1047802ar
Richard, M., Labrie, M.-P., Acerra, E. et Bernard, A. (2022). Créativité, art ou création à l’école ? Susciter divergence processuelle et convergence analogique/numérique. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 16. https://doi.org/10.7202/1096913ar
Risset, J.-C. Ministère de l’Education nationale, de la Recherche et de la Technologie (1998). Art, science, technologie : rapport remis à M. le ministre de l’éducation nationale, de la recherche et de la technologie. https://www.vie-publique.fr/rapport/24345-art-science-technologie-rapport-remis-m-le-ministre-de-leducatio
Saemmer, A. et Tréhondart, N. (2023). Enseigner la sémiotique, de l’école à l’université. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 17. https://www.erudit.org/fr/revues/rechercheslmm/2023-v17-rechercheslmm08823/
Simondon, G. (1964/2005). L’individuation à la lumière des notions de forme et d’information. Jérôme Millon.
Vallières, A., Gladu, E. et Mercure, C. (2024). État des lieux et perspectives de la recherche en littératie médiatique multimodale : place aux chercheur·ses émergent·es. Introduction. Multimodalité(s) – Revue de recherches en littératie médiatique multimodale, 20. https://www.erudit.org/fr/revues/rrlmm/2024-v20-rrlmm09818/1115962ar/
Véron, É. (1985). Production de sens : fragments d’une sociosémiotique [Thèse d’état, École des hautes études en sciences sociales].
Weil, É. (2025). Pratique et praxis. Dans Encyclopaedia Universalis. https://www.universalis.fr/encyclopedie/pratique-et-praxis/
Multimodalité(s) se veut un lieu de rassemblement des voix de toutes les disciplines qui s’intéressent à la littératie contemporaine.
ISSN : 2818-0100
Multimodalité(s) (c) R2LMM 2023
Site web Sgiroux.net